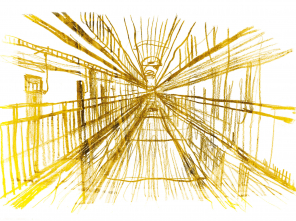Jean Bérard est enseignant-chercheur. Normalien, agrégé d’histoire, il soutient en 2010, à l’université Paris 8, une thèse de doctorat en histoire contemporaine, publiée aux Presses de Sciences-po en 2013 sous le titre La Justice en procès. Les mouvements de contestation face au système pénal (1968-1983)1. Il rejoint en 2014 l’école de criminologie de l’Université de Montréal en tant que professeur adjoint, tout en poursuivant ses recherches au sein du Centre international de criminologie comparé. La même année, il contribue à l’ouvrage Défendre en justice la cause des personnes détenues2. Après plusieurs années au Canada, il retraverse l’Atlantique pour devenir maître de conférences en histoire à l’École normale supérieure Paris-Saclay et chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP). En 2016, il coordonne, aux côtés de l’ex-Contrôleur général des lieux de privation de liberté Jean-Marie Delarue, l’ouvrage intitulé Prisons, quel avenir ?3.
Laure Anelli est journaliste. Après ses études de journalisme, elle poursuit sa formation par un master de recherche en Sciences politiques à l’université Paris 8. Spécialisée dans les études sur le genre, elle caresse l’idée de poursuivre dans la recherche avant de renoncer face à ce qui lui semble devoir être un chemin de croix : la thèse de doctorat. Elle rejoint l’Observatoire international des prisons (OIP) en 2015, organisation non gouvernementale de défense des droits et de la dignité des personnes détenues qui milite pour un moindre recours à l’enfermement, afin d’y occuper le poste de rédacteur-coordinateur de Dedans Dehors, la revue d’enquêtes et de décryptages éditée par l’association. Elle voit ainsi coïncider son désir d’engagement militant, ses compétences journalistiques et son goût pour la recherche et l’analyse, au service d’une cause trop peu défendue, au sein d’une association qu’elle admire.
C’est en écoutant les plus anciens de ses collègues se remémorer certaines des « grandes heures de l’OIP » que Laure Anelli a, pour la première fois, entendu parler de Jean Bérard. Il est en effet une chose que le CV académique de Jean Bérard ne dit pas : celui-ci a, le temps d’un CDD de quelques mois, entre son DEA et sa thèse de doctorat, lui-même tenu les rênes de la revue Dedans Dehors. Il est ensuite resté plusieurs années militant actif dans l’association, et a participé bénévolement à l’un des projets les plus marquants de l’OIP : les États généraux de la condition pénitentiaire. Pour l’aspirante-chercheuse devenue militante professionnelle, rencontrer l’ex-militant devenu enseignant-chercheur avait donc une valeur toute particulière. D’autant qu’il s’agissait, en toile de fond et ligne de mire, d’aborder certaines des questions qui les taraudent tous les deux : comment changer les politiques pénales et pénitentiaires ? D’où et comment agir ? Quels sont les points de blocage et comment les dénouer ?
Cet entretien est le fruit de deux rencontres survenues à un an d’intervalle, en février 2018 et février 2019, dans un café situé au pied des tours de la Bibliothèque nationale de France, et a été actualisé en janvier 2020. Il tente de retracer l’itinéraire politique et intellectuel d’un enseignant-chercheur engagé, à la recherche du bon endroit : où faut-il se placer pour résoudre les « tensions » qui traversent les questions pénales, entre lutte contre la répression et dénonciation de l’impunité ?
Laure Anelli – À quel moment et dans quelles circonstances avez-vous commencé à vous intéresser à la question carcérale ?
Jean Bérard – En lisant le livre de l’OIP sur les conditions de détention de 2000 sur lequel je suis tombé par hasard dans une librairie4. Je ne connaissais rien aux questions carcérales. Je l’ai dévoré, mes yeux se sont écarquillés en le lisant. Comme beaucoup de gens, j’étais choqué par les choses les plus communes, les plus faciles à appréhender quand on n’y connaît rien – l’insalubrité, l’entassement, la violence, l’absence de soin… –, qui faisaient peut-être le contraste le plus fort avec mon expérience ordinaire de classe moyenne de la société libre. J’ai un souvenir particulier : un passage sur une personne toxicomane laissée seule en cellule, en manque, sans soin, sans produit de substitution. Je n’avais qu’une connaissance tout à fait abstraite de la drogue et de l’état de manque mais cela me semblait une torture, un scandale, un déni de droit dans un État de droit, de laisser les gens dans une telle souffrance.
– Que faisiez-vous à l’époque ?
– Je faisais mes études, j’étais en maîtrise d’histoire et de philosophie. Je travaillais sur Michel Foucault et sa conception de l’intellectuel. Il y a donc eu un croisement entre le choc ressenti à la lecture de ce livre et un intérêt intellectuel, validé par la grande figure de Foucault. Lui-même activiste des luttes pour les prisonniers dans les années 1970, il permettait de donner un cadre à une interrogation, grâce à sa conceptualisation de l’« intellectuel spécifique » : par contraste avec la génération précédente des grands intellectuels français, comme Sartre, qui avaient une définition de l’engagement plus universaliste, plus générale, Foucault pensait qu’il fallait entrecroiser finement recherche et engagement, nourrir son engagement intellectuel par des recherches centrées sur une question spécifique – en l’occurrence la prison. Cette figure foucaldienne de l’intellectuel spécifique, c’est quelque-chose qui permet d’entrer facilement à la fois dans le militantisme et dans le travail de recherche, en liant un segment d’espace social sur lequel on veut travailler et dans lequel on veut s’engager. Je me rends compte maintenant que je n’étais pas le seul : c’était aussi les années où on pouvait lire la biographie de Didier Eribon, les Dits et écrits, et, un peu plus tard, les archives du Groupe d’Informations sur les prisons5. Je pense qu’il y a eu quelques mémoires de maîtrise et DEA sur Foucault et le GIP dans ces années et les suivantes.
– Pourquoi est-ce plus « facile » de s’intéresser à des causes spécifiques ?
– Pour ce qui me concerne, et pour autant que je le comprenne, je dirai que c’est parce que je n’étais pas engagé dans des formes plus générales de militantisme, dans un parti par exemple. Les questions carcérales sont des questions à partir desquelles on peut déplier tout le fonctionnement de l’ordre social, mais elles sont aussi accessibles au registre plus direct de mobilisation de défense des droits des personnes, sans s’adosser à une théorie critique ou politique plus générale.
– Comment en êtes-vous venu à travailler à l’OIP ?
– Après ma maîtrise, j’ai passé l’agrégation d’histoire avant de prendre une année de pause, en 2003-2004. C’est à ce moment-là qu’une amie étudiante, au courant de mon intérêt pour la question, m’a envoyé l’annonce de l’OIP, qui cherchait un rédacteur pour sa revue, Dedans Dehors.
– Qu’est-ce qui vous a poussé à postuler ?
– C’est difficile à dire : l’envie de m’engager, la curiosité pour un travail différent des études. C’était un peu une parenthèse. J’étais fonctionnaire-stagiaire à l’ENS de Lyon, je ne pouvais rester salarié de l’OIP que quelques mois avant de réintégrer mon statut privilégié. Je ne me suis donc occupé que de quelques numéros de Dedans Dehors. Ensuite, je suis devenu bénévole pour l’OIP ; les deux trois-années suivantes, j’étais disons un « bénévole actif ».
– Qu’est-ce que ces quelques-mois à l’OIP ont suscité chez vous ?
– D’abord la rencontre avec un travail collectif, une équipe formidable – même si la transition avec le travail de bibliothèque n’a pas été évidente pour moi. Ensuite, le souvenir le plus marquant que j’en ai, c’est la confrontation directe aux informations et aux témoignages par le biais des courriers de détenu.es adressés à l’OIP. C’était un matériau beaucoup plus abondant, plus brut que ce que j’avais pu lire par ailleurs. Par ailleurs, j’ai vu ce que voulait dire faire une enquête, la différence entre les informations reçues et celles sur lesquelles on peut communiquer. J’ai aussi découvert le travail juridique. J’ai un peu mieux compris ce que c’était, concrètement, que de se bagarrer pour des droits, avec du droit, c’est-à-dire à la fois la technicité nécessaire pour rendre une démarche audible par des tribunaux, et la vision politique qui permet d’essayer de déplacer les frontières des jurisprudences. J’ai en outre un peu découvert la relation avec le monde politique, puisqu’à l’époque, l’OIP travaillait à ce que davantage de parlementaires utilisent leur droit de visite. Pour écrire Dedans dehors, j’ai touché du doigt ce que pouvait être une écriture journalistique, et je me suis retrouvé à faire des entretiens, chose à laquelle je n’étais pas vraiment préparé – et pour laquelle je n’étais pas très bon ! L’interpellation publique, les recours administratifs, les communiqués de presse… Tout cela, ce sont des actions militantes dont je n’avais absolument aucune idée avant d’arriver à l’OIP. Au-delà, je pense que ce qui dominait pour moi, comme pour toute personne qui commence à travailler à l’OIP, c’était la prise de conscience de la multiplicité des problèmes des conditions de détention : l’absence de confidentialité des courriers, les conditions de visite au parloir, l’absence de droit du travail, l’isolement... J’en parlais à tout le monde.
– Votre sentiment d’indignation s’est-il accru ?
– Il n’est pas évident de se souvenir de ses sentiments, mais, comme tous ceux qui suivaient les politiques pénales, j’ai perçu le changement d’ambiance : quand j’ai commencé à m’intéresser à la prison, au tout début des années 2000, on était dans un moment de scandale sur la question carcérale, qui a aussi été la dernière fenêtre un peu progressiste sur le sujet, puisque le nombre de détenus a alors sensiblement mais brièvement diminué et qu’une réforme a été initiée, puis abandonnée. Quand je suis entré à l’OIP, en 2003-2004, on était en plein dans les suites de la campagne présidentielle de 2002, marquée par la très forte politisation des questions de sécurité. On assistait à une multiplication des lois pénales, à l’augmentation rapide du nombre de prisonniers. Ce n’était plus seulement le constat brut des conditions de détention déplorables, mais aussi le sentiment d’être dans un moment politique contre lequel il fallait lutter parce que la direction prise était celle de plus de répression, de plus d’incarcérations. On a beaucoup travaillé sur ces questions de politique pénale et sur leurs conséquences pour les politiques pénitentiaires l’année suivant mon arrivée à l’OIP, en vue du rapport sur les conditions de détention de 2005.
– Vous étiez donc bénévole à ce moment-là ?
– Oui. À partir de 2006, j’ai principalement travaillé sur les États généraux de la prison, qui visaient à inscrire la question carcérale à l’ordre du jour des élections présidentielles de 2007, et à susciter un débat public sur le sujet. Ils reposaient sur une vaste consultation des personnes détenues et des différents acteurs de terrain (avocats, magistrats, personnels pénitentiaires, soignants, associations intervenant en prison ou à la sortie, etc). Je pense que c’est le moment où j’ai passé le plus de temps à l’OIP. Il y avait quelque-chose d’assez enthousiasmant dans la construction de cette consultation : le lien avec les autres organisations impliquées, la construction d’un questionnaire fondé sur les recommandations des instances de protection des droits humains, la recherche d’une manière de faire parvenir les questionnaires en détention, la formulation des résultats et des demandes.
– Pouvez-vous nous en dire plus sur ces États généraux ? Quels souvenirs en gardez-vous ?
– Il y a un moment dont j’ai un souvenir assez vif : lorsque, parmi une délégation en visite au ministère de la Justice, j’ai entendu le directeur de cabinet et celui de l’Administration pénitentiaire nous dire, en gros : « On est d’accord pour que vous passiez votre questionnaire en prison ». C’était une ouverture assez inédite et inespérée. Je ne sais pas si elle a été due au regroupement d’organisations, au fait que nous étions placés sous la haute autorité de Robert Badinter ou à d’autres raisons. Nous avions aussi obtenu que les services du Médiateur de la République distribuent les questionnaires dans toutes les prisons, ce qui nous a permis d’avoir un important taux de retour. Les réponses ont ensuite été exploitées par un institut de sondage et on a pu avoir accès aux réponses aux questions ouvertes que nous avions posées dans le questionnaire. Parmi les choses dont je me souviens, il y a cette phrase d’une personne détenue : « Même si on est un tas de muscles, on a toujours une larme au coin de l’œil ». Ensuite, il y a le moment où les résultats de la consultation ont été rendus publics : ça a été fort médiatiquement, parce que la démarche avait quelque chose d’inédit. Je conserve un souvenir précis de la conférence de presse. On était tout un ensemble de représentants d’organisations à la tribune ; il y avait beaucoup de journalistes. La conférence de presse se termine, quelqu’un vient tendre un micro devant moi pour avoir une précision, et les autres journalistes, se disant qu’il doit y avoir quelque chose d’intéressant qui se passe par là, font la même chose : c’est ma première – et seule ! – expérience face à une sorte de forêt de micros.
– La démarche a-t-elle porté ses fruits sur le plan politique ?
– Ce large écho médiatique nous a permis de faire facilement réagir les candidats aux propositions que les États généraux avaient fait émerger. Beaucoup s’étaient engagés à œuvrer dans le sens de ces propositions, sauf Nicolas Sarkozy, qui avait clairement dit n’être pas du tout d’accord avec nous, ce qui n’était pas surprenant étant donné sa politique antérieure… Comme il a été élu, ça a singulièrement limité la portée du changement : tout le monde s’est de nouveau retrouvé à lutter contre les réformes répressives, comme les peines-planchers, ou à critiquer la décevante loi pénitentiaire. Je pense par ailleurs, si on se réfère aux limites de la législature suivante et de la tentative de réforme de Christiane Taubira via la Conférence de consensus, qu’il ne faut pas exagérer la puissance de transformation possible d’une telle démarche, sur les points durs de la politique pénale qui s’inscrivent dans des tendances historiques de moyenne durée.
– On vous sent un peu désabusé. L’étiez-vous déjà à ce moment-là ? Est-ce ce qui explique que vous ayez pris vos distances avec l’OIP ?
– Non, c’est plutôt ma perception actuelle quand je réfléchis à cette période. Sur mon implication à l’OIP, il y a eu plus simplement un moment où la double casquette de doctorant et bénévole à l’OIP était trop prenante. Il fallait choisir entre la professionnalisation militante et la professionnalisation universitaire ; j’ai choisi la seconde. Donc, après les États généraux, j’ai peu à peu arrêté d’écrire dans Dedans Dehors, de participer aux publications, etc. Cela fait maintenant plus de dix ans.
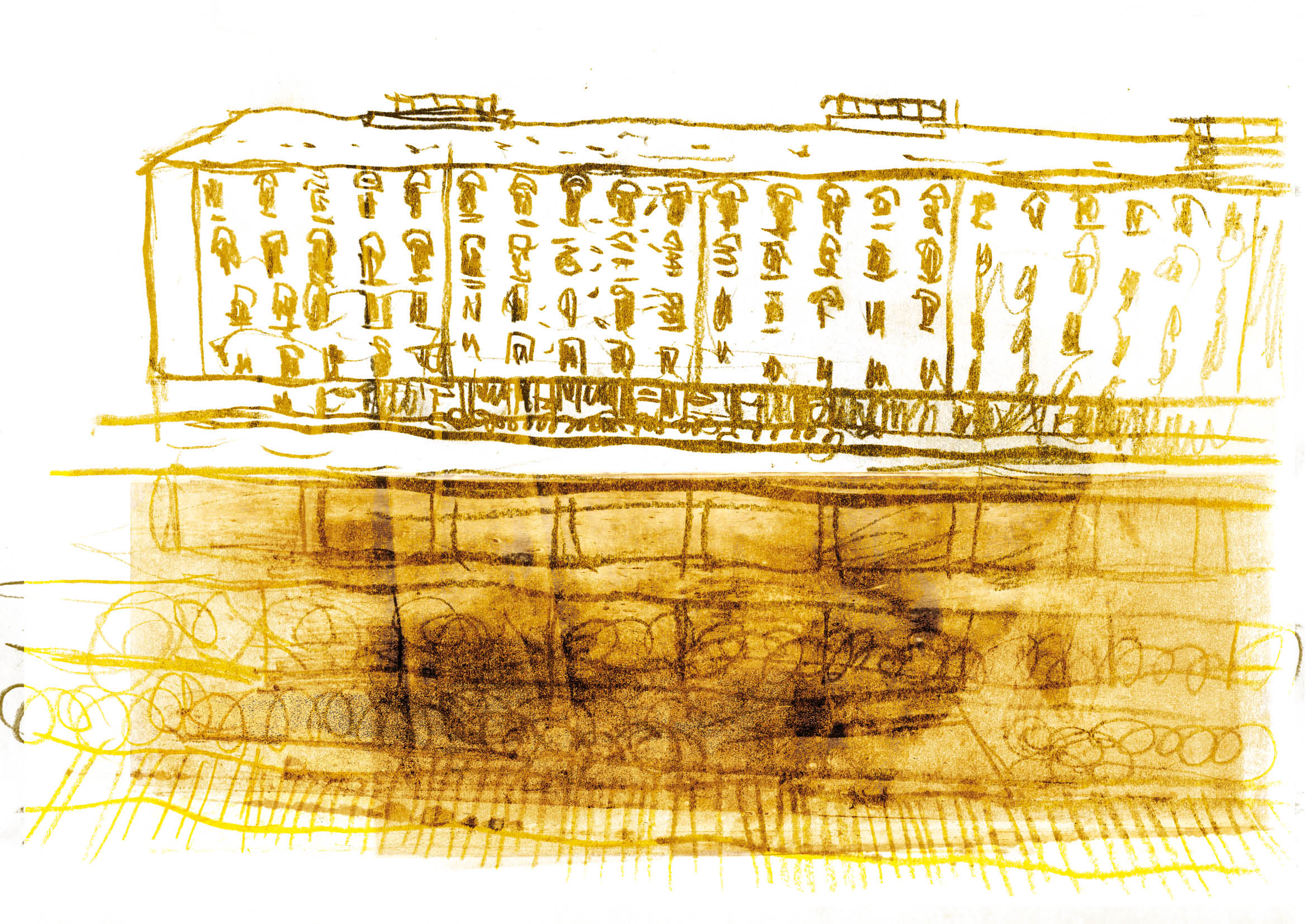
– Votre militantisme anti-carcéral a été mis en sommeil ?
– On peut dire ça, même si je suis toujours ce que fait l’OIP du coin de l’œil ! Mais c’est vrai aussi que ma thèse a progressivement changé les questions politiques que je me posais. Au départ, je travaillais sur un thème assez classique – Foucault, le Groupe d’information sur les prisons, le Comité d’action des prisonniers, les droits de prisonniers. Mais mes interrogations se sont déplacées, parce qu’il y a des questions que je n’arrivais pas à penser à partir des catégories que je m’étais forgées au cours de l’engagement sur les questions carcérales. La chose difficile, c’était en particulier la question des victimes et de leurs demandes d’écoute, de reconnaissance, d’accès à la justice, bref, leur demande de droit.
– Est-ce que l’OIP réfléchissait sur la question des victimes ?
– C’était un moment où le thème de l’insécurité était très puissant et où l’on assistait à une politisation des faits divers. Il en était très souvent question dans le débat public, avec des responsables politiques qui disaient « au nom des victimes, on va augmenter les peines ; au nom des victimes, on va faire la rétention de sûreté ». Je me souviens que ce qui était récusé, alors, à l’OIP, c’était non pas la figure de la victime, mais l’instrumentalisation qui en était faite pour mener des politiques pénales avec lesquelles nous étions en désaccord, du type de celles qui ont été défendues les années suivantes par une organisation comme l’Institut pour la Justice, fondé en 2007 après un meurtre atroce et qui demande sans cesse un durcissement des politiques pénales.
Dire cela, c’est important, mais ça n’épuise pas le problème. Si je prends l’exemple des violences sexuelles, une des manières de prendre le sujet est de décrire l’arsenal répressif de plus en plus important (allongement des peines, surveillance judiciaire, obligation de soin, création de fichier, rétention de sûreté…) et de montrer que ça forme un droit pénal spécial. Mais dans des espaces militants différents, l’enjeu qui domine concernant les violences sexuelles, c’est l’impunité, la difficulté de la parole, le mauvais accueil de la police, le long parcours judiciaire et parfois l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’une condamnation.
– Comment vous est venue cette préoccupation pour la question des victimes ?
– Peut-être d’abord en écoutant les organisations qui défendaient les victimes sans être alliées des politiques répressives, mais en prenant appui sur des fondements normatifs proches de ceux utilisés pour défendre les droits des personnes détenues. Après tout, le résultat d’une enquête de l’OIP sur des violences commises sur un mineur incarcéré a été le déclenchement de poursuites pénales6 conclues par un procès et une condamnation. Comme je travaillais sur les mouvements militants des années 1970, je me suis demandé si je pouvais trouver trace de ces débats parmi les organisations qui ont promu des réformes pénales dans des directions qu’on peut considérer comme opposées, entre le refus de la prison et la revendication de la condamnation par la justice des violences sexistes et racistes, des morts au travail, des discriminations.
– Sur quoi portait précisément votre thèse ?
– Sur la politisation des questions pénales, de mai 68 au début des années 1980. Le but était de cerner les raisons de l’émergence des questions pénales dans les groupes militants qui naissent après 68 et qui déplacent leurs positions politiques par rapport aux traditions héritées de mobilisation en matière pénale – disons celles qui portent sur les erreurs judiciaires et sur le statut des prisonniers politiques. J’ai essayé de décrire la formation de nouveaux positionnements critiques sur le fonctionnement de la justice, à partir des mouvements d’extrême-gauche, anti-racistes, féministes et gays. Surtout, j’ai essayé de montrer la transition entre un moment dans lequel ces revendications sont à la fois distinctes mais relativement en accord, autour de la critique des institutions disciplinaires (qu’il s’agisse des prisons, des casernes, des hôpitaux, des familles ou des usines), et un moment, à la fin des années 1970, où les positions pénales deviennent conflictuelles, en particulier lorsque les institutions pénales réagissent et que l’État réforme. C’est alors qu’on voit se former le cadre des conflits qui, ensuite, resurgissent régulièrement sous différentes formes, sur les usages militants du système pénal.
Pour ne prendre que des exemples récents : faut-il légiférer sur le harcèlement de rue ? Faut-il se réjouir de l’incarcération de délinquants en col blanc comme Patrick Balkany ? Faut-il faire de toutes les atteintes sexuelles en deçà de la majorité sexuelle des crimes en instituant une présomption de non consentement ? Faut-il en finir avec la prescription en matière de violences sexuelles commises contre les enfants ? Faut-il interdire aux personnes qui ont un casier judiciaire de se présenter aux élections ? Ou faut-il enfermer les auteurs d’infractions environnementales ? Le sociologue américain David Garland dit que, depuis les années 1970, en matière pénale, il n’est pas si simple de savoir qui est du côté des progressistes et qui est du côté des réactionnaires7. On peut dire que j’ai essayé d’écrire l’histoire de cette incertitude.
– Pouvez-vous expliciter davantage ?
– Jusqu’au milieu des années 1970, un mouvement comme le Comité d’action des prisonniers (CAP) n’est pas en conflit avec les groupes féministes : ils ont au contraire des points de convergence dans la critique de l’incarcération des femmes. À la fin des années 1970 toutefois, alors que les groupes féministes revendiquent la reconnaissance du viol comme crime et que des condamnations lourdes tombent, les militants du CAP ne sont plus d’accord et interpellent les féministes sur leur usage de la justice pénale – question qu’elles se posent d’ailleurs elles-mêmes à ce moment.
– Ces conflits ont-ils eu des effets au-delà des mondes militants ?
– Oui, ces conflits ont aussi des effets dans le champ politique. Dans la préparation du programme socialiste de 1981, le PS a été pris dans des revendications militantes contradictoires. Dès les années 1970, Choisir, l’association de Gisèle Halimi, a travaillé à la politisation des questions de violences sexuelles et à l’obtention de la réforme sur le viol, votée en 1980. Mais cette association considérait que la loi n’avait pas assez alourdi les peines en matière de violences sexuelles. C’est ce qu’elle revendiquait auprès de Mitterrand dans la campagne de 1981. D’un autre côté, dans la seconde moitié des années 1970, le gouvernement de droite avait – déjà ! – politisé les questions d’insécurité et fait passer des textes répressifs, dont une loi sur les périodes de sûreté en 1978 et la fameuse loi Sécurité et liberté en 1981. Durant ces années, la gauche judiciaire et les organisations de défense des droits de l’homme ont forgé des positions de critique de cette répression accrue. Eux aussi sont allés voir Mitterrand pour lui dire « Ce qu’il faut faire, c’est défaire tout cet arsenal répressif mis en place par la droite ». Et un des points visés était précisément la loi de 1978, qui crée les périodes de sûreté concernant, en partie, les personnes condamnées pour violences sexuelles. La gauche politique est ainsi aux prises avec différentes formes de revendications, venant de mouvements qui ont une histoire politique commune, ancrée dans les années 1970. Mais, à la fin de la décennie, dans ce moment où, comme l’a écrit Michelle Zancarini-Fournel, « l’horizon d’attente qui était jusque-là l’utopie de l’espérance révolutionnaire et d’un avenir radieux, devient la crise économique et sociale, la lutte contre les suppressions d’emploi et le chômage de masse »8, ces mouvements structurent des revendications spécifiques, qui sont devenues contradictoires et conflictuelles. En 1981, Mitterrand a, je crois, maintenu une habile ambiguïté.
– Est-ce que cette ambiguïté s’est inscrite dans la durée ?
– La réception de ces revendications contraires par le PS a dessiné le spectre des politiques pénales de la gauche pour les décennies suivantes, entre recherche d’alternatives pour les courtes peines (comme le TIG en 1983 ou la contrainte pénale en 2014) et absence de réforme structurante pour les longues peines. On peut dire que c’est le résultat du manque de courage de la gauche en matière pénale, sous la menace permanente du fait divers – et ce n’est pas faux. Mais c’est aussi le résultat du fait que le système pénal dans lequel nous vivons a en partie incorporé des revendications portées par des groupes militants depuis les années 1970. En ce sens la question n’est pas tant de décider s’il faut ou non se servir du droit pénal, mais plutôt de comprendre les conditions historiques qui font que des groupes militants se tournent vers le droit, et, ce qui est plus difficile, la puissance ou l’impuissance relative des réformes pénales sur les sociétés.
– D'après vous, en quoi la prison peut-elle être un sujet d’étude fascinant ?
– Je pense qu’il faut justement résister à l’aspect fascinant. Il y a beaucoup d’entrées en militantisme carcéral, y compris la mienne, au nom d’une forme d’exceptionnalité de la prison : on a l’impression de localiser là le point le plus noir de la République. Avec le temps, il faut sortir de cette fascination pour ne pas surévaluer la spécificité carcérale par rapport à d’autres institutions. J’ai un souvenir précis à ce sujet. Au cours de mes premiers mois à l’OIP, j’ai participé à un débat à la radio et j’ai dû dire que la place des personnes malades psychiquement n’était pas en prison, mais à l’hôpital. Quelqu’un a appelé et expliqué qu’il avait été incarcéré, puis envoyé à l’hôpital psychiatrique et mis dans une chambre de contention. J’avais lu la critique du recours à la contention en prison dans les dénonciations de la psychiatre Edith Rose au début des années 19709. Que l’actualité de l’hôpital soit le passé des prisons était pour le moins troublant. À trop regarder la prison, on surestime sa spécificité par rapport à d’autres espaces sociaux, en la considérant comme l’envers négatif des logiques d’éducation, de formation, d’accompagnement social ou de soin.
Ceci dit, la prison garde une spécificité et est intéressante dans la mesure où elle fait figure d’institution de dernier recours. Pour cette raison, elle concentre un certain nombre d’effets cumulatifs de la domination sociale qui s’exerce économiquement, scolairement, dans les rapports avec la police, avec la justice et qui se termine dans l’incarcération. Il me semble que la prison est d’autant plus intéressante qu’on est capable de remonter la chaîne des formes de domination dont elle est la dernière expression, davantage qu’une exception radicale. Je me souviens du récit fait par une personne bénévole d’une association d’aide sociale à propos d’un jeune homme suivi par l’association. Il était dans un tel état de vulnérabilité sociale que, sitôt sorti de prison et relogé, son appartement était sans cesse occupé par des connaissances qui l’envahissaient et profitaient de lui. La protection de l’intimité n’est pas seulement une question d’œilleton dans la porte d’une cellule. Dans le même ordre d’idée, les métaphores carcérales sont constantes dans la description des lieux d’hébergement des personnes à la rue.
– Aujourd’hui, sur quoi portent vos travaux ?
– Je suis un peu dispersé mais, pour prendre un exemple qui touche à nos discussions, je travaille avec Nicolas Sallée sur un projet de recherche engagé lorsque j’enseignais au Canada. Nous nous intéressons au traitement judiciaire en matière de violences et de déviances sexuelles au Canada, des années 1960 aux années 1980. C’est une période de mobilisation militante, comme en France, pour obtenir la transformation de la définition pénale des violences et déviances sexuelles, qui aboutit à des réformes dans la décennie 1980. Notre question est de savoir dans quelle mesure le système judiciaire de la période est déjà traversé par ces transformations ou bien s’il continue de fonctionner selon les catégories forgées par le droit du XIXe siècle – et la réponse est sans doute plutôt la seconde hypothèse. En travaillant dans les archives, on est tombé sur une catégorie de procès assez particuliers : ce sont ceux qui sont tenus par la justice canadienne dans les années 2000 pour des infractions qui ont eu lieu des décennies auparavant, au nom d’infractions qui ont été entre temps abolies.
– De quelles infractions s’agit-il ?
– On a fini par comprendre que c’était la manière dont les tribunaux s’y prenaient pour juger des cas de violences sexuelles commises sur des enfants et dénoncées des décennies après les faits. Au Canada, il n’y a pas de prescription en matière criminelle. Cela pose des difficultés aux magistrats : quelles infractions mobiliser alors que le droit pénal a complètement changé entre les faits et les procès ? Comment réunir des éléments de preuve aussi longtemps après les faits ? Ou encore, à quelle peine condamner ces vieillards sans passé judiciaire qui ont commis des atrocités trente ans auparavant ? Les réponses – ou une partie d’entre elles ! – seront publiées dans un prochain numéro de la revue Genèses. On peut dire un mot sur les peines, parce que cela illustre les questions que nous avons abordées. D’un côté, face à des auteurs parfois très âgés, les juges se posent la question de l’atténuation de la peine, qui n’a pas à ce moment de rôle pour dissuader ou empêcher de recommencer. De l’autre, expliquent aussi les juges, reconnaître la gravité du crime, c’est l’inscrire dans la hiérarchie des crimes et donc aussi dans la hiérarchie des peines. Devant la gravité des faits parfois, même si la personne a quatre-vingt ans et n’a pas d’antécédents, ils prononcent alors une peine sévère.
– Comment concevez-vous votre rôle de chercheur ?
– C’est difficile à dire ! Mon idée est peut-être de faire un pas de côté par rapport aux questions frontales « que faire des prisons ? » ou « que faire du système pénal ? ». Je prends un exemple en apparence éloigné. Dans un article récent, Vincent Porhel montre les dilemmes des travailleurs et de leurs syndicats après l’explosion d’une usine chimique à Lyon à la fin des années 197010. Faut-il fermer l’usine, la déplacer ou la relancer ? Pour une part, les travailleurs héritent des mobilisations écologiques des années 1970, qui ont interrogé les positions des syndicats et qui ont été portées par des associations, par exemple des associations de riverains défendant leur cadre de vie. En même temps, à la fin des années 1970, dans le contexte de crise économique et de menace du chômage, l’impératif de préservation de l’emploi limite les possibilités de pousser la critique d’une production polluante et dangereuse. Et finalement, ce que démontre l’article, c’est que cette nécessité fait que le conflit se résout en faveur de la relance de l’usine, sans avancée sur les conditions de travail. On voit dans ce cas que la question « faut-il fermer l’usine ? » débouche sur des tensions politiques difficiles à résoudre si on n’est pas capable d’imaginer autre chose que l’usine. C’est un peu ce que disent Deleuze et Guattari en 1984 lorsqu’ils expliquent que « mai 68 n’a pas eu lieu »11. Ils sont en face de mobilisations d’ouvriers pour défendre leur emploi dans la sidérurgie. Et ils se disent que si la portée transformative de 68 avait été effective, on ne serait plus devant la situation paradoxale de défense d’un travail industriel polluant et dangereux. Pour cela, il aurait fallu que les critiques radicales du travail industriel se traduisent par de nouvelles formes d’organisation de la production. À défaut, on est reconduit vers un choix entre pollution et chômage.
Je pense qu’on peut transposer la réflexion en matière pénale. Lorsque se produit la violence qui conduit à saisir la justice, il n’y a pas de bonne réponse entre impunité et répression. Ou, plus exactement, on peut dire que l’absence de tout recours judiciaire et éventuellement répressif est une position impossible à tenir, comme celle de dire qu’il faut fermer l’usine s’il n’y a pas d’autres possibilités d’emploi. Les débats sur l’usine de Givaudan sont contemporains de ceux sur le recours à la justice en matière de violence sexuelle. Dans un contexte de crise économique et de crise politique pour les mouvements politiques radicaux, les tensions se creusent à la fois dans les formulations d’un féminisme anti-répressif et dans celles d’un environnementalisme ouvrier.
– Mais, en matière pénale, n’est-il pas possible d’obtenir une reconnaissance pour les victimes sans que ne soient prononcées de peines de prison ?
– C’est la question que se posaient les groupes féministes dans la seconde partie des années 1970 et c’est aussi la question du livre récent de Gwénola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, qui tente de tenir ensemble une critique féministe des violences patriarcales et de l’incarcération, pour définir un abolitionnisme féministe12. Les tentatives pratiques pour penser des positions tierces entre l’impunité et l’incarcération sont en partie des réponses à cette question. Je pense qu’elles sont toutes intéressantes mais qu’aucune ne peut jouer le rôle d’une sorte de clé de l’énigme.
– Quelles sont-elles ?
– La première, qu’on trouve dans des propositions militantes à la fin des années 1970, est qu’il faut recourir à des sanctions moins graves dans l’arsenal pénal, par exemple l’amende plutôt que la prison. Mais on voit tout de suite les objections. Les mobilisations voulaient faire reconnaître le viol comme un crime. Comment demander en même temps que les auteurs soient jugés devant des Cour d’assises, comme les meurtriers, et qu’ils soient condamnés à des amendes, comme les conducteurs qui grillent un feu rouge ? Et, condamner à une amende, n’est-ce pas mettre un prix sur le droit des femmes à ne pas subir de violences ? Une autre ligne de réflexion porte sur l’auto-défense, ou la recherche de modalités non judiciaires de gestion des violences. C’est une proposition formulée dans les années 1970 et dont la portée se lit aujourd’hui par exemple dans le livre d’Elsa Dorlin, Se défendre13. Mais, à la fin des années 1970, et jusqu’à nos jours, l’auto-défense est aussi mobilisée à l’autre bout du spectre politique par des gens qui considèrent que la police est trop lente et la justice trop laxiste. On peut penser là-dessus aux travaux de Vanessa Codaccioni sur la France, ou à la question plus large du vigilantisme14. Dans les deux cas, ce ne sont pas des perspectives politiques très riantes.
Toujours en dehors de la justice, la question a été posée de la capacité de collectifs militants à former une alternative à la saisie des institutions. C’est parfois le cas, mais on lit par exemple, dans des journaux féministes de la fin des années 1970, la difficulté de rendre cette proposition générale, si les personnes ont peur de leur agresseur, ou, plus largement, si de tels collectifs ne sont pas disponibles. Ces difficultés ont conduit à essayer de penser des recours internes au système pénal, via de nouvelles formes de sanctions : c’est tout le champ des propositions de médiation, de justice réparatrice et restaurative.
– Ces dispositifs ne sont-ils pas à même de remplacer les peines répressives ?
– Je crains d’être réducteur sur la diversité et l’intérêt de ces dispositifs, mais je pense qu’un enjeu transversal peut être distingué : au fond, il s’agit de traiter le conflit par le recours à la parole, qui doit opérer un déplacement de la relation conflictuelle, fondé sur la transformation de l’auteur de violences. La question qui se pose alors est celle de savoir ce que l’auteur gagne par la parole qui atteste de sa transformation. Si celle-ci ne change rien à sa situation pénale, il s’y engage pour se changer lui-même et la crainte d’un faux discours est écartée – mais on n’a rien changé à la peine. Si, à l’inverse, le traitement par la parole est affirmé comme une alternative au traitement par la violence de la peine, ou peut atténuer la violence de la peine, mais alors émerge la crainte indépassable du double discours et, en réalité, du maintien inchangé des rapports de domination dont la violence a été le résultat. Je résume de manière un peu schématique ce qui me semble ressortir de travaux qui interrogent des formes d’action par la parole dans le système pénal, non pour dire qu’elles ne doivent pas être favorisées et développées, mais pour signaler que, dans une situation de violence, la réponse coopérative demeure toujours sous la menace du faux-semblant et du maintien de la domination.
– Les positions politiques de mouvement comme le black feminism ne permettent-elles pas de dépasser ces clivages ?
– Oui, Angela Davies le fait par exemple, et sa réponse est révolutionnaire : c’est d’abattre le capitalisme et le patriarcat. L’intérêt d’une telle proposition, c’est qu’elle permet de saisir le niveau de généralité, ou le niveau de transformation de la société à partir duquel une transformation radicale du système pénal devient pensable. Et il est banal aujourd’hui de dire que le niveau de conflictualité sociale comme l’aggravation de toutes les crises environnementales mettent à l’ordre du jour des transformations sociales qui ne sont pas des retouches à la marge. Cela permet de déplacer les questions pénales, mais pas de les faire disparaître. D’abord parce que les processus révolutionnaires ne sont pas forcément, pour dire le moins, des moments de grande clémence pénale. Pour parler comme Frédéric Lordon, la puissance des affects qui permettent de transformer l’ordre social ont aussi des effets sur la manière dont on considère les gardiens de l’ordre antérieur, surtout s’ils le défendent avec violence. J’ai compris ça en lisant le livre de Christian Corouge, un ouvrier CGT de Sochaux militant depuis les 197015. Il parlait du fait que lui et ses collègues souhaitaient les mines de sel pour les patrons. Il voyait que ce n’était pas trop dans l’ambiance antirépressive du moment, mais il disait qu’il fallait tenir compte de la colère. Dans les slogans des manifestations de cet hiver 2019-2020, on entend bien que la colère s’exprime par la réactivation d’un imaginaire pénal qui n’est pas très pacifique !
– Mais peut-on imaginer des sociétés qui n’auraient plus besoin d’institutions répressives ?
– Une autre manière de poser la question est en effet celle de savoir si on peut se passer de justice dans une société radicalement transformée. Au fond, c’est la question du dernier livre du même Frédéric Lordon qui discute des théories contemporaines partageant des refus radicaux des institutions16. Il leur répond que même la ZAD a des institutions, certes d’un tout autre ordre que celles de l’État. Il y a des manières par lesquelles des comportements problématiques sont définis et des formes de traitement, qui prévoient la conciliation mais aussi, le cas échéant, la mise à l’écart. Si j’essaie de généraliser l’argument, je dirais ceci : l’organisation sociale qui permet d’exercer le moins de violence répressive est sans doute celle qui est le moins traversée par des rapports violents – ça pourrait être la formulation positive de l’idée de Bourdieu de conservation de la violence. Mais il ne faut pas confondre la possibilité d’exclure et l’absence de violence. Mettre en dehors d’un collectif choisi, c’est ce que ne peut pas faire une justice qui s’exerce sur un territoire, qui n’a pas d’extérieur ou ne devrait pas en avoir. On a vu, à juste titre, au moment des débats sur la déchéance de nationalité, la violence en jeu lorsqu’il est question d’exclure non pas d’un groupe électif mais d’une citoyenneté. Penser un espace institutionnel qui n’est pas un espace d’exclusion par l’expulsion – ce qui semble souhaitable –, c’est faire disparaître une solution pour résoudre les conflits par l’éloignement de leur auteur. On est un peu reconduit à la question de la contrainte. Cela ne veut pas du tout dire qu’il y pas de différence entre la justice des États comme le nôtre et les formes de justice qui s’exercent, par exemple, dans les communautés zapatistes au Chiapas. Jérôme Baschet montre bien les efforts faits pour privilégier les solutions de médiation, de conciliation et de réparation, dans des communautés peu inégalitaires17. Mais j’ai l’impression qu’il est plus fécond de réfléchir à ce que peut être un minimalisme pénal que de partir d’un refus de principe, et de garder en tête que c’est la structure sociale qui rend possible un tel minimalisme.
– Vous vous intéressez à la question carcérale depuis plus de quinze ans, quel regard portez-vous sur les évolutions carcérales récentes ? Qu’est-ce qui vous semble le plus frappant ?
– Je connais beaucoup moins bien la situation actuelle que les militantes et militants de l’OIP ou les chercheuses et chercheurs qui mènent des enquêtes en détention. Ce qui me frappe peut-être, c’est la constance de la croissance carcérale et de l’extension du filet pénal via le bracelet électronique. Et ces tendances reconduisent les mêmes impasses pénitentiaires que l’on voit resurgir périodiquement, autour de la surpopulation des maisons d’arrêt, ou de la course à la plus haute sécurité dans les maisons centrales.
– Considérez-vous faire ou avoir fait partie d’un « monde de la prison » ?
– À l’époque où je travaillais à l’OIP, certainement, à la périphérie. On acquiert peu à peu la conscience de s’inscrire au sein d’un champ dans lequel évoluent des acteurs bien identifiés (les associations, les syndicats, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales, l’Administration pénitentiaire, les journalistes spécialisés sur les questions prison-justice…), qui entretiennent des types de relations bien déterminés. On se rend bien compte, en quelques années, qu’on fait partie de ce monde-là, avec ce que ça a de très riche et d’intéressant, mais aussi d’un peu enfermant.
– En quel sens ?
– Les questions carcérales sont des questions que l’on ne cesse de redécouvrir avec stupéfaction, de la même manière que j’ai découvert à vingt ans ce que tout le monde savait depuis longtemps. Et tant que les conditions de détention demeurent ce qu’elles sont, il est indispensable qu’elles soient exposées et dénoncées, que des actions juridiques mettent la pression sur l’État. Le jugement récent de la Cour européenne des droits de l’homme le montre18. Mais on peut dire aussi, en reprenant une expression de l’historien Paul Veyne, qu’il est utile pour la recherche d’allonger le questionnaire par lequel on interroge les institutions pénales, des conditions matérielles de leur fonctionnement vers l’ordre juridique, économique et politique dont elles sont le symptôme. Ces questions peuvent venir de mondes sociaux en apparence très éloignés de la prison. Par exemple, Roger Heim, professeur au Museum d’histoire naturelle, signe en 1973 la préface à l’édition française de Printemps silencieux, le livre majeur de Rachel Carson sur les ravages du DDT. Il se demande : « On arrête les “gangster”, on tire sur les auteurs de “hold-up”, on guillotine les assassins, on fusille les despotes – ou prétendus tels – mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics instillant chaque jour les produits que la chimie de synthèse livre à leurs profits et à leurs imprudences ? »19 C’est une bonne question, à la fois parce qu’y répondre permet de comprendre, comme le fait l’histoire environnementale, la dépénalisation des atteintes à l’environnement depuis le XIXe siècle, et parce que ça permet de réfléchir aux enjeux actuels du droit de l’environnement, par exemple autour de la catégorie d’écocide. La proposition de loi déposée à l’automne 2019 nous ramène tout droit vers les débats sur les violences sexuelles des années 1970, parce que, pour faire valoir la gravité de ce crime, elle prévoit qu’il soit sanctionné de peines allant jusqu’à vingt ans de prison20.
Notes
1
Jean Bérard, La Justice en procès. Les mouvements de contestation et le système pénal (1968-1983), Paris, Presses de Sciences Po, 2013.
2
Jean Bérard, « Des luttes politiques aux luttes juridiques dans le champ carcéral », in S. Slama, N. Ferran (dir.), Défendre en justice la cause des personnes détenues, Paris, La Documentation française, 2014.
3
Jean Bérard, « Les prisons valent-elles la peine ? », in J. Bérard, J.-M. Delarue (dir.), Prisons, quel avenir ?, PUF/La vie des idées, 2016.
4
OIP, Prisons : un état des lieux, Paris, L’Esprit Frappeur, 2000.
5
Didier Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989 ; Michel Foucault, Dits et écrits, Paris, Gallimard 1994, 4 vol. ; Philippe Artières, Laurent Quéro, Michelle Zancarini-Fournel, Le Groupe d’information sur les prisons. Archives d’une lutte. 1970-1972, Caen, Éditions de l’IMEC, 2003.
6
Pascal Ceaux, « À Chambéry, le procès rare des violences en prison », Le Monde, 15 mars 2006.
7
« The battle lines of debate seem blurred and rapidly changing. No one is quite sure of what is radical and what is reactionary » (David Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 4).
8
Michelle Zancarini-Fournel, Le Moment 68. Une histoire contestée, Paris, Le Seuil, 2008, p. 12.
9
Philippe Artières, « Les mutins, la psychiatre et l’aumônier, Archéologie d’un silence foucaldien (Toul, décembre 1971) », Le Portique, 2004, n°13-14.
10
Vincent Porhel, « Givaudan-France : contestation sociale et environnementale en contexte de crise (1979-1981) », Le Mouvement Social, no 262, 2018, p. 55-68.
11
Gilles Deleuze, Félix Guattari, « Mai 68 n’a pas eu lieu. Gilles Deleuze et Félix Guattari reprennent la parole ensemble pour analyser 1984 à la lumière de 1968 », Chimères, no 64, 2007, p. 23-24.
12
Gwénola Ricordeau, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Montéral, Lux Éditeur, 2019.
13
Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie, Paris, Zones, 2017.
14
Vanessa Codaccioni, La Légitime défense. Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières, Paris, CNRS Éditions, 2018 ; Gilles Favarel-Garrigues, Laurent Gayer, « Violer la loi pour maintenir l’ordre. Le vigilantisme en débat », Politix, no 115, 2016, p. 7-33.
15
Christian Corouge, Michel Pialoux, Résister à la chaîne. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue, Marseille, Agone, 2011.
16
Frédéric Lordon, Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent..., Paris, La Fabrique, 2019.
17
Voir : Jérôme Baschet, « Farce doit rester à la justice. La violence quotidienne d’une institution », conférence à la Bourse du travail de Saint Denis, 25 mars 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=uhI-GiYaj4Q).
18
CEDH, Affaire J.M.B. et autres c.France, arrêt, 30 janvier 2020.
19
Cité dans : Alexis Vrignon, La Naissance de l’écologie politique en France. Une nébuleuse au cœur des années 68, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
20
Voir la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, en date du 22 octobre 2019 (http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2353.asp).