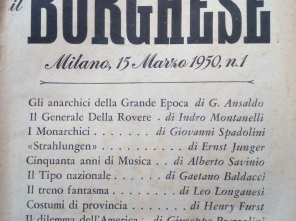Impossibilité de raconter, nécessité de réécrire
Mio padre la rivoluzione1(2017) est un recueil de récits, de portraits, de biographies contre-factuelles et de reportages de voyage concernant l’histoire et le mythe de la Révolution russe, depuis les protagonistes d’Octobre 1917 (Lénine, Staline et Trostky) jusqu’à Rosa Luxemburg, Bob Dylan et le résistant Kim2.
Né à Rome en 1969, Davide Orecchio a fait son entrée en littérature en 2011 avec les vies, réelles et imaginaires de Città distrutte. Sei biografie infedeli (paru chez Gaffi en 2011, nouvellement paru chez il Saggiatore en 2018, prix Supermondello, finaliste des prix Volponi et Napoli). Par la suite, il a publié le roman Stati di grazia (chez il Saggiatore en 2014) et Mio padre la rivoluzione (chez Minimum Fax en 2017). Il écrit sur le blog Nazione Indiana et ses nouvelles sont parues dans la revue Nuovi Argomenti. Avec City of Pigs, il a participé au recueil Best European Fiction 2018 (chez Dalkey Archive Press).

Lisa Ginzburg – Le temps est l’un des grands protagonistes de ton nouveau livre Mio padre la rivoluzione, y compris dans ses versants dramaturgiques, comme en atteste la récurrence de l’expression « la saison s’ouvre », « l’année s’ouvre… ». Le rythme palpitant, entraînant de ta prose, est-il dicté par cette façon de penser le Temps comme une sorte d’entité démiurgique, ou bien est-ce plutôt le fruit de l’univers issu de ton imagination ?
Davide Orecchio – J’ai la sensation de me poser la question « comment raconter le temps ? » chaque fois que je me mets au travail. Étant donné que j’écris souvent des biographies littéraires, ou fictionnelles, il arrive que je doive m’adapter aux changements de cap subits, aux bonds en avant et aux blancs des vécus que je raconte en recourant à des accélérations ou à des comparaisons. Dans Mio padre la rivoluzione cette préoccupation est peut-être plus évidente, et se répercute sur le style, le rythme de la prose, les métaphores, les analogies, tous les instruments que j’ai placés à la disposition du lecteur. Je réfléchis à ta question et je crois que, au fond, raconter le temps équivaut à faire le récit d’un récit. Qu’est-ce que le temps, en effet, si ce n’est une chronique ? Ne pourrait-on pas dire que le monde de la vie, avec le temps, écrit sa propre autobiographie ? Les processus, les êtres vivants et même les idées trouvent dans le temps une langue qui raconte leur naissance, leur transformation et leur mort. Mais, comme il est impossible de faire le récit d’un récit, dans le livre j’ai dû emprunter un autre chemin, déjà tracé et parcouru par beaucoup d’autres avant moi, je me suis « contenté » de le traiter comme un personnage, en lui laissant traverser les chapitres et les histoires comme une créature mythologique sur le modèle grec, ayant la capacité de générer et d’ensemencer. Ainsi, pour prendre un exemple, l’acte de naissance de Lénine est le même que celui de Chronos : le bolchevique naît du Temps, et de son accouplement avec les mères proviennent également les héros et les monstres de la révolution, les titans et les géants, les anges déchus. De même que naissent les années, elles-mêmes protagonistes des récits. 1917 (l’incendiaire), 1933 (l’affreuse), 1945 (la libératrice), 1956 (la traîtresse) et ainsi de suite. En somme, pour répondre à ta question, je ne considère pas le temps comme une entité démiurgique mais je l’ai représenté comme tel parce que j’en avais besoin. J’avais besoin que ce soit l’un des personnages du livre. Aux côtés de Trotski et de Lénine, de Plotkine et de Staline.
Mais le temps qui vit dans les pages du livre correspond aussi au temps qui réside dans notre conscience historique. C’est un phénomène qui ne fait pas la distinction entre passé, présent et futur. Il ne tolère ni unité de mesure ni conventions linéaires. Parce que dans la conscience tout est simultané, et la mémoire maintient le passé tout proche, elle le conserve dans le présent. Si l’histoire, pour citer l’expression célèbre de Benedetto Croce, est toujours histoire contemporaine, d’autant plus alors la conscience historique est toujours présentification, orientation existentielle et pragmatique de l’individu et des communautés dans le moment présent de la vie ; il s’agit donc d’un dialogue incessant entre « les présents » et « les passés » que j’ai essayé de restituer par l’intermédiaire de différents stratagèmes narratifs (poches dans le temps, mythes, sabotage syntaxique de la concordance des temps).
L. G. – Les bibliographies que tu indiques en notes à la fin de chaque chapitre/portrait, sont des points de repère à la fois très détaillés et très amples. Le lecteur y trouve rassemblés des essais mais aussi des autobiographies, et beaucoup de littérature « hybride ». Comment travailles-tu du point de vue des sources ? Qu’est-ce qui vient en premier : un intérêt focalisé sur l’historiographie, ou bien la littérature ? Et de façon générale, comment procèdes-tu lorsque tu te renseignes ? Tu es libre et tu suis tes intuitions, ou bien tu suis plutôt des rails ?
D. O. – Je suis plutôt méthodique. Je crois que je continue à appliquer les enseignements que j’ai appris à l’université, où j’ai étudié l’histoire. Je construis des bibliographies en partant du général puis, de lecture en lecture, je les rends de plus en plus précises et approfondies. Rien de nouveau. D’autant plus que, pour un historien de formation, tout est source. Mais il est certain que les rencontres aléatoires comptent beaucoup : des pages d’un seul livre émergent des dizaines d’autres livres ; ou encore on tombe, en archives, sur des documents inattendus… Je m’en remets aussi aux conseils des spécialistes, quand je peux. Je dois avouer que mon travail est bien confortable, de ce point de vue : il n’a ni la prétention à une scientificité historiographique, ni l’ambition d’être exhaustif dans la recherche. Je peux donc m’arrêter ou me mettre à écrire quand bon me semble. Heureusement, je ne dois pas rédiger à chaque fois une thèse de doctorat. Blague à part, la phase où je rassemble des documents pourrait ne jamais finir. Quand doit-on, ou peut-on s’arrêter ? Un bon indice, par exemple : lorsque tu commences à retomber sur des concepts que tu as déjà lus ailleurs, des citations que tu connais déjà, des interprétations que tu as déjà notées, c’est alors que tu n’as plus d’excuses, il te faut sans nul doute te mettre à écrire.
L. G. – Gianni Rodari [1920-1980] est une source décisive : un reportage qu’il a fait en 1969 sur l’Union Soviétique inspire l’un des chapitres centraux de ton livre. Décisif dans quel sens ? Peut-on le définir comme un médiateur, un interprète, ou bien un traducteur de l’Histoire ? Et à quel point la perspective dessinée par ses reportages a-t-elle compté pour ton écriture, pour ta façon d’écrire aussi bien de la littérature que de l’historiographie ?
D. O. – Rodari a été un auteur très important dans mon enfance, pour ma formation. Dans ce sens, oui, c’est une source décisive. Et il a été un interprète, un traducteur non pas de l’histoire mais du communisme, ou de ce que pouvait représenter le communisme pour un enfant italien dans les années 1970. Cela étant dit, même si cela me gêne un peu, je dois reconnaître que sa présence dans Mio padre la rivoluzione est paradoxalement fortuite. Il est le co-protagoniste, avec Lénine, du chapitre/récit, intitulé Un poète sur la Volga. Mais voilà un récit que je n’avais aucune intention d’écrire. C’est vraiment une sorte de cadeau inattendu des archives. Je me demandais comment aborder Lénine. Je n’avais encore rien décidé. J’avais même un gros problème, en fait, parce qu’à dire vrai, je n’en avais vraiment aucune idée. J’ai donc eu de la chance. Je me rendais aux l’archives de la Fondation Gramsci à Rome pour une autre recherche, parallèle au travail préparatoire pour Mio padre la rivoluzione, lorsque je suis tombé sur un dossier portant sur les célébrations du centenaire de la naissance de Lénine (1870-1970). Parmi les documents se trouvait un opuscule du PCUS qui contenait des instructions pour tous les partis communistes mondiaux et qui demandait, entre autres choses, qu’ils envoient des journalistes et des écrivains en Union Soviétique pour raconter l’histoire – ou plus précisément le mythe – de Lénine. Durant ces mêmes journées, j’ai trouvé à l’hémérothèque un reportage en quatre épisodes signé par Gianni Rodari, publié en 1969 dans Paese Sera, un quotidien philo-communiste de premier plan. C’était un voyage sur les lieux de Vladimir Ilitch Oulianov et à l’époque de son enfance : sa maison paternelle, celle de son grand-père, les chambres à coucher, les jeux, les vêtements. Le lien entre l’« appel » du PCUS et ces articles sautait aux yeux.
Pour moi tout l’intérêt du reportage de Rodari réside dans son regard oblique sur Lénine, qui prend ses distances avec le surhomme mythologique, et s’attache à reconstituer la mémoire de l’enfant et de ses lieux, du petit être qui n’est pas encore devenu le père de la révolution. Ce sont des pages écrites sans la moindre emphase, où l’hagiographie est calibrée avec intelligence et souvent mise en sourdine. Je qualifierais cette opération d’ingénieuse : en puisant dans son crédit d’écrivain pour l’enfance, Rodari évite de s’aventurer dans un sanctuaire qui serait impraticable pour lui aussi, même pour lui ; il laisse de côté le Lénine du mythe idéologique (un Lénine que, pour ma part au contraire, dans le contre-chant de ma nouvelle, je récupère et j’extrémise), ou alors il l’effleure à peine dans des passages pleins d’incertitudes (les passages sur son mausolée à Moscou, par exemple). Où se situe l’intérêt, de mon point de vue ? Dans le caractère symptomatique des pages de Rodari : elles sont autant d’indices d’une mutation du mythe bolchevique dans le champ politique et idéologique du communisme européen. Voilà l’un des autres thèmes portants de Mio padre la rivoluzione : la transformation « copernicienne » du mythe communiste de 1917 à aujourd’hui.
L. G. – Le choix du terme « contre-chant » me semble définir de manière très juste ton travail : c’est une approche différente du passé, depuis des points de vue impensés, parallèles. Quant aux différentes déclinaisons du Temps dont tu parlais pour commencer, en répondant à ma première question, pourrait-on dire que s’y ajoute le temps de la métamorphose ? De même qu’une historiographie littéraire voire poétique, à laquelle, à mes yeux, tu donnes naissance dans Mio padre la rivoluzione (et qui me paraît, en tant que femme de lettres, si originale et si féconde), sera plus à même que d’autres approches de saisir le noyau évolutif du rapport avec le passé au fur et à mesure qu’augmente la distance temporelle qui sépare du passé ? Une façon de raconter l’histoire en évitant l’obstacle de la nostalgie, utilisée à des fins pernicieuses aujourd’hui par les rhétoriques populistes ?
D. O. – Afin de répondre à ta remarque, je voudrais repartir de ce que tu disais plus tôt concernant le dialogue entre présents et passés. Et ajouter un autre élément. Le contre-chant est peut-être, de même que la métamorphose que tu mentionnes, une conséquence de notre nouvelle identité digitale. Mon impression est que nous les vivants (tous autant que nous sommes), par rapport à l’ère analogique désormais révolue, avons réduit, en réalité, la verticalité du temps, et nous prenons toujours moins pour acquise une distance hiérarchique vis-à-vis du passé. Les temps de l’histoire cohabitent au sein de nos consciences numérisées. C’est un sujet qui concerne non seulement la littérature mais encore notre vie même. Alors que nous l’apprenons très peu et mal à l’école, alors que nous l’ignorons, l’histoire est toujours présente pour nous, et ne nous quitte jamais, nous en ressentons le poids énorme sur nos épaules. Et pourtant nous la tutoyons avec une désinvolture excessive, comme on se tutoie entre frères et sœurs. Nous ne posons plus au passé les questions sur l’existence, la politique, l’autobiographie – pourtant nécessaires pour mieux nous orienter – avec les égards agnatiques de la personne de politesse dus à un pater familias. Tout cela a plus à voir avec la conscience historique qu’avec la connaissance, et fait apparaître nos lacunes plus que notre conscience. Dans un tweet, ou une archive multimédia, peut surgir ici et maintenant la photographie d’un chien dans les tranchées, portant un masque à gaz, Dieu sait où dans la Grande Guerre. Les traces sur la pellicule qui autrefois nous auraient donné la conscience du temps sont aujourd’hui un filtre sur Instagram. Là encore, la technologie finit par tout rendre présent. Les temps semblent presque ne plus exister. Il existe des modes à la place. « Tu veux voir avec quel mode ? Avec une teinte sépia ou avec le filtre années 1970 ? Tu veux percevoir les choses avec le filtre noir ou grunge ? » Les hommes et les femmes de l’ère analogique (et j’ai encore eu le temps de faire partie d’entre eux) n’avaient pas ce rapport au passé qui était pour eux davantage matériel, tangible, mis en mémoire et introjecté différemment, mais assurément lointain parce qu’il n’était pas possible de lui redonner vie numériquement. De sorte que la seule manière de le revivre était de l’étudier. Par rapport à eux, nous nous rapportons à notre propre devenir de manière nouvelle et révolutionnaire. Toutefois, dans cette perpétuelle simultanéité, parfois pleine d’ignorance, des temps historiques qui alimente nos consciences, la syntaxe, le raisonnement, le cadre cartésien nous font défaut. Nous avons gagné en proximité mais nous avons perdu en compétence. Nous avons gagné en désintermédiation et en informatisation mais nous avons perdu en termes d’idées. Le style de mon livre, avec sa grammaire un peu cabossée, est aussi une réaction à cette condition nouvelle.
L. G. – Je voudrais que tu expliques comment s’applique exactement à ton travail une citation que tu fais dans ton livre et qui m’a particulièrement frappée, elle est tirée de L’Idéologie allemande (1846) de Marx et Engels, et se trouve page 100 :
Nous ne connaissons qu’une seule science, celle de l’histoire. L’histoire peut être examinée sous deux aspects. On peut la scinder en histoire de la nature et histoire des hommes. Les deux aspects cependant ne sont pas séparables ; aussi longtemps qu’existent les hommes, leur histoire et celle de la nature se conditionnent réciproquement. L’histoire de la nature, ce qu’on désigne par science de la nature, ne nous intéresse pas ici ; par contre, il nous faudra nous occuper en détail de l’histoire des hommes : en effet, presque toute l’idéologie se réduit ou bien à une conception fausse de cette histoire, ou bien à en faire totalement abstraction3.
D. O. – Dans cette citation, la partie qui me concerne vraiment est la suivante : « nous devrons en revanche nous concentrer sur l’histoire des hommes parce que toute l’idéologie se réduit soit à une conception faussée de cette histoire soit à son ignorance pure et simple ». Cet exergue introduit le récit sur Staline (Joseph Adolph Vissarionovich), dans lequel le co-protagoniste est un livre, le Bref cours d’histoire du parti communiste (bolchevique), publié à des millions d’exemplaires en 1938. En matière d’idéologie de l’histoire et de falsification des faits, c’était un mode d’emploi exemplaire. Ce qui m’intéressait, c’était de le placer au centre d’une réflexion narrative sur le rapport entre militants et histoire. De façon générale, les communistes, leurs enfants et leurs petits-enfants ont eu une mauvaise connaissance de l’histoire du communisme. Ils en ont souvent appris une version orthodoxe, canonisée, manipulée. C’est une histoire longue. Elle commence dans les années 1930 en Union Soviétique, lorsque Staline décida qu’il était temps d’opérer des purges et une normalisation y compris au sein des études historiques, lorsqu’il comprit que, pour contrôler les communistes en Russie comme à l’étranger, il fallait en contrôler aussi l’histoire, en faire émerger une version unique, un discours avec ses liturgies officielles et les excommunications qui vont avec.
L. G. – Je voudrais également que tu commentes une autre citation, tirée d’un article de Neal Ascherson dans la London Review of Books, que tu cites aux pages 175-176 de ton livre :
Les interprétations de 1917 et de ses conséquences ont tellement changé qu’elles sont devenues presque méconnaissables. La majeure partie des lecteurs contemporains d’histoire s’accorde probablement sur le fait que la “véritable” révolution fut celle de février 1917, et que la prise de pouvoir d’octobre par les bolcheviques ne fut pas grand chose d’autre qu’un coup d’état opportuniste. De plus, l’image de Lénine dans l’histoire est devenue de plus en plus négative. Des décennies durant, les communistes d’opposition et les leaders post-stalinistes ont condamné les abus de pouvoir en les décrivant comme des “déviations des normes léninistes”. La mode aujourd’hui est toutefois de remiser cette approche comme une pure hypocrisie intellectuelle. Lénine, dit-on, n’offrit en aucune manière une alternative au stalinisme.
C’est Lénine, au contraire, qui créa le dispositif d’oppression inhumaine que Staline – quoiqu’à une échelle plus vaste – continuerait simplement de diriger de la seule manière qui avait été conçue pour mener cette direction. C’est Lénine qui institua le monopole bolchevique du pouvoir politique, c’est lui qui établit le précédent selon lequel quiconque critiquait ce monopole était un “contre-révolutionnaire”, c’est lui encore qui enferma les bolcheviques dans l’illusion fatale de “se substituer” à une classe laborieuse qui, dès 1921, avait cessé d’exister. C’est Lénine qui, durant la guerre civile, autorisa la terreur rouge – des fusillades, des enlèvements de proches – contre les ennemis du peuple. J’ai le sentiment que cette approche est trop grossière pour durer dans le temps. La révolution bolchevique a été plus “authentique” et plus populaire que ce que nous sommes prêts à admettre aujourd’hui ; juger l’histoire soviétique comme une chaîne d’homicides est juste une excuse pour ne pas réfléchir à son sujet. […] Le jour où, si ce jour arrive, une atmosphère révolutionnaire, inenvisageable à présent, reviendra, les jeunes hommes et femmes pourront alors lire et comprendre Trotski et Deutscher d’une manière qui ne nous est plus permise4.
D. O. – Les remarques d’Ascherson ont le mérite de me rappeler mes limites, nos limites, aujourd’hui, lorsqu’on se confronte à tous les différents aspects de cette histoire. Nous sommes encore trop pleinement dans l’ombre de la chute du Mur de Berlin, et de la fin des régimes du socialisme réel, pour pouvoir évaluer de façon critique, c’est-à-dire objective, les différentes dimensions de la saison révolutionnaire de la fin du XIXe et du début XXe siècle ; une époque où le bolchevisme ne fut qu’une variable, une possibilité, bien des années avant de devenir la seule possibilité. Pour moi Octobre n’est qu’une révolution parmi tant d’autres. Celle qui a eu le dessus. Celle qui a pris le pouvoir, puis est devenue mythe et idéologie, technique du parti et de l’État. En réalité, j’ai écrit tout le livre en pensant aux modèles révolutionnaires non bolcheviques qui ont fleuri durant cette période (les Soviets, les conseils d’usine gramsciens, Rosa Luxemburg…) et que le bolchevisme a balayés.
L. G. – À la page 40, tu mentionnes Borges qui cite Chesterton :
l’homme sait qu’il se trouve dans l’homme des nuances plus déconcertantes, plus innombrables et plus indécises que les couleurs d’une forêt en automne. […] Il croit toutefois que ces nuances, dans leurs fusions et transformations diverses et variées, peuvent être représentées avec précision grâce à un mécanisme arbitraire de grognements et de cris, il croit que depuis l’intime […] émergent vraiment des bruits qui expriment tous les mystères de la mémoire et toutes les agonies du désir.
D. O. – Au terme de la vie, lorsque le silence s’arroge une victoire connue d’avance, on se retourne vers le passé et la nature mystérieusement bruyante de l’homme nous surprend. Il aurait peut-être mieux valu s’adapter au silence et économiser nos énergies mais, si nous avons fait tant de bruit, alors au moins il faut que cela en ait valu la peine, que cela n’ait pas été en vain.
L. G. – Très bien ; mais en ce qui concerne le « mécanisme arbitraire » qui, d’après Chesterton, est nécessaire pour essayer de restituer ce bruissement, toi, Davide Orecchio, as-tu la sensation de t’en être saisi, as-tu la sensation de dominer avec suffisamment d’aisance et d’assurance les libertés que tu as prises pour construire ta propre liberté de composition ? Et pour aller encore plus loin, as-tu la sensation d’avoir trouvé, avec ton approche historiographique si personnelle et « créative », une voie qui permet de relire la révolution russe ? Et en partant de là, de cette idée de relecture, des nouvelles clés pour décrypter aussi des dimensions de l’histoire présente ?
D. O. – Je me sens pleinement conscient de ma méthode sur un plan esthétique, pour paraphraser l’un de tes livres : sur le plan de l’invention pure. Et j’ai aussi la sensation d’avoir atteint un certain équilibre entre honnêteté historiographique et liberté de la narration. Quant aux relectures de la Révolution russe et d’autres événements, ce n’est pas à moi de dire si ma clé ouvre, ou pas, des portes. Il me semble en tout cas que pour un narrateur – pas pour un historien donc – il peut y avoir des suggestions intéressantes à saisir.
Notes
1
Paru chez Minimum Fax en 2017, le livre, finaliste pour les prix Napoli et Bergamo, a aussi été sélectionné pour le prix Campiello.
2
N.d.t. :il s’agit d’Ivar Oddone (1923-2011), résistant rendu célèbre par Italo Calvino qui en fit l’un des personnages du Sentier des nids d’araignées, 1947.
3
Nous reprenons ici la traduction française de Renée Cartelle et Gilbert Badia (Paris, Les Éditions sociales, 1952).
4
Neil Ascherson, « Victory in Defeat », London Review of Books, vol. 26, n° 23, 2 décembre 2004, p. 3-6 (traduit par D.O).