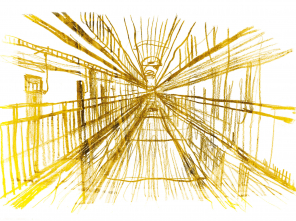Alexis Grandhaie est né en 1965 dans une famille ouvrière des usines de filature de Haute-Saône. Rien ne le prédestinait à rejoindre l’administration pénitentiaire, « la Pénitentiaire », sinon la nécessité de trouver un travail dans une période de crise économique. Surveillant par défaut, il devient très vite syndicaliste par conviction, pour transformer cette « prison qui broie des vies », tant celles des détenus que celles de ses collègues. Secrétaire général de la CGT de 1991 à 2000, puis syndicaliste engagé, il participe aux différents mouvements sociaux autour des prisons, avec un maître-mot : revoir les missions du surveillant de prison.
Sociologue, Camille Lancelevée a consacré plusieurs recherches à la question carcérale, en s’intéressant plus particulièrement aux conditions matérielles d’accès aux droits en détention. Sa thèse de doctorat a porté sur la santé mentale en milieu carcéral en France et en Allemagne, elle y étudie l’articulation des pratiques pénitentiaires et soignantes et s’interroge sur les transformations contemporaines d’une institution pénitentiaire devenue « asile », c’est-à-dire un lieu dans lequel s’entrelacent la peine et le soin dans des agencements insolites, mais aussi l’un des derniers lieux d’accueil de certaines formes de folie.
L’entretien a lieu au domicile d’Alexis Grandhaie, à Nantes, le 20 juin 2017. Dans la fraîche pénombre d’un appartement protégé de la canicule, la rencontre dure près de trois heures. La discussion nous amène dans les coursives de la maison d’arrêt de Dijon et de Fresnes dans les années 1980, puis sur différents piquets de grève, dans les bureaux feutrés de la direction de l’administration pénitentiaire, et enfin derrière les murs de la maison d’arrêt de Nantes dans les années 2000. Les échanges se poursuivent ensuite, par mail et par téléphone. C’est l’occasion de revoir ensemble le texte de l’entretien, raccourci et édité à partir d’une transcription brute de l’enregistrement, mais aussi de poursuivre la discussion sur l’actualité des prisons françaises, qui connaissent en février 2018 un épisode de grève de surveillants particulièrement intense.
Camille Lancelevée – Au milieu des années 1980, vous devenez surveillant. Qu’est-ce qui a motivé ce choix de carrière ?
Alexis Grandhaie – C’était en réalité un non-choix ! Je viens de Haute-Saône, d’une famille pour laquelle les études n’étaient pas la priorité, j’ai fait mon service militaire assez rapidement et puis la question s’est posée de savoir que faire… On est en 1985, en pleine crise de l’emploi. Je passe donc une douzaine de concours, j’en réussis quelques-uns, je choisis celui-ci parce qu’il était un peu mieux payé en catégorie C. Voilà ! J’ai 19 ans, et je n’ai à peu près aucune idée de ce qui m’attend. À l’époque on ne nous vantait pas un métier « riche de contact » : c’était surveillant, point… En réalité, c’est même ma sœur qui a vu l’information sur un panneau municipal et m’a inscrit au concours ! Dans les années 1980, les promotions s’enchaînaient : deux mois de formation théorique à Fleury-Mérogis, deux mois de formation pratique, pour moi à la maison d’arrêt de Dijon. Ça tournait, il fallait du personnel pour remplacer les départs à la retraite. Après 1990 aussi pour faire tourner les nouveaux établissements du programme 13 0001.
– Vous mettez alors pour la première fois les pieds en prison. Quel souvenir en gardez-vous ?
– Un souvenir très contrasté : on était très encadrés à l’époque, vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec notre formateur. Ma formatrice était une vraie maman poule, très gentille, elle nous confiait à de vieux surveillants. Tout de suite, je me suis senti contraint de me couler dans le moule de la vieille machine pénitentiaire : il faut faire comme les autres, être solidaire avec les collègues, ne pas discuter avec les détenus. Je me souviens d’avoir eu l’impression que le système me sautait à la gorge. Et pour ajouter à la confusion, je ne pouvais pas m’empêcher de me dire que j’aurais pu basculer de l’autre côté, faire des conneries comme tout le monde et me retrouver en taule. Bref, je me demandais vraiment ce que je faisais là, si je ne ferais pas mieux de me barrer… La chance que j’ai eue alors, c’est que sans trop me donner de peine, je me suis retrouvé bien classé – sans grand mérite. Ainsi j’ai pu éviter Fleury, Fresnes, les Baumettes, Lyon : les vieux établissements dans lesquels se retrouvaient les derniers de la promotion.
– Et vous vous retrouvez à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, un établissement un peu à part, dans lequel le rôle du surveillant est sans doute très différent ?
– Oui, c’était un établissement très particulier, j’ai eu cette chance d’être baigné dans un univers médical, avec des infirmières, des aides-soignantes – à une époque où il n’y avait pas encore de femmes surveillantes dans les prisons pour hommes2. Je voyais mes collègues en baver dans les coursives de la prison de Fresnes, à courir dans tous les sens ; moi, j’avais maximum 40 détenus, qu’on appelait d’ailleurs des « malades ». C’était avant la réforme de la santé3, ils venaient de toute la France. On avait beaucoup d’orthopédie, de types qui s’étaient pris une rafale lors d’un braquage, et puis des maladies chroniques qui surviennent en détention : diabète, cancer… J’ai rencontré des types jeunes, je me souviens d’un en particulier, qui avait mon âge et un parcours tout con : des petites conneries, des petits braquages, jusqu’à ce que ça tourne vraiment mal. J’aurais pu être à sa place ! Je ne sais pas si j’aurais pu faire des braquages, mais ce que je veux dire, c’est que tout est sur un fil à la fin de l’adolescence… À l’hôpital de Fresnes, le travail était différent : on parlait avec les détenus malades d’une autre façon que dans une taule. Ça n’avait aucun rapport avec les surveillants d’étage qui n’ont pas le temps, qui ne sont pas formés à répondre aux questions même basiques des détenus, et qui incarnent la répression carcérale : après tout ce sont eux qui referment les portes des cellules…
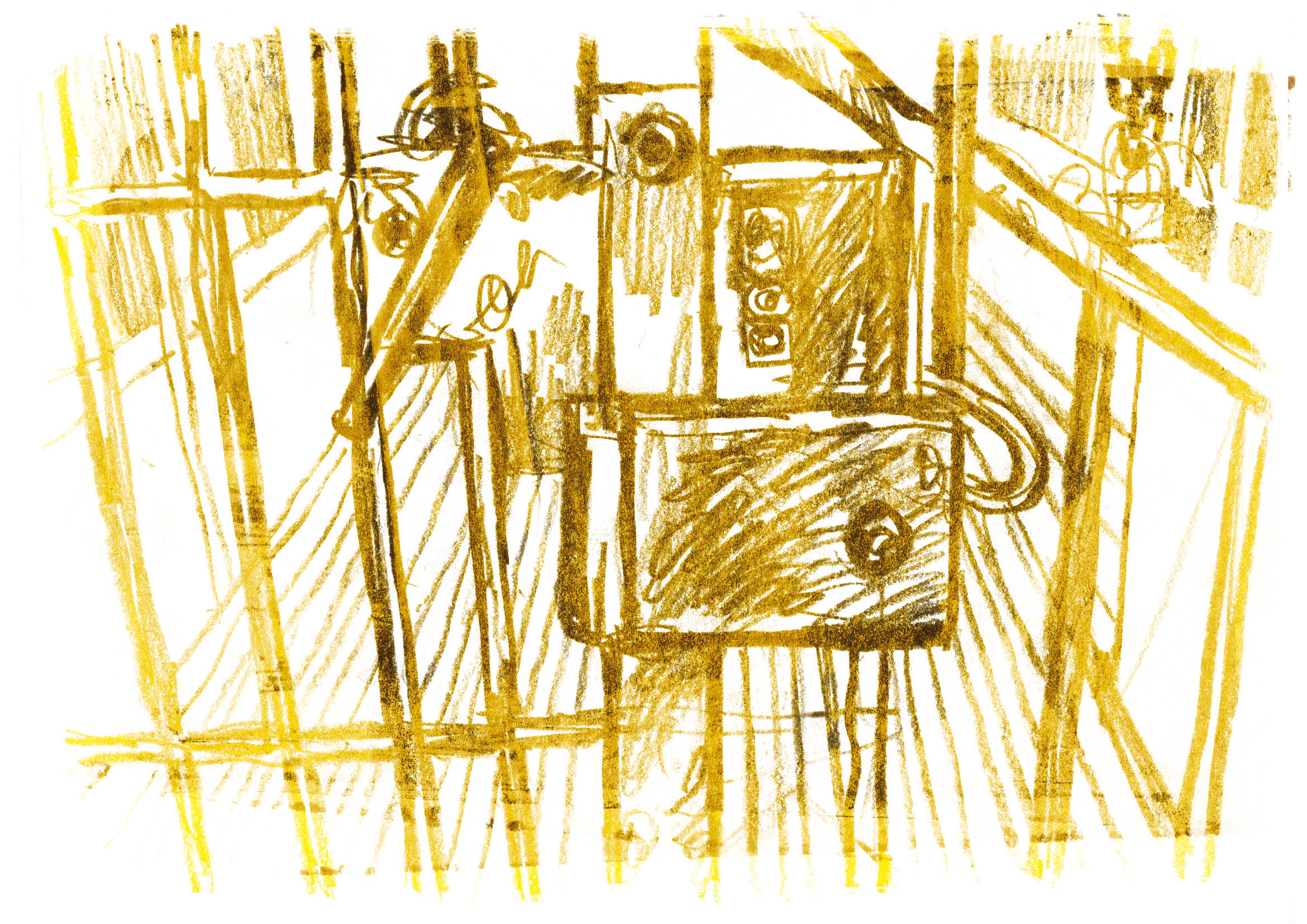
– À l’époque, les surveillants avaient la possibilité de passer le concours d’aide-soignant : est-ce une perspective de carrière que vous avez envisagée ?
– Non. C’était un cadre de travail sympathique, mais ça n’était quand même pas tout à fait un service hospitalier : les infirmières étaient pénitentiaires, il y avait beaucoup de bonnes sœurs parmi elles, mais on ne peut pas dire que c’était un milieu progressiste… Et surtout j’ai pris une autre voie : j’ai découvert le syndicalisme pendant le mouvement de 1988 – à mon avis, le seul mouvement digne de ce nom chez les surveillants ! Pendant ces six semaines de débrayages, j’ai rencontré la CGT [Confédération Générale du Travail] et j’ai été assez séduit par leur discours progressiste. Il faisait écho à ce que j’entendais dans ma jeunesse, dans ce milieu ouvrier de gauche du monde des filatures. Au final, le conflit s’est mal terminé – quelques mesures catégorielles pour calmer le jeu – mais j’ai pris ma carte à la CGT et très vite je suis devenu cadre parce que le syndicat recrutait des jeunes prêts à vivre à Paris.
– Lorsque vous découvrez la CGT, c’est un syndicat très minoritaire chez les surveillants pénitentiaires ?
– Oui, c’est une organisation embryonnaire, à cette époque-là, qui sort tout juste d’une période de crise : en 1983, la confédération a retiré le sigle à la Fédération nationale des personnels pénitentiaires et de justice [FNPPJ]. Il faut dire que le président d’honneur, Aimé Pastre était un type complexe : c’était un grand résistant, mais en même temps, au fil des années, il avait viré à droite, jusqu’à appeler à voter Giscard en 1981 et à demander le maintien de la peine de mort… Ça faisait tâche dans la CGT… Donc en 1983, il y a scission : une branche crée ce qui deviendra l’UFAP [Union Fédérale Autonome Pénitentiaire], l’autre l’UGSP-CGT [Union Générale des Syndicats Pénitentiaires], dont on est toujours l’émanation aujourd’hui. En 1985, quand je suis rentré dans la Pénitentiaire, le syndicat majoritaire, à 60 %, c’était FO [Force ouvrière] ! Et pour être très honnête, au départ j’ai pris d’abord une carte FO, parce que c’était comme ça, tout le monde faisait ça4. Il y avait ce discours : « Viens chez nous, tu seras titularisé, on te mettra où tu veux ! ». C’était – et c’est toujours aujourd’hui – un système de recrutement très organisé, à la limite de la corruption. Vous verriez comment les jeunes se font happer, alpaguer, guider vers les syndicats pendant leur formation !
– Et quel est-il, à l’époque, ce discours qui vous convainc de rejoindre la CGT ?
– Ah ! Il y avait une ambiance particulière, des gens solides intellectuellement et politiquement, qui ont connu une vraie CGT, une façon de travailler, de revendiquer, de sortir de notre petit univers pénitentiaire pour aller vers les unions locales ou départementales. Ils portaient un discours très revendicatif sur les missions, qui redonnait du sens au métier de surveillant et s’interrogeait sur notre rôle : le maton-porte-clefs, pourquoi ? Et puis il y avait cette revendication, un brin utopique, qu’il n’y ait ni surveillants, ni travailleurs sociaux, mais une seule catégorie en capacité de faire les deux. C’est une idée qui m’a séduit pendant de longues années, mais qui a complètement disparu de nos revendications au début des années 1990. Ça m’a fait très mal d’ailleurs, parce que c’est venu des collègues éducateurs à qui on proposait d’adhérer à la CGT qui réclamaient des revendications spécifiques pour eux ! À l’époque on n’avait pas de revendications spécifiques pour les surveillants non plus, on militait pour la création d’un autre corps, mais voilà, le clivage s’est creusé, jusqu’à ce que ça scissionne vraiment5. C’est vraiment dommage, mais il faut reconnaître que le ver était dans le fruit dès le départ…
– Le rôle du syndicat, c’est d’organiser les mobilisations mais aussi d’être un rouage entre les personnels et la direction de l’administration pénitentiaire. Quelles étaient les relations avec celle-ci ?
– C’est étrange, mais j’arrive parfois à regretter cette époque. C’était très « à la papa », à la limite du clientélisme : tu me donnes ça, je te donne ça… Il y avait rarement de débat, et au fond, on discutait surtout de ressources humaines, avec François Antonini, le fidèle des fidèles DRH. Le DAP [Directeur de l’Administration pénitentiaire] était alors vu comme l’égal des représentants des syndicats, quand il y avait quelque chose à demander, c’était auprès du DAP. C’est une époque où il y a eu de grands DAP, qui tenaient des discours de gauche ! Je pense à Jean-Claude Karsenty, et même, dans son style, à Jean-Pierre Dintilhac ou Bernard Prévost. On ne débattait pas avec eux, on ne discutait pas des missions, mais ils avaient un discours articulé, intéressant. Aujourd’hui, il y a des groupes de travail deux à trois fois par semaine, sur un oui, sur un non et ça ne fait pas plus avancer les choses. À l’époque, quand il y en avait un par mois, c’était déjà Byzance ! Ça n’était peut-être pas plus mal, parce qu’on se concentrait un peu plus sur la vie avec nos sections. On réfléchissait, on produisait un travail de qualité… Il faut dire que quand je suis arrivé à la CGT, j’ai été guidé par Désiré Derensy, le secrétaire général, que j’admirais beaucoup. Il était rentré en 1968 dans la Pénitentiaire et c’était un puits de science. On avait aussi des formations maison par Christian Carlier6 sur l’histoire pénitentiaire. Pour vous donner un exemple concret, c’est grâce à eux que j’ai compris d’où venait le statut spécial7, avec l’ordonnance du 6 août 1958 et comment il était imbriqué dans la guerre d’Algérie. Ça donne évidemment une profondeur politique quand on revendique l’abrogation de ce statut spécial. Ce sont deux personnes qui m’ont beaucoup appris, qui m’ont fait lire, de l’histoire, de la sociologie, qui m’ont permis de devenir ce que je suis devenu. Je dois aussi beaucoup à ma compagne, Lise, qui m’a amené vers le théâtre, la culture, tout ce qui permet de ne pas rester enfermé dans son petit monde.
– Vous devenez secrétaire général dès 1992 à 25 ans et vous allez le rester jusqu’en 2000. Comment se passe cette période, quels sont alors les combats ?
– J’étais très jeune, mais c’était une question de survie pour le syndicat qui était alors mal en point. On était une équipe de jeunes, mais il y avait aussi quelques anciens, sur lesquels on s’appuyait, qui nous rassuraient. Notre positionnement n’était pas facile, parce qu’on était encore très identifié comme des « rouges », ce qui ne passait pas trop dans ce milieu… Et en 1990, l’UFAP était déjà passé devant FO avec une façon de militer qui nous rendait le travail très difficile et qui perdure toujours… Face à une telle grosse machine, on a eu du mal à survivre, on n’était pas assez nombreux pour faire le poids. On s’est concentré sur certains combats : entre 1988 et 1995, il y a eu quasiment dix conflits. À l’hiver 1994-1995, l’un a duré deux mois. On était là, à se battre. Mais on sentait déjà que le vent avait tourné, qu’on ne parvenait plus à se mettre d’accord que sur des revendications catégorielles. Au final, en 1996, quand on a obtenu le 1/5e, il y’a eu un gros sentiment de déception8. C’était important, mais c’était tellement loin de ce qu’on avait espéré en termes d’évolution des missions. Il y a heureusement des choses qui ont évolué : la réforme de la santé, les préservatifs dans les UCSA, les unités de visite familiales… mais ces évolutions, ce n’étaient pas nous qui les portions. On s’est contenté de les soutenir, bien seuls d’ailleurs ! Malgré tout, on a gardé un document d’orientation assez fourni, avec un socle de revendications sur les missions, mais ça n’était pas facile de garder cette identité politique, tout nous poussait à devenir un syndicat de service comme les autres…
– Pourquoi quittez-vous le poste de secrétaire général en 2000 ?
– Parce que j’étais épuisé. Un ras-le-bol syndical en quelque sorte. L’impression que la part de réflexion était ensevelie sous le quotidien. J’ai eu le sentiment de devenir une sorte d’assistante sociale et de passer mon temps à régler des cas particuliers. À ce moment-là, on m’a proposé de faire une carrière syndicale au sein de la CGT, j’ai hésité et finalement nous avons décidé avec ma compagne de nous installer à Nantes ; j’ai atterri comme lieutenant dans la vieille maison d’arrêt de Nantes, rue Descartes, qui fermera quelques années plus tard. Et je me suis retrouvé absorbé, comme tous les lieutenants de maison d’arrêt, par un boulot dingue : vous connaissez la blague « comment faire rentrer quatre éléphants dans une 2CV » ?
– Vous parlez de surpopulation ?
– Oui, c’était complètement fou. À l’époque, la maison d’arrêt pouvait accueillir 320 personnes et au moment de sa fermeture, on atteignait régulièrement les 400 détenus. Le plus terrible, c’est qu’on s’habitue à cette situation. Au début des années 2000, on rédigeait des tracts dès qu’on arrivait à 350 détenus, et hop, on réussissait à obtenir un désencombrement sur le centre de détention. Et petit à petit, on ne déclenchait plus l’alerte qu’à 380, 400 détenus. Dans un tel contexte, on passe son temps à changer des gens de cellule parce qu’ils ne s’entendent pas… le travail d’encadrement se résume à parler avec les Premiers surveillants [i.e. surveillants appartenant au corps d’encadrement des personnels de surveillance]. J’essayais d’aller voir les collègues dans les étages, parce que j’étais toujours syndicaliste, mais le boulot était très segmenté, on n’avait pas vraiment le temps d’aider les plus jeunes à absorber toutes les nouvelles réglementations qui permettaient de faire sortir la prison de la préhistoire.
– Mais pourquoi alors avoir choisi une maison d’arrêt9 ? Vous auriez peut-être été plus tranquille en centre de détention ?
– Parce que la maison d’arrêt était plus près de chez moi. Et parce que je n’aime pas le rythme du centre de détention. Je n’aime pas l’idée de passer ma vie en parallèle avec des détenus enfermés pour de longues peines, ça me déprime complètement. Il y a peut-être un effet miroir. En maison d’arrêt, le côté désespérant, c’est qu’on voit les mêmes gars revenir sans cesse. C’est plus usant aussi, parce qu’il y a trop de détenus, mais le travail y est plus dynamique. Et puis la maison d’arrêt était construite en étoile avec un rond-point central, on côtoyait facilement les avocats, les soignants, qui venaient nous voir quand il y avait un souci. D’ailleurs, je regrette presque d’avoir été l’initiateur des luttes à Nantes pour la fermeture de cette prison. Elle aurait fermé de toute façon, mais on a peut-être accéléré le processus.
– C’est différent dans la nouvelle maison d’arrêt de Nantes ?
– Ah oui, complètement ! C’est une prison assez typique de ce qui se fait aujourd’hui, loin du centre-ville, calculée pour incarcérer le maximum de détenus avec le moins de personnel possible. C’est très segmenté, avec des zones d’hébergement très éloignées des zones de parloirs, donc avec une perte en qualité d’échange entre professionnels. Et puis il y a toutes les questions politiques que posent les partenariats publics-privés10 ! On s’est battus dans les années 1990 contre la gestion déléguée – et en fait contre la construction de nouveaux établissements. On dénonçait autant l’entrée de l’entreprise privée en prison que le fait que ça venait priver les collègues surveillants de nombreuses possibilités de carrière : dans les prisons publiques, ils pouvaient devenir cuisiniers, chefs de travaux, jardiniers même ! Ça permettait vraiment d’enrichir la palette du boulot de surveillant. Or, avec les PPP, on a franchi encore un pas vers la déshumanisation. Il y a un côté « usine carcérale », tout le contraire de ce qui serait nécessaire : il faut arrêter de faire tourner les surveillants, parce que la conséquence, c’est qu’ils ne connaissent plus les détenus… Il faudrait de petits établissements, un travail en unité de vie, avec des équipes pluridisciplinaires. Mais on prêche dans le désert. Depuis le plan 13 000 de 1990 ça ne nous convient plus du tout au niveau architectural. Les plans suivants ont été pire encore !
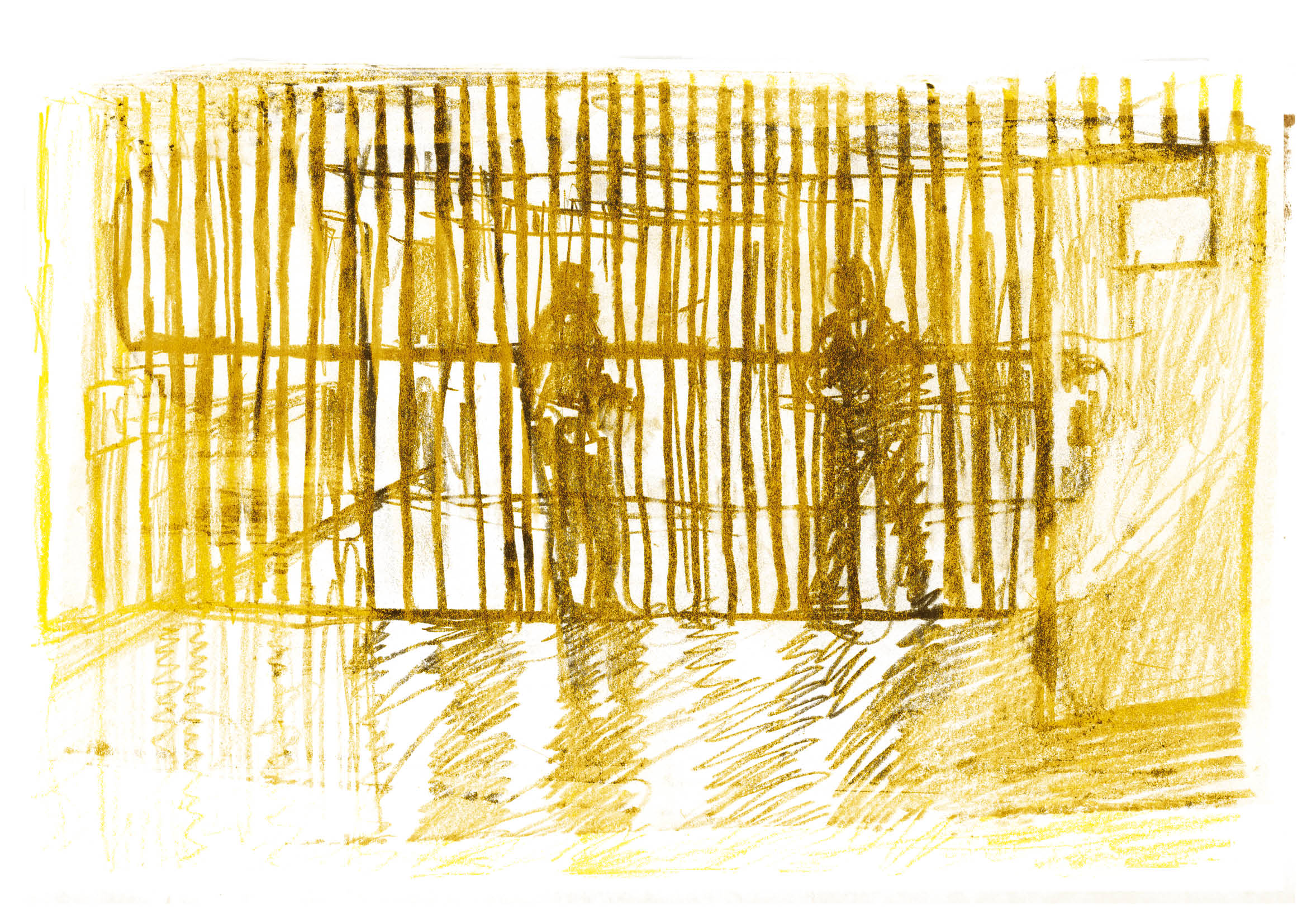
– Pour revenir au combat syndical, les années 2000 sont une période de forte mobilisation publique : commissions parlementaires, réformes pénitentiaires. Est-ce que vous restez à l’écart de ce mouvement ?
– Non, évidemment, je suis tout ça de près, je reste syndicaliste ! 2000, c’est la publication du bouquin de Véronique Vasseur11 – un bien mauvais livre d’ailleurs – et puis tout ce qui se met en place : les missions parlementaires, etc. La condition pénitentiaire redevient scandaleuse. C’est une période où l’OIP [Observatoire International des Prisons] a des entrées à l’Assemblée, on a aussi des relais parlementaires, et Marylise Lebranchu est ministre de la Justice. J’ai eu un coup de cœur personnel pour elle : elle portait une vision progressiste… Elisabeth Guigou12 avant elle aussi d’ailleurs, elle s’appuyait sur des conseillers sérieux, Christian Vigouroux, Jean-François Beynel… Et puis honnêtement, j’ai eu aussi beaucoup de respect pour Jacques Toubon13 : certes, c’était un homme de droite, mais il était vraiment honnête, et il était au fond bien plus progressiste que ne le sont devenus les gouvernements, y compris socialistes. On pouvait encore parler d’autre chose que de sécurité ! Mais la loi que préparait Marylise Lebranchu14 est venue se fracasser sur les présidentielles de 2002. Et ensuite quel désenchantement… La question carcérale, c’est devenu : « construire des places » et « renforcer la sécurité », point. On se traîne cet héritage jusqu’à aujourd’hui.
– Il y a quand même l’épisode des « États généraux de la condition pénitentiaire » organisés par l’Observatoire International des Prisons (OIP) en 2006-2007. La CGT est alors le seul syndicat pénitentiaire qui participe à cette grande consultation…
– Ça a été un débat infernal dans le syndicat ! J’étais en commission exécutive nationale à l’époque, et on a gagné d’un cheveu pour participer aux États généraux. J’ai fait l’intermédiaire avec quelques anciens pour convaincre les collègues, mais il y a une crispation. Beaucoup de collègues disaient : « On n’a rien à faire avec l’OIP, il ne faut pas y aller ! ». Céline Verzeletti, la secrétaire générale de l’époque était un peu en décalage : une femme jeune, venant de la maison d’arrêt de Versailles, avec un cœur balançant plutôt du côté des travailleurs sociaux. Elle s’est mise dans le nez plein de collègues de sa propre corporation. Je la comprends, moi aussi je me suis dit pendant toute une époque : « Qu’est-ce que tu fous avec ces cons-là, passe un autre concours, tire-toi ! », mais ça n’est pas juste de penser comme ça, c’est bien plus compliqué. Et à la CGT justement, on trouve encore des gens qui pensent autrement, qui parlent autrement. Enfin bref, oui, on a participé aux États généraux… mais c’est comme pour tout le reste, il faut des relais politiques, ce n’est pas l’OIP ou la CGT qui vont changer le cours des choses.
– Et le gouvernement, en mai 2007, c’est celui de Nicolas Sarkozy et François Fillon…
Une période noire pour la prison, celle d’un vrai tournant sécuritaire. C’est l’époque des slogans : la « tolérance zéro » remplit les prisons et nous met dans une situation intenable. Depuis lors, on ne sort plus de ce discours et de ces lois sécuritaires. Plus aucun gouvernement n’ose s’écarter de ce chemin, c’est terrible. Pas même la gauche de retour au pouvoir : prenez l’exemple du « livre blanc » [sur l’immobilier pénitentiaire début 2017] ! Je vais être assez réducteur, mais pour moi, ce livre blanc a été écrit pour créer des places de prison, pour garantir un projet de loi de finances… Dans le contexte des attentats, du terrorisme, ça ne va pas en s’arrangeant.
– Donc c’est une période où vous perdez l’espoir d’une possible réforme ?
– Non, je ne suis pas dans le désespoir ! Je garde espoir à chaque tournant. Parce qu’il se passe des choses positives, on continue à réfléchir, à enfoncer des coins. Je me souviens par exemple du relevé de conclusions qu’on a signé avec Christiane Taubira après la « conférence de consensus » [en 2013], on avait fourni un travail colossal. Et on avait réussi à faire inclure dans la plateforme une série de revendications sur les missions de service public, sur le rôle du surveillant dans la préparation à la réinsertion, le respect de la dignité des détenus, la prévention de la récidive. Bon, après je dois avouer que ça a été aussi une grande déception. Je pensais que Jean-Jacques Urvoas [garde des Sceaux entre janvier 2016 et mai 2017] en ferait quelque-chose de bien. C’était un homme impliqué, qui s’intéressait à la question carcérale depuis longtemps. Mais il n’en a rien fait. Ou plutôt, il a fait comme les autres avant lui, le dos rond devant l’UFAP et FO et leurs revendications simplistes : du fric, des emplois, des équipements sécuritaires, des mesures législatives contre les détenus et de nouvelles missions pour échapper à la détention ! Le pire – je vais être un peu dur – c’est qu’il y a aussi à la CGT un paquet de militants qui ne pensent pas autrement, qui n’ont plus aucune vision. Ça s’appauvrit, y compris chez nous !
– Revenons alors à l’essentiel : pourquoi vous battez-vous, quel est votre rêve ? Quelle serait la « bonne réforme » ? À quoi ressemblerait une « bonne prison » ?
– La bonne prison, ça n’existe pas ! Je ne rêve pas du tout de ça. La prison, ça n’a jamais fait de bien à personne. Évidemment, il y a des gens qui ne seraient pas devenus ce qu’ils sont sans passer par la prison – je pense à mon ami Didier Chamizo par exemple, l’ancien artificier d’Action directe, un écorché-vif qui est devenu peintre –, mais il ne faut pas se voiler la face : la prison broie des vies. D’ailleurs il faudrait rompre avec cette idée qu’il faut en baver, expier une faute. La bonne prison, ça n’est pas mon combat. Moi je rêve simplement d’une prise de conscience sur le fait qu’il y a trop de détenus, qu’il faut enfermer le moins de gens possible, qu’on ne peut pas continuer cette course à la sécurité et construire la politique pénale autour de faits divers dramatiques. Je comprends que pour les longues peines, c’est encore un peu compliqué à envisager. En revanche, pour les courtes peines … Il y en a trop qui n’ont rien à faire entre quatre murs. Mais pour cela, il faut des relais politiques. Et en ce moment, c’est là que le bât blesse. La République en marche a raflé la majorité des sièges à l’Assemblée nationale, les autres cherchent des arguments pour désosser le plan Macron, mais le reste ne les intéresse pas vraiment. Or, le plan Macron , c’est vraiment une arnaque : c’est un plan qui se présente comme progressiste mais qui poursuit l’empilement des lois sécuritaires et la construction de nouvelles prisons : une vision toujours carcérale de la politique pénale !
– Cette grande politique ambitieuse ne semble pas à l’horizon, mais que pensez-vous de projets plus modestes qui entendent changer les rapports entre personnes détenues et surveillants, comme les modules de respect ?
– Les modules de respect, je dis oui… et bof ! Oui, parce qu’on réfléchit un peu aux missions du surveillant. Bof, parce qu’il faut voir les effets pervers : si on met d’un côté ceux qui se comportent bien et de l’autre les détenus les plus difficiles, il y a aussi d’un côté des surveillants qui ne bossent qu’avec des « bons » et de l’autre qu’avec des « méchants » ! Ça dualise la prison. C’est une logique pernicieuse que FO et l’UFAP aimeraient appliquer partout. Leur grand projet – et le « livre blanc » va droit dans cette direction – c’est la cartographie pénitentiaire : classer les établissements par niveau de sécurité. Or, dans ma région, si le centre de détention de Rennes ou d’Argentan est classé en niveau de sécurité 4 et celui de Nantes ou de Lorient en niveau 2, on va envoyer à Rennes les détenus « compliqués » et ils vont nous envoyer leurs « gentils ». Outre le fait que ça va saccager les liens familiaux, ça va surtout exploser de toute part ! Par expérience, un gars qui n’a pas envie d’être à un endroit, il est prêt à tout, y compris à monter sur le toit de la promenade dès la première journée. Et qu’est-ce qu’on fait dans les prisons les plus sécurisées ? On s’équipe de tasers et de chiens ? Ça n’est pas ma conception du travail de surveillant.
– L’administration pénitentiaire parle comme vous de recentrer les surveillants sur leur cœur de mission… Vous avez l’air dubitatif ?
– On fait des paquets de groupes de travail là-dessus. Mais c’est de la novlangue ! Ils savent très bien qu’ils n’ont pas les moyens de mener ce genre de réforme. Ces dernières années, malgré tous ces comités Théodule sur le cœur de métier, tous les nouveaux effectifs ont été mis soit dans les nouveaux établissements, soit dans les « nouvelles missions ». Mais certainement pas dans un renforcement des effectifs dans les détentions existantes ou dans une remise à plat des missions du surveillant. Depuis 2010, c’est la tendance : le ministère de l’Intérieur se décharge d’un tas de missions sur la Pénitentiaire, les translations judiciaires, les transfèrements administratifs, les escortes médicales… Et les collègues applaudissent, parce que ces postes dans les PREJ [Pôles de rattachement des extractions judiciaires] leur permettent de quitter la détention ! C’est comme les collègues qui prennent des postes de nuit pour ne plus voir les détenus, ou ceux qui veulent rejoindre les ERIS [Équipes régionales d’intervention et de sécurité] ou les pôles centralisateurs de surveillance électronique . Vu les conditions actuelles d’exercice, je ne peux pas les blâmer ! Moi aussi, il m’arrive de me dire : « Bordel, t’as traversé tout ce temps dans cette institution ! Comment tu as fait ? ».
– Vous peignez un tableau sombre des prisons actuelles. Comment fait-on pour être un bon surveillant dans ces conditions ?
– C’est une bonne question… Dans l’état actuel des prisons, je répondrais qu’un bon surveillant, c’est un surveillant qui maîtrise l’art du slalom, qui sait se jouer de certaines règles trop rigides, tout en ne commettant pas d’abus de pouvoir. Je vous donne un exemple très quotidien : c’est le surveillant qui passera du tabac d’une cellule à l’autre en maison d’arrêt, même si c’est interdit, pour éviter d’avoir une détention bouillonnante. L’essentiel pour moi, c’est d’avoir une pratique professionnelle qui vise à apaiser la détention, quitte à assouplir certaines règles. Vous me direz : le mauvais surveillant aussi, il joue avec la règle. Oui, mais l’important, pour moi, c’est de voir, au-delà de la règle, le droit et les droits.
– Ce sont les conditions de travail qui expliquent selon vous le mouvement de grève de janvier-février 2018 ? Quel regard portez-vous sur cet épisode de grève ? L’aviez-vous anticipé ?
– C’est toujours difficile de prévoir quand ça va exploser, on est toujours surpris par les mobilisations. Le point de départ, c’est une agression de trois collègues à Vendin-le-Vieil. Mais des agressions, il y en a eu bien d’autres, je vous donne un seul exemple : en janvier [2019] un surveillant s’est fait taillader la gorge à la maison d’arrêt d’Angers. Alors pourquoi celle-ci ? Pourquoi est-ce que cela prend à un moment donné ? C’est assez énigmatique. On peut toujours dire que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, mais il y a tellement d’autres gouttes qui auraient pu le faire déborder… En tout cas, s’il y a un facteur qui explique pourquoi le mouvement a tenu, c’est la réaction franchement nulle de la ministre de la Justice [Nicole Belloubet] ou du DAP [Directeur de l’Administration pénitentiaire] qui l’a conseillée. Des erreurs inouïes, du début à la fin, qui ont embrasé toute la Pénitentiaire ! L’UFAP a aussi une part de responsabilité dans la durée du conflit : ils n’ont pas du tout senti l’ampleur que le mouvement pouvait prendre et comme ils avaient l’oreille de la ministre, ils l’ont aidée à se planter. Par exemple, quand la ministre s’est pointé trois jours après le mouvement sur l’établissement, en apportant une réponse totalement à côté de la plaque : « Les agents qui ont été agressés seront promus ». Ou quand elle a tenté de circonscrire le problème localement, à un détenu radicalisé dans un établissement bien particulier. Ça a mis le feu aux poudres, et dans les semaines qui ont suivi, on n’a quasiment plus parlé de Vendin-le-Vieil, ce sont les maisons d’arrêt qui se sont mobilisées… Fleury-Mérogis, Fresnes, Villepinte, Sequedin... Et ce n’est pas étonnant, c’est là que les conditions de travail sont les plus exécrables.
– C’est en effet dans ces grandes maisons d’arrêt que le mouvement a été le plus suivi, avec des barrages filtrants, des blocages, des dépôts de clefs pendant près de deux semaines. Puis un accord a été signé entre le ministère de la Justice et le syndicat majoritaire, l’UFAP. Qu’en pensez-vous ?
– Il y a deux choses dans cet accord : des mesures catégorielles et des mesures de sécurité. Côté catégoriel, ça ne m’étonne plus : c’est une louche d’emplois par ci, une louche d’indemnités par là. C’est terrible l’incapacité à faire vivre des revendications qui touchent au cœur de la politique pénale. Par exemple, quand on revendique un changement de statut pour les surveillants pénitentiaires [de la catégorie C à la catégorie B], évidemment c’est une mesure catégorielle, mais ce qu’on souhaite surtout, c’est la redéfinition de la mission de service public qui va avec ! Et certainement pas dans le sens de ce que veut FO, qui cherche à aligner le statut sur celui de la police nationale. Ça ne me surprend plus, parce que je suis un vieux de la vieille, mais je suis assez perplexe sur les conflits pénitentiaires et la façon dont on n’aborde pas le sujet de fond : à quoi doivent servir les surveillants ? Comment on s’y prend pour réinsérer les gens qui passent par la prison ? Côté sécurité, on nous a annoncé la création de 1500 places dans des « quartiers étanches » pour les détenus radicalisés. Déjà, je me demande comment ils vont réussir à trouver ces places, il va falloir surcharger ailleurs – et surtout, cela va dans le sens d’une catégorisation des prisons, c’est absurde ! Le problème de la radicalisation et du prosélytisme est lié à celui de la surpopulation. C’est le manque de place qui nous amène à regrouper, à entasser des personnes qui sont là pour des raisons complètement différentes. On en revient au point de départ : il faut réfléchir sérieusement à « qui on met en prison ». Autre exemple qui n’a rien à voir avec le djihadisme : l’évasion de Redoine Faïd de la maison d’arrêt du Réau. FO ou l’UFAP commentent l’affaire en disant : « C’est bien la preuve qu’il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ». Mais il y a une autre leçon à tirer de cette évasion : c’est que la surpopulation carcérale rend la charge de travail insoutenable ! Les agents ont le nez dans le guidon, ils gèrent toute la journée des petits délinquants qui sont chauffés à blanc par la surpopulation… Ils n’ont pas les moyens de connaître comme il faut les gars qui sont enfermés.
– Vous parlez d’une louche d’emplois, il s’agit de l’embauche de 1100 surveillants, c’est une création d’emplois importante, non ?
– Oui. Recruter c’est une bonne chose, à la condition qu’on recrute pour améliorer les missions – et sans augmenter le nombre de personnes détenues. Mais le souci, c’est qu’on n’a pas le vivier pour avoir un personnel de qualité : tous ceux qui le peuvent passent des concours dans la douane, la police, la gendarmerie voire dans les métiers de la sécurité privée avant de passer celui de surveillant ! Donc l’école [École nationale de l’administration pénitentiaire, ENAP] a un mal fou à remplir les promotions et se demande s’il ne faudrait pas supprimer le concours d’entrée. Mais on ne peut pas non plus recruter des abrutis ! J’ai eu récemment une discussion avec deux jeunes de mon entourage, un couple qui vit dans les Deux-Sèvres. Ils sont au chômage, lui a fait de l’informatique, elle du tourisme, et ils ne trouvent pas de boulot. Je leur ai suggéré de passer le concours de surveillant et de demander la prison de Poitiers-Vivonne, pas loin de chez eux. Leur réponse : « Plutôt crever ! ». Ils sont toujours au chômedu plutôt que de rentrer dans la Pénitentiaire ! Donc il faut être un peu honnête : ici le problème des emplois, ce n’est pas qu’on n’en a pas, c’est qu’on n’a personne pour les occuper.
– D’où la nécessité de repenser le métier, de revoir la politique pénale. Cette vision politique a du mal à s’imposer lors des mouvements de grève. Mais ces mouvements permettent peut-être de repolitiser les surveillants pénitentiaires sur le long terme ?
– Objectivement, je n’ai pas ce sentiment. Si la grève a permis à des jeunes de se syndiquer, ça n’est pas chez nous. C’est malheureux, mais je crois que le sentiment qui a pris le dessus à la fin du conflit, c’est la désillusion, l’impression d’avoir été trahis. Je ne retrouve pas ce sentiment de fierté qu’on a pu avoir en 1988 ou en 1992. Ça tient sans doute au fait qu’il y a eu une pluie de sanctions, des retenues sur salaire, des sanctions disciplinaires, des exclusions temporaires... Les collègues sont sortis amers, choqués.
– Vous semblez dire que cette vision sécuritaire de la prison est partagée par la plupart des surveillants. Le discours que vous portez n’arrive plus à convaincre ?
– C’est une vision simpliste qui gagne du terrain… Je me suis dit pendant un certain nombre d’années qu’avec la féminisation des personnels et l’élévation des niveaux de diplôme, les jeunes collègues allaient adhérer à des idées plus progressistes. Mais, en réalité, l’élévation des diplômes est à relativiser, c’est simplement le reflet de l’élévation générale des niveaux de diplôme. Et les femmes n’ont pas apporté la plus-value espérée dans les détentions, car, contrairement à ce qu’on pourrait croire, elles adhèrent aux mêmes discours simplistes que les hommes ! Et il y a la force de la machine pénitentiaire : on croise des élèves, à l’ENAP, qui portent de belles valeurs, mais qui n’arrivent pas à les incarner dans leur boulot. Je suis sûr qu’une bonne partie de mes collègues ont envie d’une autre politique, mais comment les mobiliser ? On essaie de les atteindre autrement, avec des outils qui m’échappent complètement, Facebook, Twitter. Je n’ai pas de compte, parce que je trouve que la façon dont les gens s’insultent sur les réseaux sociaux est détestable, je laisse faire ceux qui savent, Christopher [Dorangeville, actuel secrétaire général de la CGT pénitentiaire] me dit parfois : « On a eu tant de likes sur la page Facebook ». Je comprends que c’est bien, mais je suis de l’époque des assemblées générales, quand on réussissait facilement à réunir 80 à 100 personnes dans chaque établissement… Il faut accepter que les gens ne viennent plus, qu’il faut militer autrement.
– Si je vous comprends bien, il faut militer autrement, mais il faut militer, coûte que coûte ?
– On ne peut pas baisser les bras. Je comprends la désillusion générale par rapport aux syndicats, aux partis, à la politique. J’ai des collègues qui me disent, après 45 ans : « Vivement la retraite, j’en peux plus ! ». Je comprends l’usure, je comprends l’écœurement : ils n’y croient plus, ils sont découragés. Mais en même temps… face à un boulot si difficile et si… inutile parfois, il faut essayer de faire bouger les choses : on ne peut pas se contenter de dire que c’est un « métier de merde » et y retourner tous les jours… Il faut se battre !
Notes
1
Le programme 13 000 (ou programme Chalandon, du nom du garde des Sceaux de l’époque) est un programme immobilier de construction d’établissements pénitentiaires initié par la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, qui a, par ailleurs, entériné la possibilité de concéder à des opérateurs privés certaines fonctions (santé, travail pénitentiaire, maintenance, restauration...). 25 nouveaux établissements pénitentiaires (dont 21 en gestion déléguée) ont ainsi été mis en service début des années 1990.
2
Le recrutement de femmes surveillantes dans les prisons pour hommes est possible depuis la fin des années 1990. Le recrutement a été unifié en 1997, avec une exception majeure : en dehors des postes de d’encadrement, les hommes surveillants n’ont pas la possibilité de travailler dans les espaces de détention réservés aux femmes détenues.
3
Avec la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, la mise en œuvre des soins somatiques en milieu carcéral est transférée du ministère de la Justice au ministère de la Santé – pour les soins psychiatriques, le transfert a lieu dans les années 1980. Cette réforme s’accompagne d’un changement d’échelle dans l’organisation des soins, du déploiement d’unités sanitaires rattachées au service public hospitalier et de la disparition progressive des services de « médecine pénitentiaire ».
4
La prééminence de ce syndicat s’est affaiblie au cours des années 1990 et 2000, principalement au profit de l’UFAP. Aux dernières élections professionnelles (décembre 2018), FO obtient 35,08 % des suffrages exprimés, devant l’UFAP (33,22 %) et la CGT (13,56 %).
5
La scission entre la CGT « probation » et la CGT « pénitentiaire » a lieu à la fin des années 2000.
6
Christian Carlier est ancien directeur d’établissement pénitentiaire, devenu historien. Ses travaux portent sur l’histoire de l’administration pénitentiaire, ses établissements et ses personnels. Voir par exemple son Histoire du personnel des prisons françaises du XVIIIe siècle à nos jours (Paris, Les éditions de l’atelier, 1997) et Histoire de Fresnes, prison « moderne » (Paris, Syros, 1998).
7
Ensemble de dispositions réglementaires spécifiques aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, qui organise les métiers en grades similaires à ceux en vigueur dans l’armée : surveillant, brigadier, premier surveillant, major, lieutenant, capitaine, commandant.
8
La bonification du 1/5e permet au fonctionnaire de se voir attribué une annuité (4 trimestres) de retraite toutes les cinq années de service effectif. Cette bonification est plafonnée à 5 annuités (20 trimestres). Cet avantage concerne les fonctionnaires titulaires dont les conditions de travail sont jugées particulièrement éprouvantes ou dangereuses, comme les agents de la police nationale, les pompiers professionnels, les militaires, les douaniers, etc.
9
Les maisons d’arrêt accueillent des personnes en détention provisoire, des personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans ou encore des personnes en attente de transfert dans un établissement pour peine (centre de détention ou maison centrale). Contrairement aux établissements pour peine, les maisons d’arrêt ne sont pas soumises à un numerus clausus. Ces prisons font donc face à des taux d’occupation dépassant largement le nombre de place théoriques disponibles.
10
En 2002, la loi d’orientation et de programmation pour la justice crée une procédure dite d’autorisation d'occupation temporaire-location avec option d’achat (AOT-LOA). Dans ce système, qui s’ajoute à la gestion déléguée, et fait partie des contrats public-privé, l’État paie des loyers pendant 30 ans au terme desquels il devient propriétaire des locaux. En 2004, le Partenariat Public-Privé (PPP) marque une étape supplémentaire dans la délégation au privé : l’administration pénitentiaire peut désormais passer un contrat de partenariat avec un interlocuteur unique qui assure l’interface avec l’ensemble des acteurs et intervenants du fonctionnement d’un établissement et prend en charge toute la chaîne depuis la conception jusqu’à l’exploitation. Au 1er janvier 2019, 74 prisons (sur 186) sont gérées au moins en partie par des entreprises privées (dont 7 mises en service dans le cadre d’une AOT-LOA à partir de 2009, 7 autres d’un PPP proprement dit à compter de 2011). Près des deux-tiers des détenus (65 %) purgent leur peine dans ce type d’établissement.
11
Le livre de Véronique Vasseur (Médecin-chef à la prison de la santé, Paris, Éditions Le Cherche Midi, 2000) raconte l’accablant quotidien d’un médecin à la prison de la Santé et dresse un état des lieux catastrophique de la situation carcérale. L’ouvrage rencontre un succès de presse important. Au cours de l’année 2000, deux commissions d’enquête de l’Assemblée Nationale et du Sénat se penchent sur les conditions de détention en France et formulent un ensemble de préconisations visant à remodeler l’institution carcérale.
12
Ministre de la Justice et garde des Sceaux de 1997 à 2000.
13
Ministre de la Justice et garde des Sceaux de 1995 à 1997.
14
Ministre de la Justice et garde des Sceaux de 2000 à 2002. Pendant son mandat, une loi pénitentiaire est en préparation dont les observateurs espèrent à l’époque une amélioration sensible des conditions de détention. Elle est abandonnée au cours de la campagne électorale présidentielle de 2002, largement dominée par le thème de la sécurité. Le projet sera repris, modifié et voté en 2009 (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire)