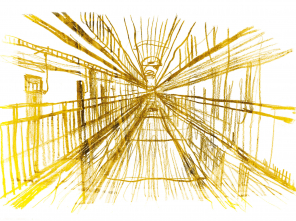La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est devenue une préoccupation politique et sociale majeure, dont l’administration pénitentiaire se saisit via la prise en charge de détenus condamnés pour des faits terroristes. Accusée d’être un terreau de propagation d’idéologies extrémistes, elle tente, par ses mesures de regroupement et d’isolement de ces détenus particulièrement surveillés, de mettre en place des programmes dits de « déradicalisation ». D’autres acteurs interviennent, notamment hors des murs de la prison, dans ce champ particulièrement médiatisé.
Mourad Benchellali est né en 1981, à Villeurbanne (Rhône). Il est connu pour son incarcération à Guantanamo puis en France pour des faits de terrorisme. Depuis sa libération, il témoigne pour faire connaitre son parcours et les dangers de la radicalisation islamiste.
Meoïn Hagège est sociologue de la santé. Elle a mené une enquête sur la santé des personnes détenues et sortantes de prison, pour éclairer les manières dont les institutions pénales, sociales et sanitaires prennent soin des corps dont elles ont la charge. Elle montre notamment que la sortie de prison est une épreuve en soi, un moment d’entre-deux entre la prison et la ville, qui parait sans fin et qui exacerbe la vulnérabilité sociale.
L’entretien a eu lieu par téléphone en 2018 puis en 2019.
Meoïn Hagège – Quel est le parcours qui a mené à votre détention aux États-Unis puis en France ?
Mourad Benchellali – J’ai été capturé en décembre 2001 par des villageois pakistanais. J’ai fui l’Afghanistan, un pays dans lequel j’ai passé quasiment six mois. Je suis parti en juin 2001, à dix-huit ans, sur les conseils de mon frère – et il avait passé plusieurs mois là-bas. Quand il est rentré, il m’a expliqué que c’était un pays musulman, que partir ferait de moi un bon croyant.
Mon frère était parti pour des motivations religieuses. Moi, je ne suis pas pratiquant. La religion, je peux la prendre ailleurs. J’ai accepté sa proposition parce que j’y voyais la possibilité de voyager, de voir ce pays. Je suis parti pour faire plaisir à mon frère, avec beaucoup de naïveté, comme un gamin. C’est important ça : je ne suis pas parti en Afghanistan pour faire le jihad, je suis vraiment parti pour faire plaisir à mon frère, et pour faire cette aventure. Pour découvrir, et avec l’intention de revenir.
Le problème, c’est qu’en arrivant sur place, j’ai vu que le pays était très organisé : des combattants étrangers essayaient de faire de tous les jeunes des nouvelles recrues, il y avait des maisons d’accueil où on était hébergé, il fallait laisser son passeport, ses affaires… Ils m’ont envoyé à Kandahar, dans un camp d’entrainement d’Al Qaïda – une organisation que je ne connaissais pas à l’époque. Tout le monde devait y passer, tous les jeunes. C’est comme ça que je me suis vu imposer un entraînement militaire de deux mois. En réalité, c’était un entraînement terroriste, parce qu’on y a appris le maniement des armes, des explosifs… Pour la première fois de ma vie, je rentrais dans le terrorisme. Je ne voulais pas faire cet entraînement. J’avais peur qu’on me demande ensuite d’aller combattre ou de faire des choses plus graves.
Les conditions de vie y étaient intolérables. On était au milieu du désert, au milieu de nulle part. Il y avait des tentes, des maisons en terre. L’entraînement physique était très intense, il faisait cinquante degrés, on était très peu nourris. On dormait très peu aussi et il y avait des punitions pour ceux qui ne voulaient pas faire les entraînements. Un jour, on a eu la visite d’Oussama Ben Laden. Il était venu parler des attentats suicides, expliquer qu’il fallait faire le jihad.
Au bout de deux mois, j’ai décidé de rentrer chez moi – j’ai essayé en tous cas. Mais quelques jours avant que je sorte du camp, les attentats du 11 septembre ont eu lieu. Le piège s’est refermé. Le pays est entré en guerre avec les Américains et très vite, ils ont commencé à bombarder. C’était la guerre. Il n’était plus possible de passer au Pakistan. Ce n’est qu’au mois de décembre que j’ai réussi à m’enfuir avec des villageois, par les montagnes. Peu après, on a été capturés et j’ai été mis en prison au Pakistan ; j’ai été incarcéré pendant plusieurs semaines, et « vendu » aux Américains. C’est comme ça qu’a commencé mon périple à Guantanamo : j’y suis resté deux ans et demi, de janvier 2002 à juillet 2004, ensuite j’ai été transféré dans les prisons françaises, de juillet 2004 à février 2006.
Une grande partie de ma famille a été inculpée d’association de malfaiteurs, à cause de mon grand frère1. Au moment où j’étais incarcéré à Guantanamo, il a voulu s’engager dans la voie du jihad – il n’a rien fait, mais il a essayé. C’était suffisant pour que la justice française l’arrête et le mette en détention, suivi par mes parents et un de mes frères. Après mon retour de Guantanamo, à Fleury Mérogis, j’étais incarcéré avec une grande partie des membres de ma famille, pour ne pas dire presque la totalité. Et ça aussi, ça a été une expérience pour moi, une expérience qui m’a beaucoup fait réfléchir. On n’avait pas le droit de se parler parce que c’était interdit par le juge – j’étais pourtant dans la même prison que ma mère, à Fleury.
Le procès a eu lieu à l’été 2006. J’ai été condamné en première instance à un an de prison ferme pour association de malfaiteurs, parce que la justice a estimé que le passage dans le camp prouvait des intentions terroristes. Un an, c’était une peine inférieure au temps que j’avais déjà passé en détention provisoire. En 2009, en deuxième instance, j’ai été relaxé : le juge a finalement estimé qu’il n’y avait pas de projet criminel, et que ce n’était pas suffisant pour nous condamner, Nizar Sassi et moi (Nizar était parti avec moi en Afghanistan et on a été jugé au même procès). Pour des raisons politiques a priori, le parquet a fait appel. On s’est pourvu en cassation et depuis 2005, on est devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette procédure est une condamnation de la France pour la détention qu’on a fait en France et puis la condamnation. C’est un enjeu important. Notre dossier est en instruction depuis 2005 mais on devrait bientôt obtenir une audience. C’est long mais symboliquement, on y tient.
On avait aussi déposé plainte contre X pour séquestration et détention arbitraire. Mais cette procédure aussi est longue, car enquêter sur une prison à l’étranger est complexe pour les juges français. Par exemple, ils ont demandé à visiter la prison de Guantanamo, mais comme c’est à Cuba et géré par les Américains, les démarches sont longues. Ils ont aussi essayé de convoquer un des commandants en charge de la prison au moment où j’y étais détenu, le Commandant Miller. Ils ont émis un mandant d’arrêt et une convocation : il ne s’est pas présenté, les juges ne peuvent rien faire… Les enjeux juridiques aussi sont complexes – on n’avait pas de statut à Guantanamo. Les Américains ont inventé le statut de « enemy combattant » mais il n’y a pas de textes pour l’encadrer, les juges n’ont donc pas de lois sur lesquelles s’appuyer pour prouver la détention arbitraire ou la séquestration. Je pense aussi qu’il y a des enjeux politiques qui freinent leurs démarches, liés aux relations entre la France et les États-Unis. On est pessimistes depuis le début. On sait qu’on ne sera pas indemnisés, que personne ne sera condamné. Mais on persiste parce que c’est symbolique, et on espère qu’avec ces procédures, on pourra déconstruire cette immunité.
– Vous avez passé du temps en détention en France, où les conditions peuvent être difficiles, pour les personnes qui y sont détenues mais aussi pour celles qui y travaillent. Depuis, vous militez et vous êtes amené à fréquenter ce milieu. Avez-vous rencontré des professionnelles ou des professionnels qui vous ont marqué ?
– Dans les administrations, j’ai toujours trouvé des gens très volontaires. Certains des Spip [les agents du Service pénitentiaire d’insertion et de probation] que j’ai rencontrés sont courageux, très engagés : ils veulent changer les choses. J’ai rencontré des gens à la DAP [Direction de l’Administration pénitentiaire] très volontaires aussi, et très humains dans leur approche. Certains sont partis d’ailleurs, c’est triste. Ils mettaient beaucoup d’humanité dans la prison. J’ai aussi rencontré des directeurs de prison qui avaient des manières très humaines, même quand j’étais détenu. Je me souviens d’une directrice de prison extraordinaire. Elle était dans le dialogue, dans l’ouverture, elle n’avait pas de posture sécuritaire. Elle n’était pas réactionnaire, pas que dans la répression. Si j’avais besoin de dialoguer, c’était possible. Si j’avais besoin de la rencontrer dans son bureau pour parler, si j’avais un problème à gérer, elle s’en occupait. Ce n’était pas des gens qui se contentaient de mettre des gens en prison et de faire en sorte qu’ils ne s’en sortent pas. Elle se souciait de leurs conditions de vie, et forcément ça fait qu’on sort de la prison différemment. Je suis devenu ce que je suis entre autres grâce à cette personne.
En détention, j’étais « DHR », Détenu à haut risque, ce n’est pas le statut le plus dur2. Ça voulait juste dire que j’étais seul en cellule, que le surveillant venait voir ce que je faisais tous les quarts d’heure. On était un peu traités différemment.
– Comment s’est passé votre retour, après votre sortie de prison ?
– Dès ma sortie, en 2006, j’ai voulu témoigner, pour deux raisons. La première est en rapport avec mon expérience aux États-Unis : je veux la fermeture de Guantanamo, je veux en parler pour que les gens sachent que cette prison existe et qu’ils sachent comment ça se passe à l’intérieur. La deuxième raison, c’est que je voyais qu’il y avait des jeunes qui pouvaient être attirés par le jihad, en 2006 déjà. Témoigner, ça peut les sensibiliser à cette question. J’ai commencé à le faire en 2006, dans les écoles. Et depuis, ça a toujours été difficile : il faut encore et toujours convaincre. Parce qu’en France, contrairement à d’autres pays, pour un ancien détenu il est difficile de prendre la parole, de témoigner publiquement, de rencontrer et de travailler avec des institutions publiques. Je suis souvent découragé, mais j’ai quand même persévéré jusqu’à aujourd’hui. Parce que je pense que c’est encore utile.
– Et du côté de votre vie personnelle ?
– Dès que je suis sorti, j’ai eu comme un cadeau : un petit garçon, mon fils. Après les grandes difficultés que j’ai subies pendant ces cinq années de prison, c’est ce qu’il m’est arrivé de meilleur dans la vie. Vivre ça, c’est bizarre... c’est vraiment bizarre. Je suis passé d’un extrême à l’autre. Il a 11 ans maintenant. C’est un grand garçon, il va rentrer au collège. Je suis très inquiet parce qu’il est très intelligent, il comprend les choses et j’ai envie d’être un bon exemple pour lui. Je n’ai pas envie qu’il fasse les mêmes erreurs que son papa, mais je n’ai pas envie non plus que mon histoire soit une gêne ou un handicap pour lui. J’essaie d’être le plus présent possible, d’être le meilleur exemple. C’est compliqué. Il vit avec sa mère ; j’essaie de le voir le plus souvent possible, les weekends. Mais c’est vrai que c’est aussi du bonheur, beaucoup de bonheur. Quand on a un enfant, c’est la meilleure chose que vous avez dans votre vie, et en même temps c’est une grande responsabilité.
– Qu’en est-il de votre vie professionnelle ?
– Je suis travailleur social de formation. Quand je suis sorti de prison, ce n’était plus possible de faire ce métier. À cause du regard des autres, à cause de mon parcours. Après la prison, j’ai eu une période de ma vie où je travaillais dans le bâtiment. Ça n’avait plus rien à voir avec ce que j’aimais faire. Mais quelques années plus tard, j’ai fait une formation pour être formateur en insertion professionnelle. J’ai passé le diplôme et j’ai repris le social.
– Vous êtes formateur, en plus de votre travail de témoignage et de militantisme ?
– Oui, c’est vrai que le témoignage et le militantisme, c’est un travail. Et puis il faut se former aussi. On ne peut pas juste raconter son parcours, il faut se professionnaliser. Je voulais en faire mon métier donc il fallait que j’apprenne des choses. L’insertion professionnelle non plus, ce n’est pas un truc qui s’improvise, parce qu’on se retrouve avec des jeunes. Je suis devenu formateur, j’ai appris à devenir formateur. Je me suis aussi formé à la formation professionnelle pour des personnels. J’essaie de faire les choses de manière efficace. Dans ce sens, l’insertion professionnelle et le militantisme se rejoignent : il faut être formé. Quand je témoigne, il ne suffit pas de voir des gens pour leur raconter ma vie. J’essaie aussi de transmettre des informations, d’éduquer, d’enseigner. C’est plus complexe que raconter une histoire.
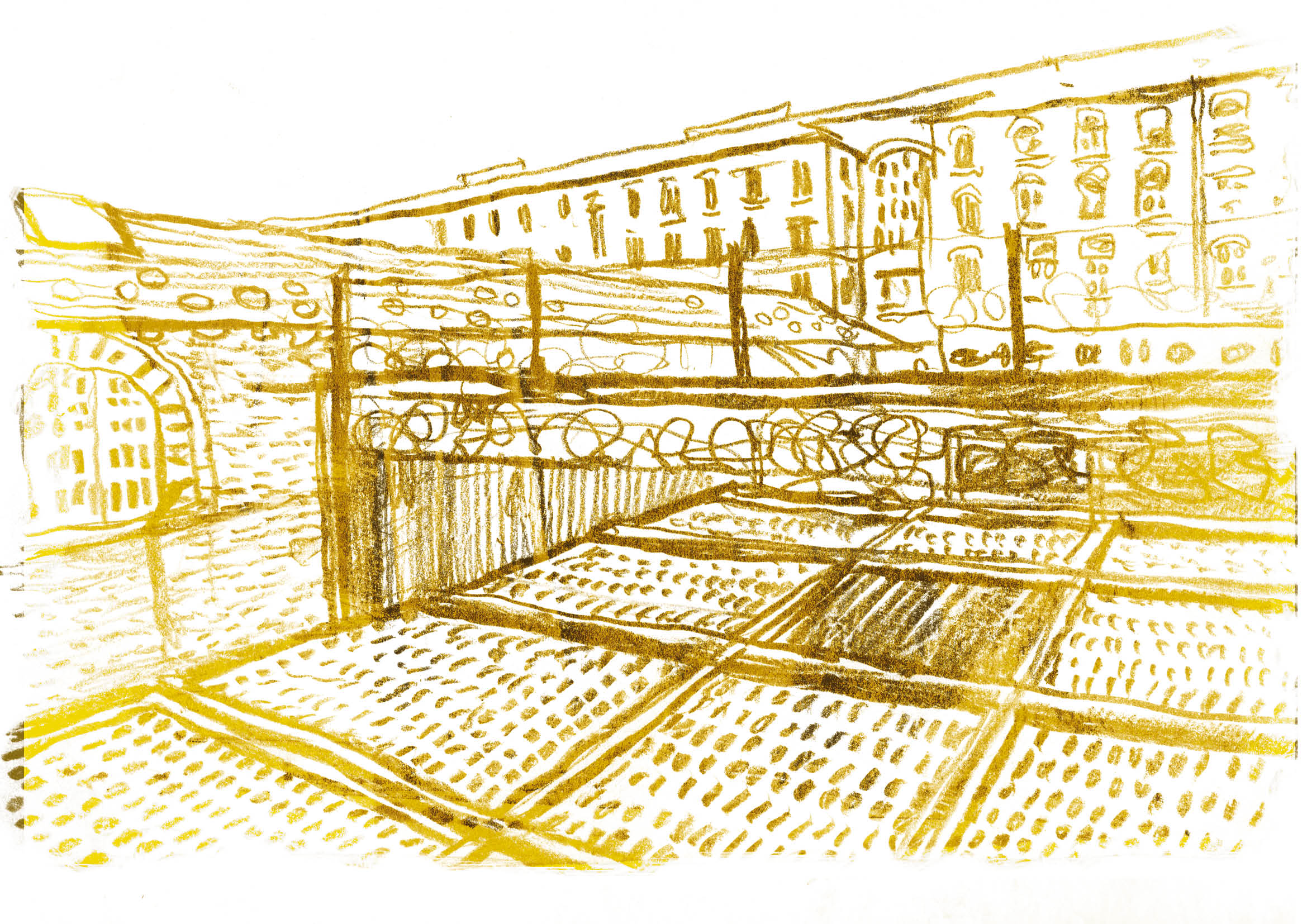
– Quel regard portez-vous sur les moyens mis en œuvre en France pour lutter contre la radicalisation ?
– En France, le gouvernement a monté le projet RIVE [Recherches et Intervention sur les Violences Extrémistes]. C’était un peu secret, mais c’était un programme pilote du gouvernement, qui a duré deux ans et qui était mis en œuvre à Paris par l’Apcars [Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale3]. Depuis, il a été élargi et rebaptisé « PAIR », ou « programme d’accueil individualisé et de réaffiliation sociale ». Aujourd’hui, il est mené à Paris, Marseille, Lyon et Lille par le Groupe SOS.
C’est un programme de prise en charge de détenus radicalisés, en milieu ouvert. Ils sont le plus souvent condamnés, mais au lieu de purger leur peine en prison, ils sont hébergés et inscrits dans un système de mentorat, à la demande du procureur. Ce programme est inspiré du Danemark. Un mentor accompagne le condamné pour la déradicalisation mais aussi l’insertion. Ils apprennent à se connaître, c’est une prise en charge très proche. Le mentor passe du temps avec le condamné, il rencontre sa famille, ses amis. Il faut avoir de l’expérience parce que le travail d’insertion avec un jihadiste, ça demande des compétences en matière d’insertion mais aussi en matière d’idéologie jihadiste. L’idée n’est pas de leur faire changer de mentalité, il faut respecter la liberté de penser. Par contre, certains ont fait le jihad et commis des attentats, donc le mentor doit s’assurer que le condamné a bien abandonné la violence. On peut dire que le programme vise aussi à évaluer, à voir où ils en sont : si le mentor estime qu’une personne risque de passer à l’acte, elle peut retourner en prison.
Ceux qui sont suivis sont des privilégiés : la plupart des jihadistes sortent en sortie sèche4et n’ont pas accès au suivi avec les intervenants de PAIR. Certains sont trop radicalisés pour être suivi dans le dispositif, c’est le haut du spectre. Ils sortent après de longues peines, avec des mesures de contrôle judiciaire ou de contrôle administratif qui leur interdisent de voyager ou les obligent par exemple à émarger au commissariat plusieurs fois par semaine (ou par jour). Certains, le bas du spectre, ne sont plus dangereux. On estime qu’ils n’ont pas besoin d’accompagnement particulier et ils se débrouillent tout seul à la sortie. Ceux qui sont suivis par PAIR sont au milieu du spectre et ils sont peu nombreux, entre 10 et 30 personnes par programme, selon la ville. Le programme est pensé en relai du travail des Spip, pour le remplacer par un accompagnement plus spécialisé, plus sur le terrain et plus en lien avec les familles. Par contre, il est complexe à mettre en œuvre : les participants qui ont été condamnés pour des affaires de jihadisme ne doivent jamais se rencontrer ni savoir qui sont les autres participants au programme. C’est très difficile à faire, ça demande beaucoup de compétences.
Dans le projet PAIR, il y a un côté prise en charge et un côté recherche. C’est-à-dire qu’en parallèle du mentorat, il y a un suivi des accompagnements et de la recherche sur le programme par un chercheur. L’idée est d’évaluer et identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
– Il y a aussi des associations, des individus qui ont investi le champ de la lutte contre la radicalisation…
– Il y a beaucoup de gens qui font ce genre de formations. Je me suis rarement reconnu dans le travail que les autres faisaient. Il y a quelques personnes que j’aime bien, comme Yazid Kerfi5: j’aime bien sa façon de faire, de s’exprimer, de travailler avec les détenus. J’aime aussi certains des intervenants en Belgique, qui accompagnent des détenus ; je trouve que leur manière de faire est bonne. Après, c’est difficile de répondre parce que chaque prison est différente, et chacun travaille de manière différente.
Mais, ce que j’ai remarqué, c’est qu’après la grande vague de départs de jeunes vers la Syrie, il y a aussi eu une grande vague de personnes qui se sont proposées pour faire des formations sur ces questions de jihad et de radicalisation, alors qu’elles n’étaient pas forcément compétentes – en tous cas, pas suffisamment de mon point de vue. C’est pour ça, je me suis rarement reconnu dans le travail des autres.
– Vous parlez de « bonne » manière de faire. Selon vous, qu’est-ce qui fait que quelqu’un est compétent ?
– C’est d’une part les connaissances sur la question de la propagande jihadiste, parce que le jihad, ce n’est pas qu’une question de radicalisation – ce n’est pas comme l’extrême droite, ou le nazisme, c’est plus complexe. Il faut avoir beaucoup de connaissances sur le sujet, il faut avoir beaucoup lu, il faut être un minimum arabophone, avoir voyagé. Il faut avoir aussi fait un travail empirique. Très peu personnes ont ces compétences, la plupart de ceux qui font ces formations ne les ont pas. Pour moi, quelqu’un qui n’a pas vécu le jihad peut difficilement se mettre dans la mentalité des jihadistes, et vraiment comprendre ce qu’ils disent et ce qu’ils racontent.
Certains sont très bons, c’est vrai, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Ceux qui sont bons ont plus de recul, ils ne se sont pas réveillés en 2014 en se disant : « Tiens, il y a des jeunes qui partent, on va s’y intéresser ». Ils s’y intéressaient bien avant. Ils ont suivi l’évolution des mouvements jihadistes, ils ont des vraies connaissances, ils ne se sont pas improvisés. Je ne me prétends pas plus compétent non plus. Moi, j’ai mon ressenti, j’ai cette expérience... mais je ne sais pas. J’ai aussi formé des personnels de la PJJ6, des travailleurs sociaux ou même des policiers.
– Pourquoi faire ces formations ? Pour que le cadre, que l’institution, change ?
– Oui, le cadre doit changer. C’est en train de se faire en vérité. Ceux qui ne sont pas compétents, en général, ne durent pas : au bout d’un moment, ils se font démasquer ; les gens s’en rendent compte, ils voient qu’ils ne sont pas efficaces. Mais les personnes compétentes restent, c’est ça la bonne nouvelle. Avec le temps, les choses vont s’arranger toutes seules. C’est pareil avec les institutions : il y a de plus en plus de lucidité. Je l’ai vu dans le dernier plan de radicalisation. Le ministre dit qu’il n’y a pas de recette miracle. « Il faut être transversal », etc. Il y a quand même des prises de conscience, des personnes qui essaient de produire le changement de l’intérieur.
– Et aujourd’hui ?
– Je travaille d’abord avec la PJJ, dans des structures locales qui accompagnent des mineurs. Dans ce cadre, il m’arrive d’intervenir dans des milieux ouvert ou semi-ouvert, avec des mineurs pour ce qu’ils appellent des « stages de citoyenneté », ou des mesures de réparation. En tout cas ce sont des jeunes qui sont dans des mesures alternatives à la prison. Ma mission est toujours la même : témoigner, débattre avec eux sur ces questions de la radicalisation, les sensibiliser.
Je suis souvent invité aussi pour rencontrer des mineurs en milieu fermé. J’ai été dans la plupart des EPM [Établissements pénitentiaires (fermés) pour mineurs]. J’ai été à celui d’Orvault, il y a quelques jours, invité par l’Éducation nationale, c’est à dire par l’école à l’intérieur de l’EPM. Des fois j’interviens pour l’Éducation nationale, des fois pour la PJJ. Et puis j’interviens en maison d’arrêt ou CD [Centre de détention7], pour aller rencontrer des détenus. Je l’ai fait plusieurs fois dans le cadre d’un programme de déradicalisation. Dans ce cas-là, je suis un intervenant parmi d’autres. Ou alors des maisons d’arrêt m’invitent parce qu’elles ont entendu parler de moi.
C’est un travail de fourmi. Je vais voir des jeunes, dix par dix... Pour moi, c’est ce travail qui est efficace. Ça les marque parce que j’ai une histoire atypique : quand je leur raconte mon parcours (je leur amène aussi des photos), c’est un témoignage qu’ils n’ont jamais entendu de leur vie. Guantanamo, le camp d’entraînement, les bombardements américains, ou même la rencontre avec Ben Laden, pour eux c’est une histoire de fous, c’est comme un film. Forcément, ça les marque beaucoup plus que n’importe quoi. Parce que c’est le réel, c’est plus un film, justement, c’est fort pour eux.
– Ils n’ont pas accès à d’autres récits de retour, sur internet par exemple ?
– Pas tellement, on n’est pas nombreux à être passés par là et à témoigner. Je pense qu’on se compte sur les doigts de la main. Et on a tous une manière différente de le faire. Moi, j’essaie de ne pas être un donneur de leçon – je n’aime pas les donneurs de leçons. Il y en a qui le sont un peu plus, qui aiment bien faire des leçons de morale, expliquer pourquoi ils sont de meilleurs musulmans que les autres, ou meilleur chevalier des valeurs de la République et de la laïcité. Cette approche passe mal chez les jeunes. C’est comme s’ils étaient en colère quand ils étaient jihadistes et qu’aujourd’hui, ils sont toujours en colère mais dans l’autre sens : ils sont toujours en guerre quoi, toujours une démarche agressive. Je n’aime pas cette façon de faire. Des gens qui témoignent, qui sont dans le vécu, il y en a quelques-uns mais ils ne sont pas nombreux.
– Et quelle est votre façon de faire, à vous ?
– Je raccroche au parcours et c’est tout – on en parle. J’ai des messages que je passe bien sûr, mais j’essaie de ne pas le montrer, de ne pas aller voir les jeunes en leur disant : « voilà, ça c’est le bon Islam, ça c’est le mauvais Islam.... c’est leur faute à eux, ou à je sais pas qui... » Je ne me reconnais pas dans cette manière de faire – mais bon, on est tous différents, ce n’est pas grave.
Le jihad, ce n’est pas qu’une question de connaissances religieuses. Il y a des connaissances politiques, géopolitiques, plein de compétences qu’il faut transmettre aux jeunes, pour se défendre, pour prévenir la radicalisation. Le jihad, c’est un engagement politico-religieux, c’est profondément politique. La question sociale est très importante aussi. Si on a des jeunes qui deviennent ennemis de leur pays aussi facilement, c’est qu’il y a un problème de fond, un contentieux sur la question sociale et un contentieux psychologique aussi. Si ce n’était qu’une question de religion, ce serait facile. Il suffirait de former des imams : ils iraient parler aux jeunes et on aurait réglé le problème. Malheureusement, ce n’est pas ça. Il y a des pays beaucoup plus musulmans qui ne sont pas touchés par le terrorisme. Bien sûr, il faut aborder la question religieuse (ça m’arrive de l’aborder avec des imams par exemple), mais je ne suis pas compétent pour aborder la question religieuse en formation. Ce serait bien de faire parler de religion ceux qui seraient radicalisés religieusement, pour édulcorer un peu leurs idées, pour les aider un peu à devenir moins fermés, à interpréter de manière différente les textes, à s’ouvrir un peu plus aux autres. Beaucoup de jeunes sont dans un Islam de plus en plus radical, en rupture avec les autres, et ça les rend plus vulnérables au jihad.
Les imams ont ce travail de prévention à faire, ils ont un grand rôle à jouer, je pense. Mais leur permettre de jouer un rôle plus important est difficile : ce n’est pas la tradition française. Dans le système français, la religion est considérée comme toxique de manière générale. Alors, dans l’esprit de beaucoup de gens, elle ne peut pas être un outil de prévention. C’est compliqué : certains pensent qu’il faut s’appuyer dessus, d’autres non. C’est encore en débat. De manière générale, en France notre religion est loin d’être acceptée. Pour qu’elle le soit, il faudrait accepter que la religion n’est pas mauvaise en soi, qu’il y a des choses positives dans la religion. C’est le cas en Belgique, où on peut l’utiliser comme un outil.
C’est culturel : en France on est comme ça, on considère qu’une personne qui est passée par le jihad, c’est son métier pour toute sa vie. Même si je faisais plein d’émissions de télé pour expliquer mon travail, il y aurait toujours des gens pour dire : « Mais ce gars-là, il ne faut pas lui donner la parole ». Donc, je préfère aller sur le terrain et expliquer ce que je fais, plutôt que de le faire de manière générale, comme ça, à tout le monde. C’est plus compliqué, c’est plus long, mais c’est ce que j’ai décidé de faire. Je circule beaucoup, je vais à la rencontre des gens, je me présente : ce que je fais et pourquoi je le fais.
Avec des collègues, j’avais créé « Action Résilience », une association de plaidoyer et de formation. C’était dans ce cadre que j’intervenais pour la Pénitentiaire, pour des rencontres avec des détenus ou des formations pour le personnel pénitentiaire. C’est une structure que j’avais fondée avec Nicolas Hénin, qui a fait des reportages de guerre et a été otage de l’État Islamique. On avait créé l’association avec trois autres personnes : Cédric Mas, avocat et historien militaire ; Jean-Marc Laffont, analyste, veilleur sur les questions de radicalisation, et expert en sécurité ; et Bilal, informaticien, qui s’intéressait aux liens entre jihad et internet.
Nicolas abordait aussi la question d’internet dans les interventions avec les jeunes – comment reconnaître une bonne information et une information fausse, comment faire la différence entre un site internet et un blog, une vidéo d’un blogger, d’une chaîne ou d’un journaliste. Il leur parlait aussi de complotisme. Il y a une grande révolution de l’internet, on ne s’en rend pas compte parce qu’on est dedans : les jeunes sont confrontés à un flot d’informations infini, ils sont encore dans la difficulté pour faire la part des choses. Pour eux, une vidéo de quelqu’un sur Youtube ou du New York Times, c’est pareil. Ça crée les inconvénients qu’on connaît : ils sont plus vulnérables au complot, à la propagande. On leur parle de sens critique, mais il y a aussi des techniques qu’ils n’ont pas, des outils pour vérifier l’info, vérifier que des photos sont fiables, etc.
La lutte contre la radicalisation est une priorité affichée de la pénitentiaire, résultat : énormément de personnes proposent ces services il y a beaucoup de concurrence. Je n’interviens plus dans les unités dédiées parce qu’en tant qu’ancien détenu, et détenu à Guantanamo, c’est plus difficile. Beaucoup pensent qu’un « repenti » n’a pas sa place en maison d’arrêt. J’en ai rencontré plein, des personnes de retour, mais tout le monde n’a pas le même point de vue. Heureusement l’Administration pénitentiaire ne partage plus ce point de vue.
L’association avait signé une convention d’un an avec la DAP, pour intervenir auprès des détenus en maison d’arrêt et en centre de détention, mineurs et majeurs, femmes et hommes. On a fait beaucoup de formations en prison grâce à cette convention. Il y a aussi deux autres parties d’Action Résilience. On faisait du plaidoyer et on essayait de faire de la recherche en organisant des colloques à Paris, près de l’École militaire et en publiant des billets sur un blog, où des chercheurs et des experts donnaient leur point de vue8. C’est comme un think tank.
– Depuis votre libération il y a douze ans, est-ce que votre regard sur la prison a changé ?
– Oui, forcément. Il a changé parce que j’ai trouvé que le terrorisme a intoxiqué beaucoup, en tous cas qu’il a rendu la prison plus sécuritaire de manière générale. À travers l’exemple de quelques détenus radicalisés, on a fait une généralité. Tout le monde a considéré qu’il fallait être plus sévère : les juges sont devenus plus durs, la promiscuité de la détention a augmenté… Ces dernières années, j’ai trouvé que c’était de plus en plus difficile en prison, pour les détenus comme pour ceux qui y travaillent. Après, c’est un sentiment, je n’ai pas fait d’études, je n’ai pas de chiffres.
Ce qui m’a marqué le plus en prison, c’est la surpopulation. À mon époque, elle n’était pas aussi élevée qu’aujourd’hui, même si c’était déjà très problématique. C’est devenu grave : la surpopulation est le plus gros problème de la prison – plein d’autres en découlent directement.
– Et que pensez-vous de l’idée selon laquelle la prison serait une école de la délinquance, qu’elle encouragerait la déviance, voire la radicalisation ?
– D’une certaine façon, je suis d’accord. C’est vrai que la prison peut être une école aussi... Pour moi, elle l’a été puisque j’allais à l’école quand j’étais à Fleury : j’ai passé mon diplôme de travail social… L’école du crime ? Non, la prison n’a pas eu cet effet sur moi, heureusement. J’étais isolé en détention ; je n’étais mélangé qu’avec des Corses, des Basques, des gens mêlés à des affaires terroristes... Ce n’était pas par affinité : le système carcéral était comme ça, on était entre guillemets dans la même galère, avec les mêmes statuts [de surveillance accrue en détention]. On était traités pareil, donc on était mis ensemble. Si je m’étais laissé aller, ce passage en prison aurait pu être toxique. On y rencontre des gens durs, j’aurais pu aussi m’endurcir, devenir quelqu’un de violent. Ça n’a pas été le cas, j’ai eu beaucoup de chance.
– Et depuis votre sortie de prison…
– J’ai vécu pas mal de choses qui me permettent d’avoir un avis. Mon expérience est ce qu’elle est, mais quand je vois des choses qui sont contre-productives pour l’intérêt général, j’éprouve le besoin de le dire. C’est important pour moi, surtout quand je vois que l’opinion française a un penchant pour le sécuritaire, comme aux États-Unis par exemple. De plus en plus de Français pensent qu’on devrait copier ce modèle – qui ne résout pas les problèmes, au contraire. Sur les unités dédiées, on a vu que l’approche sécuritaire n’a pas bien fonctionné : tout le monde l’a vu, même Adeline Hazan a émis un avis défavorable9. Mais les gens pensent qu’il faut plus de sécurité pour répondre à la radicalisation, ou les isoler. Quand j’entends ça, si j’ai l’occasion de m’exprimer publiquement, je le fais.
Cela dit, l’Administration pénitentiaire a amélioré la prise en charge des personnes dites radicalisées. Aujourd’hui, les détenus sont d’abord mis en observation pendant quatre mois dans les quartiers d’évaluation. Ensuite, l’administration décide s’ils peuvent être mélangés aux autres détenus, s’ils ont besoin d’un suivi plus approfondi ou s’ils doivent être mis en isolement. Le grand reproche qu’on leur faisait avant, c’était de traiter tout le monde pareil, d’isoler les gens. La hantise de l’administration, c’était le prosélytisme. Aujourd’hui, ils observent, évaluent et décident de plus en plus au cas par cas. Les unités dédiées étaient toxiques mais elles ont beaucoup changé. Il y a eu un vrai changement de stratégie, au-delà d’une simple question de financement. Ils ont compris que c’est dans l’intérêt de tout le monde de travailler sur l’humain. Par exemple, aujourd’hui, ils permettent aux détenus condamnés pour des faits de terrorisme de faire des activités, comme du sport. Les unités dédiées fonctionnent bien mieux maintenant, mais c’est difficile de dire si elles marchent. C’est difficile car il faut prendre en compte l’intérêt général, trouver l’équilibre entre l’intérêt des personnes incarcérées pour terrorisme et celui des autres détenus.
– Quand vous parlez de ce que vous faites, vous parlez aussi de changement social, de changer les choses sur le fond…
– Il y a aussi le côté moral : une démocratie ne devrait pas faire certaines choses. Ce qui me motive, comme certains des gens qui travaillent en prison, c’est de la rendre plus humaine. En France, on n’est pas forcément les meilleurs, malgré ce que pensent certaines personnes. La prison est faite pour priver les gens de liberté, pas pour punir ou pour faire souffrir. Donc oui, il faut un changement social, c’est une question de morale aussi. De plus en plus la prison est devenue la solution, alors qu’on sait tous qu’elle ne résout pas les problèmes. Depuis dix ans, avec les attentats, la prison est devenue beaucoup plus sécuritaire. C’est une forme de violence, et la violence engendre forcément plus de violences. Il y a d’autres exemples, comme les pays du Nord, où punir d’une autre manière que par l’enfermement fonctionne. Et ça marche – en tout cas, du point de vue de la récidive. Pour autant, on ne s’en inspire pas en France.
– Dans votre vie personnelle, est-ce qu’il reste des séquelles de votre incarcération ? de votre procès ? Par exemple, dans vos relations avec vos amis d’avant ? avec vos proches ?
– Je n’ai plus beaucoup d’amis : la plupart avaient peur pour eux, ils ont cru ce qu’on avait dit de moi dans les médias. Donc, ils ne me connaissaient pas si bien que ça. Quant à mes parents, ils ont été condamnés plus expulsés vers l’Algérie (ils sont interdits définitivement de territoire français), c’est la double peine. Ma mère est à Alger, et mon père dans le Sud. Ils ont divorcé. J’ai un grand frère qui a pris une peine maximale (dix ans), qu’il a purgée. Il est sorti il y a quelques années maintenant. Il a fait sa vie de son côté et il n’a pas récidivé. Je suis retourné à Vénissieux, parce que mes sœurs étaient toutes seules après l’expulsion de mes parents, et puis il me fallait un chez moi. J’ai commencé à travailler ici, et j’y suis toujours. Mes sœurs ont grandi, se sont mariées, elles ont leur vie.
– Et votre fils ? Est-ce qu’il a été affecté par votre parcours ?
– Oui, ça l’inquiète. Mon parcours rend les relations avec les autres plus compliquées – notamment les femmes, ça leur fait peur. Un ancien de Guantanamo, c’est plus inquiétant qu’autre chose. C’est un handicap en fait, un pedigree qui rend compliquée la relation avec les autres. C’est pareil pour la plupart des détenus : même si on reconstruit sa vie, même si on a un job, le parcours d’ancien détenu rend la vie plus compliquée. Et de surcroît pour un enfant. C’est difficile d’en faire quelque chose de positif, de donner aux gens une perspective positive sur ce passage en prison – vraiment très difficile.
Avec les amis aussi. Parce que je suis obligé de m’expliquer à chaque fois. Les gens me collent l’étiquette d’ancien jihadiste. Les gens se disent : « ah putain, ce gars-là, il est bizarre. Maintenant il fait le chantier, mais il a quand même voulu tuer des gens et tout ». Donc moi je suis obligé de m’expliquer en disant : « Mais non, je suis pas un ancien jihadiste. » Mais il y a des gens comme ça, qui ne peuvent pas s’empêcher de voir les autres comme d’autres jihadistes. Pour eux Abdelslam, Mohamed Merah, c’est pareil, c’est la même bande. Montrer qu’on est différent, c’est très délicat. Les gens disent : « ancien de Guantanamo ? C’est bon, on a tout compris. Même pas besoin de nous expliquer qui il est, ce gars-là. » Quand on fait des rencontres, on est obligé de tout raconter, de tout expliquer depuis le début, c’est lassant. Et plus le temps passe, pire c’est, moins les gens me connaissent. C’est ça le grand paradoxe, et le plus frustrant. On pourrait se dire qu’avec les années, les gens vont me connaître de mieux en mieux, mais en fait, c’est l’inverse. Les gens me confondent de plus en plus avec d’autres parcours, avec d’autres personnes passées par le jihad. On en parle tellement à la télé, on mélange tellement les histoires, qu’on sait plus qui est qui. Donc Mourad, c’est comme n’importe quel jihadiste. On sait plus, pour nous c’est la même chose. C’est plus facile pour tout le monde de trouver des stéréotypes, c’est normal, c’est humain. Et, mécaniquement, on se retrouve tout seul. Mais bon ça va, hein ? Je ne vais pas me plaindre – je trouve que j’ai une belle vie en fait.
Bien sûr, il y a quand même des gens qui me connaissent vraiment. Le seul problème, c’est qu’il faut du temps pour en arriver là. Les gens qui me connaissent aujourd’hui, c’est parce que j’ai pris le temps de les fréquenter. Maintenant ça va, mais il faut ce travail, ce temps.
– Et est-ce que des fois vous avez l’impression d’être resté enfermé par le jihad ?
– Bien sûr, même par ce que je fais : c’est toujours lié. Mais bon, c’est mon choix ; j’ai préféré travailler là-dedans, j’assume. C’est une chose qui concerne tout le monde, donc c’est pas grave si ça m’enferme encore aujourd’hui, même si des fois je regrette un peu qu’on me voit beaucoup plus comme un ancien de Guantanamo qu’autre chose, alors que je ne suis pas que ça. Je fais plein d’autres choses. Mais... c’est pas grave.
Notes
1
Comme d’autres personnes accusées de faits liés au terrorisme ou de retour de Syrie, la famille de Mourad a été impliquée dans les procédures pénales et condamnée à des peines d’emprisonnement.
2
Le statut de détenu à haut risque (DHR) correspond aujourd’hui au statut de Détenu particulièrement signalé (DPS). Ces détenus font l’objet d’une surveillance accrue jour et nuit, et sont isolés du reste de la population carcérale. Circulaire de la Direction de l’Administration pénitentiaire du 18 décembre 2007. En ligne : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20080001_0000_0006.pdf
3
L’Apcars a notamment pour mission de conduire les enquêtes sociales des justiciables avant leur jugement et d’accompagner les personnes sortant de prison (www.apcars.fr).
4
La sortie sèche est une expression qui désigne la sortie de prison sans mesure d’accompagnement ni contrôle judiciaire, ni de préparation en amont. Elle ne permet pas de préparer la recherche ou l’obtention d’un emploi ou d’un logement avant la sortie, ni de faire des démarches d’accès aux droits tels que le renouvellement de la carte d’identité ou la demande de revenu de solidarité active (RSA).
5
Yazid Kherfi se forme et s’engage dans le travail social et la prévention à Mantes-la-Jolie, à la suite d’une période de délinquance et une peine de prison de cinq ans pour braquage.
6
PJJ : Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse de l’Administration pénitentiaire, en charge de la prise en charge des mineurs.
7
CD : centre de détention, ou prison pour adultes condamnés à de longues peines.
8
Pour les titres des conférences, voir : https://www.actionresilience.fr/fr/catalogue/. Pour les publications des membres d’Action Résilience, voir : https://www.actionresilience.fr/fr/category/analyses/.
9
Le 30 juin 2015, La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté Adeline Hazan a émis un avis défavorable au regroupement de détenus radicalisés dans des quartiers dédiés (http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-prise-en-charge-de-la-radicalisation-islamiste-en-milieu-carceral/).