Le discours est au cœur de la politique et les mots que nous utilisons ont un impact sur les mondes que nous créons1. C’est pourquoi une grande partie de mon travail jusqu’à présent s’est concentré sur l’importance des choix terminologiques. Certains mots peuvent édulcorer des politiques dangereuses et les rendre plus acceptables. D’autres peuvent induire en erreur et potentiellement exagérer certaines caractéristiques. Certains, selon moi, produisent un sentiment d’urgence et de justesse, et le refus de les utiliser témoigne davantage d’un manque d’engagement envers l’antifascisme que d’une position raisonnable. L’absence de certains mots est révélatrice en soi et renvoie à ce que l’on a appelé les épistémologies de l’ignorance2 : notre silence est parfois assourdissant. Il s’agit d’un exercice délicat, et mon objectif ici n’est pas de trancher le débat ni même de prétendre que la terminologie que j’utilise est la meilleure, ou définitive. Mais je pense que ces débats sont essentiels si nous voulons prendre au sérieux notre rôle et le processus de double herméneutique, c’est-à-dire la manière dont notre travail ne se contente pas de parler de la société, mais s’adresse à elle3.
La myriade de termes utilisés dans ce domaine au fil du temps en dit long sur l’évolution de notre approche de l’étude de ces courants politiques4. « Extrême droite » (Extreme right) a longtemps été le terme privilégié pour désigner la résurgence de partis à la droite de la droite, dont beaucoup avaient des liens évidents avec le fascisme historique. Pensons par exemple au Front national (FN, aujourd’hui Rassemblement national, RN) de Jean-Marie Le Pen, un parti fondé par des néofascistes au début des années 1970 et comptant de nombreux membres et dirigeants nostalgiques des régimes fascistes5. Il est révélateur qu’à l’époque, Le Pen, lui-même partisan de la réhabilitation du maréchal Pétain et négationniste, ait été nommé président du parti car il était considéré comme une figure plus acceptable et plus modérée que les autres.
Le virage vers la « droite radicale » (radical right) s’est produit au tournant du siècle, lorsque ces partis ont entamé leur processus de reconstruction, s’éloignant de leur passé et de leur discours sulfureux pour adopter, de manière plus ou moins ouverte et consciente, les stratégies développées par la Nouvelle Droite et le Gramscisme de droite6. Cela signifiait que ces partis dénonçaient sans équivoque et ouvertement le racisme, et acceptaient les règles démocratiques, du moins en apparence. Si ceux qui suivaient de près la situation savaient bien que ce virage était plus cosmétique et discursif qu’idéologique7, il n’en a pas moins été couronné de succès, permettant à ces partis de sortir de la marginalité politique et sociale. Cela s’est souvent traduit par la reconstitution d’anciens partis d’extrême droite et leur éloignement des articulations plus antagonistes et illibérales de la politique réactionnaire (on pense par exemple au FN, au Parti de la liberté autrichien [FPÖ] ou aux Démocrates suédois [SD])8. Pour le FN en particulier, il s’agissait d’un choix délibéré, influencé par des membres de la Nouvelle Droite française, soit directement, par entrisme, soit indirectement, par transfert d’idées. Cela se manifeste de la façon la plus évidente dans l’abandon d’un langage ouvertement raciste et provocateur au profit d’un discours sur la culture et la « religion », clairement inspiré des théories de l’intellectuel d’extrême droite Alain de Benoist, qui a également eu une influence significative sur l’Alt-Right aux États-Unis. Dans d’autres pays, cette évolution s’est traduite par le remplacement des partis d’extrême droite par de « nouveaux » partis capables de se démarquer de leurs homologues extrémistes. Cela a été le cas, par exemple, au Royaume-Uni et en Allemagne, où l’UKIP (UK Independence Party) et l’AfD (Alternative für Deutschland) ont bénéficié d’une certaine complaisance due non seulement à la comparaison avec le BNP (British National Party) ou le NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), mais aussi à leurs liens avec les milieux universitaires conservateurs. Même s’il était clair dès le début que ces partis étaient idéologiquement ancrés dans une politique réactionnaire, la combinaison d’un changement de discours et de la possibilité de se comparer favorablement à une droite plus extrême leur a permis d’occuper un espace intermédiaire, et de prétendre être des acteurs légitimes du processus démocratique, même si la barre était basse en cette période de post-démocratie.
Sans surprise, c’est également à cette époque que le terme « populisme » est devenu populaire dans la littérature et le discours public au sens large. Je reviendrai plus tard sur le concept de « hype populiste » (populist hype), mais il convient de noter ici que ce mouvement trouve en partie son origine dans l’extrême droite elle-même, Jean-Marie Le Pen ayant tenté de qualifier ainsi son parti au début des années 1990. Cette idée a ensuite été reprise dans les milieux universitaires français et finalement intégrée dans une grande partie de la littérature9. La plupart des travaux sérieux sur le sujet soutiennent que le populisme est au mieux périphérique, agissant comme une idéologie ou un discours superficiel (thin), et que l’attention doit être portée sur les éléments idéologiques fondamentaux de ces partis d’extrême droite. C’est un aspect qui a été largement ignoré dans le monde universitaire, où le terme a été utilisé à tort et à travers par des universitaires peu scrupuleux, qui ont sauté dans le train en marche à la recherche de financements et de citations10.
D’autres, dont je fais partie, ont fait valoir que ce terme est non seulement tout à fait inexact, mais aussi dangereux dans la mesure où il permet de normaliser et d’euphémiser des politiques réactionnaires qui pourraient désormais être présentées au nom du « peuple », même si elles sont intrinsèquement élitistes. Par conséquent, le fait que le terme de populisme soit devenu si répandu dans les médias, mais aussi dans le monde universitaire, est peut-être l’indication la plus évidente que le processus de mainstreaming est un processus qui commence avec les acteurs mainstream eux-mêmes, plutôt qu’un processus qui trouve simplement son origine dans le succès électoral et populaire de l’extrême droite11.
Enfin, le terme « extrême droite » (far right) a été de plus en plus utilisé à partir de la fin des années 2010, alors que l’usage du terme « extreme right » était de plus en plus limité aux formes les plus extrêmes de ce courant politique, et que celui du terme « droite radicale » (radical right) a diminué. Aaron Winter et moi-même avons opté pour une utilisation mixte des termes « far right » et « extreme right » afin de cartographier le contexte dans lequel nous avons assisté à la montée de la politique réactionnaire12. Nous avons utilisé le terme « extreme right » pour désigner les mouvements et les militants qui expriment des formes « illibérales » de racisme et recourent à la violence, qu’elle soit verbale ou physique. Nous utilisons « far right » pour décrire les mouvements et les partis qui adhèrent à une idéologie raciste, mais de manière indirecte, codée et souvent dissimulée, notamment en mettant l’accent sur la culture et/ou en occupant l’espace entre les racismes illibéraux et libéraux, entre l’extrême et le courant dominant (mainstream). Bien sûr, cette séparation entre « mainstream », « far right » et « extreme right » est le produit de processus et de constructions historiques et idéologiques ; mais nous pensons que, pour nos besoins de connaissance, elle fournit un cadre d’analyse particulièrement efficace.
La question est donc la suivante : pourquoi utiliser un autre concept, celui de politique réactionnaire ? Bien sûr, le terme « réactionnaire » était déjà présent dans Reactionary Democracy13, mais il était resté pour l’essentiel indéfini. Au vu des événements qui se sont déroulés depuis la rédaction de cet ouvrage, il est devenu évident que ce terme peut être particulièrement utile pour mieux comprendre le moment que nous vivons et les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Si je continue à recourir, notamment dans un ouvrage à paraître, aux termes « far right » et « extreme right » dans les sens définis ci-dessus, le terme « réactionnaire » nous permet d’aller plus loin et d’évoquer une étape nouvelle de la politique. Si sa nature est étroitement liée à l’extrême droite (far et extreme), elle va également au-delà.
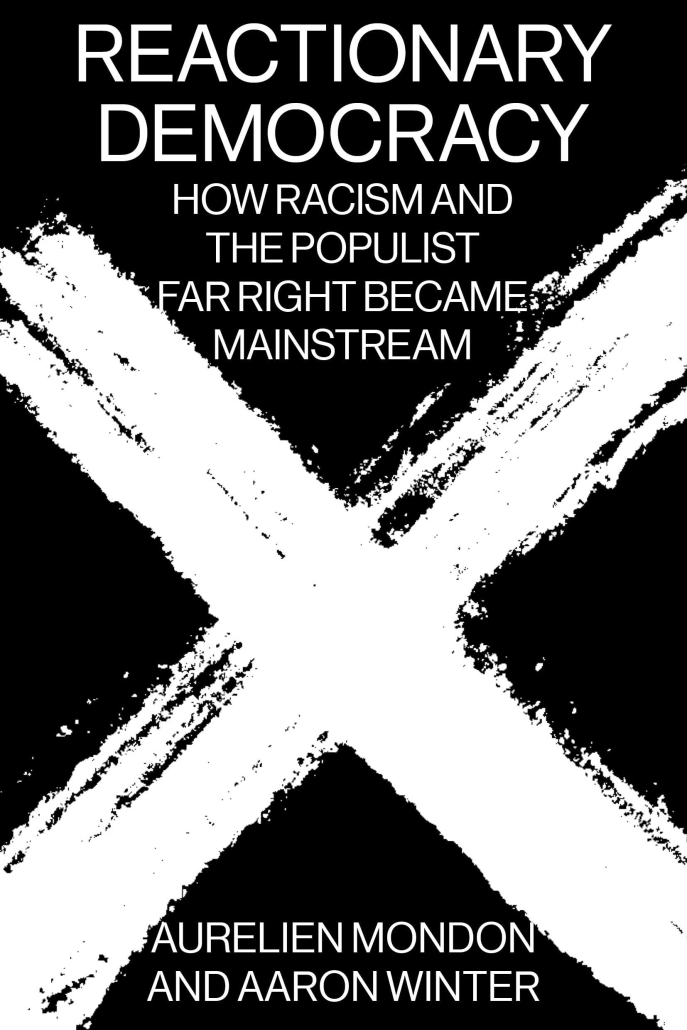
Première de couverture de l'ouvrage d'Aurelien Mondon et Aaron Winter, Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream, 2020.
Tout d’abord, en m’appuyant sur les travaux de Corey Robin14, je considère que la politique réactionnaire ne doit pas être simplement comprise comme une réaction. Il y a bien sûr une réaction face à la gauche et au changement. Il serait toutefois erroné de penser que celle-ci est fondée dans la réalité, comme si la gauche avait triomphé et réussi à renverser l’ordre ancien. Il ne fait aucun doute que les réactionnaires craignent l’avènement de certains projets politiques qui exigent la fin des formes arbitraires de privilèges et de hiérarchie, mais cela ne signifie pas que leurs revendications apparaissent simplement à des moments où l’équilibre des pouvoirs est en train de changer. En fait, comme nous pouvons le constater aujourd’hui, les réactionnaires restent largement aux commandes des institutions, qu’elles soient politiques ou économiques. Leurs craintes reposent donc principalement sur un revirement potentiel ou imaginaire, ou sur des progrès modérés sous la forme de revendications enfin entendues de la part de ceux qui ont été réduits au silence, plutôt que sur une réalité. Les réactionnaires restent avant tout liés au capital et à la richesse, qu’ils cherchent à protéger. Cependant, ils ne veulent pas simplement protéger le statu quo ou revenir à ce qui existait auparavant. Il s’agit plutôt d’un mouvement tourné vers l’avenir, qui cherche à (ré)affirmer des privilèges considérés comme quasi naturels, où l’autorité de l’élite est acceptée, voire célébrée. Comme le note Robin, « le conservatisme a été un mouvement vers l’avant, un mouvement de changement agité et incessant, enclin à la prise de risques et à l’aventurisme idéologique, militant dans sa posture et populiste dans ses orientations, favorable aux rebelles et aux insurgés, aux étrangers et aux nouveaux venus15 ».
Deuxièmement, la politique réactionnaire doit être comprise comme une alliance lâche de revendications politiques visant chacune à saper le changement progressiste, réel ou perçu, au nom de ce qui est bon en tant que naturel, normal et de sens commun. Cette nature lâche, qui peut englober des mouvements apparemment différents de l’extrême droite, mais aussi des « féministes » opposées aux droits des transgenres, par exemple, est donc mieux adaptée pour caractériser notre contexte actuel, où l’on peut être réactionnaire tout en se décrivant soi-même ou en étant décrit dans le discours public comme mainstream ou même de gauche. Cela est clair, par exemple, chez divers acteurs de gauche qui poussent une politique réactionnaire sous couvert de leur lutte contre la cancel culture. Cela permet également de remédier en partie aux limites de certaines recherches sur l’extrême droite, qui ont tendance à se concentrer sur des formes individualisées d’oppression ou d’altérisation, ou à exceptionnaliser ces courants politiques, en délaissant l’oppression systémique. Ici, la politique réactionnaire est donc comprise comme opposée à l’égalité et favorable à la perpétuation de ce que bell hooks a appelé le « patriarcat capitaliste suprémaciste blanc16», auquel nous pourrions ajouter les termes « cis » et « valide », en laissant la définition ouverte à d’autres formes de hiérarchisation rendues hégémoniques sous la modernité.
Enfin, la politique réactionnaire est clairement un projet élitiste et oligarchique17. Si les termes « extreme right » et « far right » devraient également le montrer clairement, compte tenu de la nature élitiste des idéologies et des hiérarchies de valeurs qui les sous-tendent, ces deux concepts ont été pollués par celui de populisme, qui a faussement attribué à ces mouvements une certaine légitimité démocratique. « Radical right » est peut-être le moins approprié de tous ces termes, car il confère aux mouvements concernés un programme radical. Si le changement est au cœur de la politique réactionnaire, il ne s’agit en aucun cas d’un changement contre le statu quo, comme le terme « radical » pourrait le laisser entendre, mais plutôt d’un changement visant à protéger et à renforcer les hiérarchies existantes ou à revenir à des états de nature fantasmés, en s’appuyant sur des hégémonies existantes de longue date. L’élitisme du projet réactionnaire ne devrait pas surprendre. Comme le note Robin, « le conservatisme est la voix théorique de cette animosité contre l’action (agency) des classes subordonnées. Il fournit l’argument le plus cohérent et le plus profond pour expliquer pourquoi les classes inférieures ne devraient pas être autorisées à exercer leur volonté indépendante, pourquoi elles ne devraient pas être autorisées à se gouverner elles-mêmes ou à gouverner la collectivité. La soumission est leur premier devoir, et l’action est l’apanage de l’élite18 ». Cela ne signifie pas que les réactionnaires, dans le contexte actuel, ne chercheront pas à parler au nom du peuple, ou même à prétendre parler au nom des « minorités » ou des « laissés-pour-compte »19. Nous ne devons toutefois pas considérer la construction d’un peuple réactionnaire par l’élite réactionnaire comme un signe qu’elle est effectivement attachée aux principes démocratiques. Cela devrait être évident, mais c’est pourtant le contraire qui prévaut dans le discours public.
En fin de compte, et malgré toutes les revendications de rébellion contre une élite conspiratrice, la cancel culture et la volonté de dire la vérité au pouvoir, le cœur de la politique réactionnaire est un projet lâche qui vise à protéger et à restaurer les privilèges et les hiérarchies arbitraires de l’oppression.
Notes
1
Ce texte a été publié en ligne le 16 septembre 2025 sur le site du Reactionary Politics Research Network (ReacPol), sous le titre « On reactionary politics ». https://reacpol.net/on-reactionary-politics/
2
Charles W. Mills, Le Contrat racial, traduit de l'anglais (État-Unis) par Aly Ndiaye Montréal, Mémoire d'encrier, 2023 [1997] ; Shannon Sullivan et Nancy Tuana (dir.), Race and epistemologies of ignorance, New York, State University of New York Press, 2007.
3
Anthony Giddens, La Constitution de la société, Paris, Presses universitaires de France, 1987 ; Yannis Stavrakakis, Populist Discourse: Recasting Populism Research, New York, Routledge, 2024.
4
Pour un aperçu détaillé, voir George Henry Newth, Katy Brown et Aurelien Mondon, « Researching and Understanding Far-Right Politics in Times of Mainstreaming », Journal of Race, Ethnicity, and Politics, 2025, p. 1‑24.
5
Nicolas Lebourg, Jonathan Preda et Joseph Beauregard, Aux racines du FN. L’histoire du mouvement Ordre nouveau, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2014.
6
Stéphane François, La Nouvelle Droite et ses dissidences : identité, écologie et paganisme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021.
7
Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 ; Annie Collovald, Le « populisme du FN » : un dangereux contresens, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2004.
8
Aurelien Mondon et Aaron Winter, « Articulations of Islamophobia : from the extreme to the mainstream ? », Ethnic and Racial Studies, vol. 40, n.° 13, 2017, p. 2151‑2179.
9
Annie Collovald, Le « populisme du FN » : un dangereux contresens, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2004.
10
Voir l’excellente recherche de Sophia Hunger et Fred Paxton sur les abus du recours au concept de populisme dans le monde universitaire : Sophia Hunger et Fred Paxton, « What’s in a buzzword? A systematic review of the state of populism research in political science », Political Science Research and Methods, vol. 10, n.° 3, 2022, p. 617‑633.
11
Katy Brown, Aurelien Mondon et Aaron Winter, « The far right, the mainstream and mainstreaming: towards a heuristic framework », Journal of Political Ideologies, 2021, p. 1‑18.
12
Aurelien Mondon et Aaron Winter, Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream, Londres, Verso Books, 2020.
13
Aurelien Mondon et Aaron Winter, Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream, Londres, Verso Books, 2020.
14
Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, Oxford, New York, Oxford University Press, 2017.
15
Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, Oxford, New York, Oxford University Press, 2017, p. 39.
16
bell hooks, De la marge au centre. Théorie féministe, traduit de l’anglais (États-Unis) par Noomi B. Grüsig, Paris, Cambourakis,2027 [2015].
17
Camila Vergara, « Populism as Plebeian Politics: Inequality, Domination, and Popular Empowerment », Journal of Political Philosophy, vol. 28, n.° 2, 2020, p. 222‑246.
18
Corey Robin, The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, Oxford, New York, Oxford University Press, 2017, p. 9.
19
Jan Dobbernack, « Making the left behind as a subject of crisis », The Sociological Review, vol. 72, n.° 2, 2024, p. 258‑275 ; Aurélien Mondon et Aaron Winter, « Whiteness, populism and the racialisation of the working class in the United Kingdom and the United States », Identities, vol. 26, n.° 5, 2019, p. 510‑528 ; Aurelien Mondon et Aaron Winter, Reactionary Democracy: How Racism and the Populist Far Right Became Mainstream, Londres, Verso Books, 2020.










