À propos d’Octave Debary, La Ressemblance dans l’œuvre de Jochen Gerz / Resemblance in the work of Jochen Gerz (Paris, Créaphis Éditions, 2017).
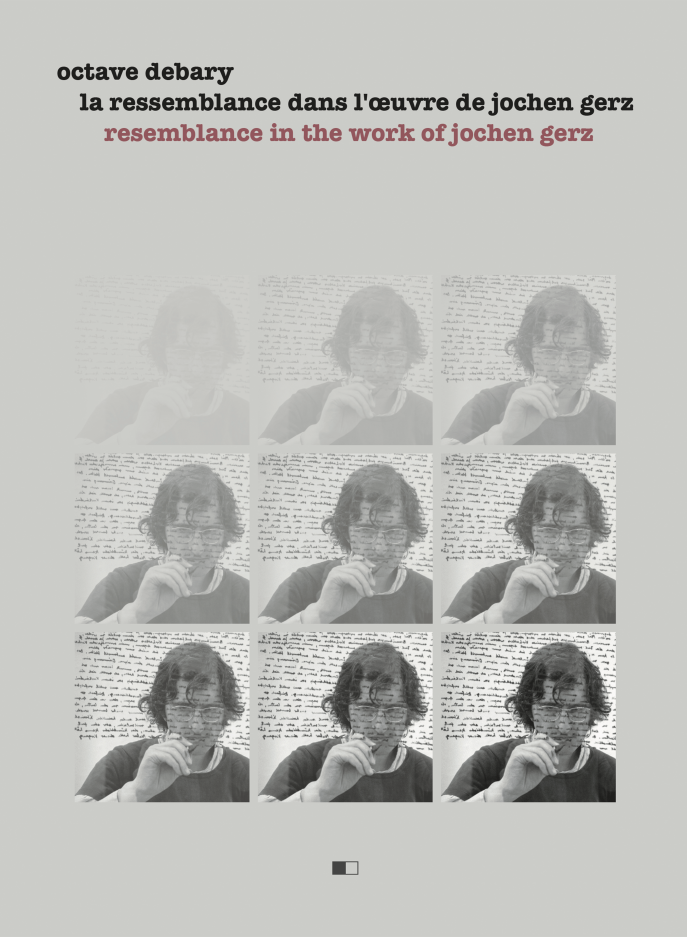
Comment des inventions artistiques éminemment individuelles provoquent des mémoires communes ou susceptibles d’usages publiques ? Cette problématique est sous-jacente aux divers thèmes de réflexion que La Ressemblance dans l’œuvre de Jochen Gerz suscite. Dans ce livre, Octave Debary prolonge son questionnement sur les liens entre les objets et la mémoire en dialoguant avec le plasticien allemand. Né en 1940, celui-ci est, depuis désormais cinquante ans, une figure de premier plan dans la conception de « contre-monuments » et d’actions qui interrogent, entre autres, la prégnance conceptuelle et phénoménologique de l’oubli dans nos rapports à l’histoire. Ses productions hétéroclites sondent aussi les possibilités de mettre en scène la présence/absence du passé à travers la disparition des supports susceptibles de l’évoquer.
Issu de rencontres suivies entre l’anthropologue et le plasticien, le texte évite les écueils rhétoriques de certaines liaisons ethnographiques dites « collaboratives », où le chercheur fait souvent « comme si » il partageait sa position de détenteur/praticien d’un discours ayant une portée objectivante et de responsable de ses aboutissements heuristiques. Si des extraits écrits par Gerz intègrent le corps du texte – ils y sont reconnaissables car imprimés en bleu –, au cours de la lecture, nous ne perdons pas de vue le propos de l’auteur, dans sa relation à une pensée créative qui est son véritable terrain d’enquête. À l’appui d’un appareil illustratif étoffé, le livre bilingue (français et anglais) est constitué d’une introduction où il restitue la genèse de son intérêt pour l’œuvre en question, d’un chapitre plus théorique (« L’art de se passer des objets »), d’une partie consacrée aux monuments et aux performances dont Gerz a été le concepteur et d’une conclusion dans laquelle Debary revient sur la notion de « ressemblance » mise en exergue dans le titre du volume. Intitulée « Catalogue des œuvres citées », une annexe d’images nous permet de parcourir les réalisations traitées dans le texte.
Dans l’introduction, Debary, né en 1972, écrit qu’un jour il lui faudra « retourner1à Auschwitz pour la première fois » (p. 15). Un tel imaginaire premier-retour exprime ici l’attente d’une visite ressentie comme nécessaire dans un lieu de l’histoire devenu site muséal. La formule d’un « premier-retour » rendrait compte du fait que certaines de nos visions mémorielles émanent de l’existence d’un déjà su ou montré que les entreprises de Gerz reprennent et escamotent, dans leur confrontation à des événements historiquement dramatiques et à des situations socialement sensibles. Les images et les objets qui pourraient en témoigner sont aperçus et saisis, à rebours des injonctions propres à la plupart des dispositifs commémoratifs institutionnels, à travers leur être en cours pérenne d’effacement ou d’épuisement.
Dans leur évanescence – parfois programmée par l’artiste –, ces images et ces objets s’apparentent à des formes « ressemblantes » aux manifestations sensibles et irréversibles de leur souvenir.
À travers le rappel de notre condition d’être oublieux, la conscience de la labilité d’une mémoire-sans-devoirs est ici vécue comme une humaine possibilité de s’opposer vainement – mais de s’y opposer quand même – à l’amnésie. Chez Gerz, il est donc question d’un affrontement entre l’artiste et l’inanité du principe qui prétend contenir le temps révolu dans une durée pétrifiée. C’est le cas par exemple du « Monument contre le fascisme » de Harburg (1986) et du « Monument contre le racisme » de Sarrebruck (1993), créés par Gerz pour faire l’objet, s’agissant du premier, d’un enterrement progressif et, pour le second, d’un enfouissement préalable.


Jochen Gerz, 2146 Pierres – Monument contre le Racisme / Le Monument invisible, Sarrebruck (1993)
Ces monuments semblent également révéler la ruse signalée par Andrew James Young dans sa réflexion sur les mémoriaux de l’Holocauste2. En se référant aux œuvres de Gerz comme à des contre-exemples, Young s’est intéressé à des édifications architecturales où la question de la mémoire collective doit être interrogée à travers l’analyse de la « texture » qui rend rituellement et institutionnellement transmissible certaines de leurs significations et de leurs ambiguïtés. Parmi ces ambiguïtés, Young relève le fait que :
by creating common spaces for memory, monuments propagate the illusion of a common memory [...] By creating the sense of a shared past, such institutions as national memorial days, for example, foster the sense of a common present and future, even a sense of shared national destiny.
In this way, memorials provide the sites where groups of people gather to create a common pas for themselves, places where they tell the constitutive narratives, their “shared” stories of past3.
En ce sens, il me semble qu’une partie de l’œuvre de Gerz peut être lue aussi comme une critique en acte des ambiguïtés commémoratives mises en exergue par Young.
Dès l’âge de 19 ans, Gerz a quitté l’Allemagne ; il y est retourné ponctuellement, sans jamais s’y installer de nouveau. Son parcours rappelle celui de W. G. Sebald, né en 1944, un autre Allemand revenant dans son œuvre sur les lieux et les temps d’une mémoire de l’après la catastrophe qu’il ne pouvait/voulait plus habiter. Les créations de Gerz sont périssables, soumises ab origine à leur extinction que l’artiste tente de partager dans les rues, avec les « gens ». L’usage d’un tel terme, qui revient à plusieurs reprises sous la plume de Debary, est à plusieurs égards problématique, notamment à cause de son caractère allusif à une dimension ordinaire ou quotidienne, sorte de contrepoids discursif à ceux qui ne seraient pas les « gens » et ne vivraient pas dans les « rues ». S’il comporte le risque de réifier une entité collective floue, chez Debary, « les gens » ne semble pas indiquer la recherche par Gerz d’une altérité vaguement populaire et de ses coutumes, mais plutôt une intention « démocratique », que l’artiste revendique comme une des sources de son inspiration. Ce terme dénoterait aussi la quête d’un art public de la mémoire en quelque sorte désenclavé des périmètres et des itinéraires commémoratifs officiels. Bien entendu, la recherche d’un tel désenclavement interroge, à son tour, les conditions concrètes de sa mise en pratique qui peut nécessiter aussi d’une négociation avec des pouvoirs officiels. À cet égard, les actions de Gerz sont à la fois « hors-les-murs » et l’effet du soutien politique nécessaire à leur réalisabilité et au retentissement de leurs effets médiatiques de réception.
Dans le chapitre « L’art de se passer des objets », il est d’abord question de la rencontre initiale de Debary avec l’œuvre du Gerz, lors d’un séjour à Roubaix en 2000. L’anthropologue avait alors découvert, sur la façade de l’Hôtel de la Ville, une installation de portraits géants. Ils avaient été conçus, lors d’une exposition à l’école de photographie du Fresnoy, comme des images de soi à échanger entre inconnus.

Jochen Gerz, Le Cadeau, Le Fresnoy, 2000.
Ainsi, un certain nombre d’habitants de la région avaient été appelés à se faire photographier, en recevant en contre-don, non pas leur cliché, mais celui d’un autre individu. Les 702 portraits réalisés à la fin de l’exposition étaient destinés à être accrochés aux murs de foyers particuliers. Dans un environnement en crise sur le plan économique et social, ce dispositif de circulation d’identités anonymes avait été pensé par Gerz comme la recherche d’un lien à la fois visible et intime au sein de la population locale. Debary considère qu’une telle circulation d’objet-image de l’autre-inconnu se réalise comme « une perte de soi paradoxale parce qu’elle signifie un retour à soi » : « Cette mise en retrait est la condition de l’art, un moyen de survivre à son histoire, à son passé, à ses souvenirs » (p. 39).
D’une manière plus générale, l’art de Gerz semble être ressenti par Debary comme un savoir/pouvoir vivre à la fois parmi les ruines de la guerre et les héritages du passé en temps de paix. Dans le prolongement de cette perspective, un des passages les plus significatifs du livre est constitué de la mise en relation entre une réflexion de l’auteur et l’extrait d’un texte de son interlocuteur :
L’oubli signe l’identité entre l’individu et le monde, car la disparition d’une chose (matérielle ou mentale), son oubli, vient dire la communion avec le monde. À l’inverse, percevoir une chose (la clairvoyance du monde), se la représenter, renvoie à une mise à distance, à une non-rencontre. (Debary, p. 43-44)
Oublier quelque chose peut aussi signifier être totalement cette chose. Être cette chose à tel point qu’on ne peut même pas se l’imaginer avec notre œil intérieur, sans parler de la voir. Voir signifier accepter un état de séparation, s’y faire. (Gerz, p. 44)4.
Ce passage suscite un questionnement qui va bien au-delà de l’œuvre de Gerz pour interroger les situations où « la politique mémorielle de l’objet et de la pierre est travaillée par l’oubli » (p. 57). L’invisibilité des monuments que, bien avant Gerz, Robert Musil avait repéré comme une des caractéristiques saillantes de leur présence dans l’espace public5, peut alors être interrogée par un regard ironique, en réalité un regard qui doute « des identités, des frontières, des murs qui séparent la vie – du musée ou de l’art » (p. 66). En ce sens, nous dit Gerz : « les monuments ne m’intéressent que pour faire revenir les gens, pour démentir leur disparition » (p. 69). Dans la partie intitulée « Monuments », au fil de sa conversation avec l’artiste, Debary l’interpelle sur cette disparition programmée, à l’œuvre dans certaines de ses réalisations. À propos du « Monument contre le fascisme », il écrit :
la colonne s’enfonce au fur et à mesure de l’apposition des signatures. Elle est faite pour disparaître. En descendant, elle redevient une archive vierge ; en même temps, elle archive les signatures. (p. 89)
Dans le « Monument contre le racisme » de Sarrrebruck, « le dispositif consiste à retrouver les noms des cimetières juifs présents en Allemagne en 1933, puis de les graver, face cachée, sous les pavés de l’allée qui conduit au château6» (p. 99). De ce fait, à travers leurs échos publics, les traces et les monuments disparus ou à disparaître deviennent les récits de leur durée de simulacres invisibles, mais pleins d’histoire. La gravité ici n’est pas celle de la pierre ou de la plaque, mais celle d’un geste artistique ressemblant simultanément à l’intensité imagée de l’expérience qui fut vécue et à la faiblesse de la transmission de son souvenir. Debary affirme alors : « Gerz plaide, lui, pour une poétique de la disparition de l’objet en sacrifiant sa visibilité » (p. 93) et en reprenant un commentaire sur l’œuvre de Gerz émis par Young il parle d’un souvenir de la disparition :
Tout ce qui reste c’est le souvenir d’un monument, une image rémanente projetée par la mémoire sur un paysage. Le meilleur monument, dans l’optique de Gerz, n’est d’ailleurs peut-être pas un monument, mais plutôt le souvenir d’un monument absent7. (p. 93).
Dans cette perspective, au renfort d’une autre formule de Young, l’œuvre de Gerz peut être envisagée comme une neutralisation de l’imagerie monumentale relevant du « syndrome de la tombe absente8». Ce syndrome affecterait des sites où l’injonction de rendre compte de la Shoah impose de rendre la disparition visible dans ceux que Ruth Klüger, ancienne déportée, toujours au sujet des camps d’extermination, considère des « anti-musées qui ne parlent que de désintégration9» et, pouvons-nous ajouter, d’oubli du lieu « extraordinairement concret10» d’un passé qui ne peut être que fantasmé. Une telle machinerie monumentale est, selon Klüger, le signe d’une :
coupure entre autrefois et maintenant, entre nous et eux, qui ne sert pas la vérité mais la paresse. On sépare radicalement les spectateurs des victimes, c’est sans doute l’une des fonctions des musées des camps, qui réalisent ainsi l’objectif exactement inverse de la mission qu’ils prétendent se donner11.
Contrairement à la recherche d’une Mémorial agissant comme un tombeau symbolique, chez Gerz, c’est le Mémorial-monument lui-même qui subit une disparition pensée comme pourvue d’une faculté mnésique.
Dans la partie conclusive de son ouvrage, Debary revient sur la notion de « ressemblance ». Sa signification semble ici se constituer en opposition au principe de la différence comme bâtisseur de l’idée de culture et de ses actuations. Selon l’interprétation que Debary propose de la pensée de Gerz :
la contagion de la culture signe la fin d’une réciprocité avec l’autre, la fin de l’idée de ressemblance. L’expression des différences se pose au principe de la reconnaissance culturelle des autres laissés à leur altérité. (p. 130).
Nous retrouvons, ici, une appréhension anthropologique de l’œuvre de l’artiste suscitée par une poétique de la perte qui libère en partie les objets de nos souvenirs directs ou médiats de la prescription à devenir des « fétiches du passé12». Chez Gerz, un message implicitement ou involontairement christique semble accompagner la disparition de l’objet en épiphanie d’un souvenir de la ressemblance entre les événements finis et leur résurgence sous forme d’un oubli actif, c’est-à-dire raconté par les gestes des gens de la cité. Ici, ces gens ne sacrifient pas (ou plus) au fétiche, mais le fétiche mémoriel lui-même (l’objet, le monument, la photographie) est sacrifié ou (se) sacrifie pour eux. Le fétiche pensé comme étant en voie de disparition ne saisit pas les vivants et ces derniers ne le saisissent pas, car ils ne sont pas ses témoins, ses adeptes ou ses « clients », sinon sous forme d’acteurs ayant conscience d’un oubli à-venir et à combattre. Cependant, la prise en charge (par l’artiste-concepteur) de cet oubli semble répondre à la volonté de produire une scène propitiatoire. La disparition rachèterait ainsi la vie, notre être-là contre le menace de ce qui reste toujours à distinguer et à retenir dans le passé à faire passer et dans le présent à partager. Il s’agirait ainsi de penser un lien social non-objectal à travers une sortie partielle du « génie du paganisme13» des objets commémoratifs et de penser :
une économie de la dette réciproque […] où la conversion centrale est celle de la perte de l’objet commuée en mouvements, en paroles. L’objet perdu engage à donner une parole. Ce qu’il ne dit pas ou plus, voilà ce qu’il faut raconter. Le devoir de mémoire oblige le présent à prendre la place – laissée absente – par le passé, comme par l’objet. (p. 137).
Un adage populaire qu’on peut couramment entendre au Bénin dit que « les morts ne sont pas morts », justement à travers la perpétuation cérémonielle, des choses et des masques qui les transforment en figures agissantes – pouvant être pour les vivants, protectrices ou agressives – de leur propre souvenir. Contrairement au vœu ultime exprimé par un tel adage, les choses et les masques du souvenir sont « sacrifiés » par Gerz avant qu’ils ne puissent déployer l’efficacité symbolique qui, dans certaines sociétés ou sur de nombreux sites monumentaux, est demandée aux faits et aux êtres qu’on rappelle et commémore : oublier in fine.
Notes
1
Souligné par l'auteur.
2
James E. Young, The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven and London, Yale University, 1993.
3
James E. Young, The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven and London, Yale University, 1993, p. 6.
4
Ce passage est extrait de Jochen Gerz, « La beauté de la rétine (du jeu et de ses règles) », installation, Hanovre 1978, in J. Gerz, De l’art. Textes depuis 1969, Paris, ENSBA, 1994.
5
Robert Musil, Œuvres pré-posthumes [1935], Paris, Le Seuil, 1965.
6
De nos jours, le château est le siège du Parlement de la Sarre.
7
Ce passage est un extrait de James E. Young, The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven and London, Yale University, 1993, p. 32.
8
James E. Young, « Écrire le monument : site, mémoire, critique », Annales. ESC, 1993, 48e année, n° 3, p. 729.
9
Ruth Klüger, Refus de témoigner. Une jeunesse, Paris, Viviane Hamy, 1997, p. 290.
10
Ruth Klüger, Refus de témoigner. Une jeunesse, Paris, Viviane Hamy, 1997, p. 290.
11
Ruth Klüger, Refus de témoigner. Une jeunesse, Paris, Viviane Hamy, 1997, p. 97.
12
Sur l’expression de « fétiche du passé », voir : Ruth Klüger, Refus de témoigner. Une jeunesse, Paris, Viviane Hamy, 1997, p. 332.
En ce qui concerne l’usage de cette formule, Klüger s’inspire des théories de Ludwig Giesz dans son livre Phänomelogie des Kitsches.
13
Marc Augé, Génie du paganisme, Paris, Gallimard, 1982.










