Entretien avec Saskia Eleonora Wieringa, professeure émérite de l’université d’Amsterdam et co-fondatrice du Kartini Asia Network
L’Indonésie a beau être une des démocraties les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, après les élections du 14 février 2024, la postérité de l’ère du président Joko Widodo (dit Jokowi, 2014-2024) – initialement porté par les pro-démocrates et les progressistes, il s’est progressivement allié avec ses opposants conservateurs et illibéraux – est incertaine. Le Président laisse derrière lui un paysage politique fragmenté qui a peu de chance de donner naissance à une vraie représentation du peuple. Non seulement il a soutenu la candidature de son fils, Gibran Rakabuming Raka, à la vice-présidence aux côtés de son ancien rival, le conservateur Prabowo Subianto, mais de nombreuses fractions de la société civile ont le sentiment de ne pas avoir de perspective historique. Compte tenu de ces incertitudes, il est important de revenir sur l’histoire du pays. « Deux raisons justifient que nous nous plongions dans l’histoire, écrivait Jasper Griffin, professeur de lettres classiques. La curiosité pour le passé, ce qui a eu lieu, qui a fait quoi et pourquoi ; le désir de comprendre le présent, de situer et interpréter notre époque, notre expérience et nos espoirs pour l’avenir1 ». Tel est l’esprit qui préside à l’entretien qui suit avec Saskia Wieringa, professeure émérite de la Faculté des sciences sociales et comportementales de l’université d’Amsterdam, spécialiste des relations interculturelles de personnes du même sexe.
Près de trente ans après la fin du régime de Suharto (1966-1998), nous nous pencherons donc sur l’histoire contemporaine de l’Indonésie au prisme des travaux de Saskia Wieringa, auteure de nombreux articles et de livres consacrés aux mouvements féministes indonésiens, dont plusieurs ont été écrits avec Nursyahbani Katjasungkana, avocate féministe et militante des droits humains. Citons notamment Propaganda and Genocide in Indonesia : Imagining Evil, et Sexual Politics in Indonesia, deux ouvrages dans lesquels Saskia Wieringa se penche sur le rôle du féminisme en Indonésie et le Mouvement du 30 septembre 1965. Connu sous le nom G30S (Gerakan 30 septembre), cet épisode a initié une séquence qui a fait entre 500 000 et trois millions de victimes dont la plupart appartenaient aux milieux intellectuels de gauche au sens large, avec en première ligne les membres et sympathisants du Parti communiste indonésien (PKI) et de l’association que celui-ci parrainait, le GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia, Mouvement des femmes indonésiennes). L’entretien analysera aussi l’influence du régime de Suharto sur la perception et la vision sociale et politique du pays en revenant sur la période de réformes de démocratisation et de décentralisation initiée en 1998 (Reformasi).
Les sujets abordés, qui vont de l’histoire des mouvements politiques à l’époque de Suharto au récit officiel actuel, soulignent que l’Indonésie manque d’une vision sociale commune. Les minorités, dont la communauté LGBT, ont tendance à être des boucs émissaires qui servent à masquer les vrais problèmes sociopolitiques, dont celui d’inégalités particulièrement marquées.
Vos travaux font la part belle aux événements de 1965-1966 et à leurs conséquences à long terme : pourquoi avoir choisi ce sujet et pourquoi est-il important pour les jeunes générations aujourd’hui ?
Les événements de 1965 sont la plus flagrante violation des droits humains de l’histoire contemporaine de l’Indonésie. Entre un demi-million et trois millions de personnes (le nombre exact dépend des spécialistes que vous citez) ont été assassinées en quelques mois. Des centaines de milliers ont été arrêtées, dont plusieurs milliers sont mortes en prison. Il s’agit du massacre de masse le plus important de l’histoire indonésienne. Plus important que celui de la guerre d’indépendance et que ceux de toutes les guerres (il y en a eu 400 en tout) que les Néerlandais ont infligées à l’Indonésie. Il est donc possible parler de génocide, pas seulement de massacre.
Personne n’a jamais vraiment mesuré l’influence que ce génocide a eu sur la vie indonésienne ; j’irai même plus loin, aujourd’hui en Indonésie, personne ne comprend vraiment l’idée de génocide. J’ai commencé à me pencher sur le mouvement des femmes au début des années 1980 parce que je me demandais pourquoi il était aussi faible alors que, dans les années 1950 et au début des années 1960, l’Indonésie était connue pour avoir un féminisme particulièrement dynamique. Comment se faisait-il que toutes ces personnalités, toute cette force, cette aura internationale, aient disparu aussi vite après la suppression, puis l’éradication du GERWANI par des organisations comme le Dharma Wanita et le Dharma Pertiwi ?
Outre le nombre de morts, c’est tout l’aliran (le « courant », le « mouvement ») de gauche qui a été détruit : non seulement des gens qui étaient membres du PKI (Parti communiste indonésien) ou du GERWANI, mais tout un mode de vie dont les racines culturelles et intellectuelles puisaient dans la société. Comme vous le savez, aujourd’hui, en Indonésie, le mouvement syndical est très faible, et chaque fois qu’il cherche à se faire entendre, on le traite de nouveau GERWANI ou de nouveau PKI. Les événements de 1965 hantent encore le pays, d’autant plus qu’ils sont liés à la Reformasi qui a suivi. Le fait est qu’après ce tournant, la structure est restée intacte. Suharto a été chassé, mais ses acolytes sont restés ; les généraux et les élites économiques n’ont pas bougé et ont pu modeler l’État en poursuivant leurs intérêts.
Prenons l’exemple de l’armée. Certains dignitaires se battent entre eux, vous avez des divergences importantes entre les différents corps, mais il y a une chose sur laquelle ils sont d’accord : il est hors de question de punir quiconque pour les crimes contre l’humanité de 1965. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. Ils le justifient en disant qu’il n’y a pas assez de preuves, ce qui est totalement absurde. La KOMNAS HAM (Commission nationale des droits de l’homme), par exemple, a un énorme dossier et des centaines d’entretiens extrêmement parlants. J’ai réussi à y avoir accès. Prenez l’île-prison de Buru, une réalité très bien documentée. Qui étaient les dirigeants ? Que s’est-il passé ? Il existe une quantité de livres, de déclarations et de témoignages à ce sujet. Qui sont les responsables ? Là aussi, la réponse est très claire. S’ils disent « Non, il n’y a pas de preuve, on ne peut pas revenir en arrière, c’est une vieille histoire » … regardez l’Allemagne : ils sont encore en train de juger les gardiens des prisons et des camps de concentration, 70 ou 80 ans après les faits.
L’idée qu’il n’y a pas de preuves est donc un prétexte. S’ils le veulent, ils peuvent obtenir des preuves très précises. Les victimes sont loin d’être timorées, elles sont courageuses et prêtes à témoigner, et les archives sont bel et bien là. Personne n’a jamais pu les consulter, mais j’imagine que si c’était possible, on aurait les informations à partir de ce type d’archives. Beaucoup d’archives locales ont été détruites. Mais là où je suis, près d’un des plus grands charniers – peut-être 800 corps dans le jardin botanique [Kebun raya] de Purwodadi –, les gens sont toujours là, la plupart des bourreaux sont morts, mais leurs familles sont là, les histoires sont connues et les villageois sont prêts à témoigner. Ils sont prêts à raconter leur histoire. Ce cancer de la société indonésienne ne disparaîtra pas sans qu’il y ait une forme de justice et de réconciliation. Cela dit, il y a fort à parier que les années à venir ne verront aucune justice. Jokowi l’a promis, mais il n’a évidemment rien fait parce que les généraux ont tout de suite débarqué en lui intimant de ne pas s’en mêler. Résultat, l’Indonésie vit avec cette blessure béante au cœur de sa conscience sociale, et le communisme joue le rôle de croque-mitaine. Tout le monde, partout, connaît les problèmes du communisme. Ses points faibles ont été mis en évidence ; personne n’a l’intention de relancer le PKI. Personne ne le fera, n’a la volonté ni la capacité de le faire. Ce n’est pas le sujet. Dans ce sens-là, le communisme a fait son temps. Si vous regardez la Chine et la Russie, il n’y a pas de communisme, du moins pas tel que Marx l’envisageait. Il n’empêche, nous avons besoin d’un autre type de conscience sociale, pas celle du communisme de Marx ni des partis européens ou latino-américains, mais d’une conscience sociale qui valoriserait l’humanité des gens, ainsi que les idées d’égalité et de justice sociale. Chaque fois que vous essayez d’en faire part ou d’en parler, vous êtes dans la tourmente, diabolisé, traité de GERWANI ou de nouveau PKI. Le débat sur la justice sociale et l’égalité a été confisqué. Les quatre personnes les plus riches d’Indonésie possèdent plus que 100 millions d’Indonésiens : les inégalités sont particulièrement criantes et douloureuses. À titre personnel, je pense que l’Indonésie ne réalisera jamais son potentiel d’État moderne tant que cette question ne sera pas résolue.
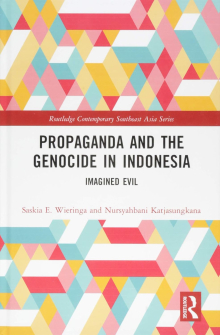
Saskia Wieringa et Nursyahbani Katjasungkana, Propaganda and the Genocide in Indonesia. Imagined Evil, Londres, Routledge, 2019.
Les travaux d’Hannah Arendt sur l’Allemagne nazie et la banalité du mal nous aident à comprendre les formes d’autoritarisme les plus extrêmes d’Asie. Pourriez-vous nous en dire plus sur l’acceptation du terme « génocide » et des événements qu’il qualifie en Indonésie ?
Ce sont des questions d’une très, très grande importance. La banalité du mal : en Indonésie, vous ne pouvez pas organiser un tel meurtre de masse, un génocide de telles proportions si vous n’avez d’appareil bureaucratique pour ce faire. En Indonésie cet appareil était à la fois juridique et médical, voire psychologique. J’ai fait des recherches sur le rôle des psychologues pour le livre Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagining Evil. Il n’y pas eu de processus judiciaire. Il est évident que tous les membres emprisonnés l’étaient pour des raisons absurdes : aucun n’avait commis le moindre crime. Dans ces conditions, qu’a fait l’État indonésien ? Il a mis au point un système de classification, style A, B, C et autres raffinements. La catégorie A comprenait les personnes directement impliquées dans les événements, dont la plupart ont été condamnées à mort et exécutées sur-le-champ. Mais les catégories B and C visaient clairement des personnes innocentes. Le groupe B était en général, mais pas toujours, très élastique et un peu chaotique, il comprenait des gens qui auraient pu avoir une position dirigeante ou avaient été des dirigeants locaux. Les gens du groupe C étaient ceux qui avaient simplement rejoint le mouvement, qui n’avaient pas de position dirigeante officielle et pouvaient être relâchés beaucoup plus tôt. Ceux du groupe B devaient être sous les verrous bien plus longtemps ; la plupart des prisonniers de l’île de Buru en étaient. Quels étaient les critères de cette répartition ? Des critères psychologiques, c’est-à-dire des tests liés au modèle de psychologie quantitative de Hans Eysenck, aujourd’hui jugé obsolète. Ils avaient une série de questions assorties de nombreuses variantes en fonction desquelles ils essayaient de savoir dans quelle mesure la personne était communiste et si elle était capable de s’intégrer à la société. Ce qui voulait dire qu’elle était capable de réciter le Coran et le Pancasila [la « philosophie » de l’État indonésien), et qu’il n’y avait pas la moindre trace de communisme en elle. Peu à peu les psychologues ont pris la place des opérateurs judiciaires officiels, et ils l’ont fait sans se faire prier.
À l’époque, la psychologie était encore une science naissante, à l’Université d’Indonésie (Jakarta) et à Bandung, par exemple, plusieurs dirigeants et éminents professeurs ayant introduit cette psychologie quantitative post-freudienne ont envoyé leurs étudiants dans les prisons pour qu’ils y fassent passer des tests. Aujourd’hui si vous les rencontrez – j’en ai interviewés un certain nombre –, ils ont tendance à le nier. Ils disent juste « Ah oui, on a fait passer quelques tests ». Je sais qu’ils y sont allés parce que j’ai des témoignages de gens qui ont été interrogés par eux. Ils nient avoir participé à la définition des catégories des prisonniers, donc à déterminer leur nombre d’années sous les verrous. Quel était le « tort » des prisonniers ? Quels délits avaient-ils commis ? Ils étaient membres d’une organisation parfaitement légitime à l’époque.
Je viens de finir des recherches sur les Minangkabaus (Sumatra Ouest) et j’ai lu plusieurs papiers publiés par l’Université Andalas. Je travaillais sur le GERWANI sur place, et ces papiers disaient : « Oh, ces gens ont été emprisonnés parce qu’ils étaient membres d’une association illégale. » Le GERWANI n’était pas illégal. Il a été contraint à le devenir en 1966, après le SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret, l’Ordre du 11 mars). Jusque-là, c’était une association légale. Ses membres étaient parfaitement connus quand ils ou elles ont été emprisonné-e-s. Sauf que les gens se disent qu’ils ou elles devaient avoir tort puisqu’on les a emprisonné-e-s. À Bukittinggi, c’est même pire ; du reste il faut faire très attention à ce qui s’est passé là-bas, l’épisode a provoqué des blessures profondes dans la société. On bute toujours sur la justification selon laquelle ces gens avaient tort, qu’ils méritaient leur punition, qu’ils méritaient qu’on leur confisque leur maison, qu’on les viole, qu’on les batte, qu’on les torture, qu’on leur impose je ne sais quoi pour leur interdire toute occupation significative, tout ça parce qu’ils avaient tort. Personne n’a fait de recherches pour savoir ce que cela signifiait, les gens n’en discutent jamais. Ils ne disent pas, « On nous a menti de a à z. Et nous, on a menti à notre entourage. » Cette épuration de la société, cette prise de conscience de soi n’a jamais eu cours. En Allemagne, ce processus de prise de conscience a pris du temps, d’autant que dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre, il y avait encore beaucoup de nazis. Mais malgré tout, les Allemands ont fait un vrai travail. Il est évident que le nazisme est jugé nuisible, et quiconque y est associé est coupable. En Indonésie, cela ne viendrait à l’idée de personne.
L’Ordre Nouveau (Orde Baru, le régime sous Suharto), les tueries, les assassinats, les emprisonnements, les exécutions : tout ça n’aurait jamais dû avoir lieu. Quiconque y a participé est coupable de crime mais il est impensable de le dire tout haut, ça peut vous valoir la prison. C’est pour ça qu’il est si difficile de bâtir une société ayant un secteur civil solide. Nous approchons des élections de 2024 et comme vous le savez, la situation politique est relativement calme. Mais il y a deux groupes qui s’attendent à être tirés de l’ombre, une fois de plus, et qui peuvent servir d’outil d’intimidation pour renforcer l’ego politique des uns et des autres. Le premier, ce sont les communistes, le second, les homosexuel-le-s. Il arrive même qu’ils soient associés. Vous avez des photos de banderoles affirmant « Kita tolak LGBT dan PKI » (« À bas les LGBT et le PKI »), qualifiant tous les LGBT de communistes et tous les communistes de LGBT, un non-sens absolu. C’est aussi là-dessus que mes recherches portaient au début. Je travaillais sur ce que j’appelle aujourd’hui la première « panique morale sexuelle » : la panique morale sexuelle orchestrée par Suharto qui accusait des jeunes filles, dont la plupart ne faisaient pas partie du GERWANI mais des Pemuda Rakyat [Jeunesses populaires] et d’autres organisations, d’avoir castré et tué les généraux.
Cette première « panique morale sexuelle » a été extrêmement efficace parce qu’un des axes de la propagande consistait à montrer le PKI entraînant des femmes à dépecer des chats, comme une sorte d’exercice. L’idée, c’était que le PKI était totalement inhumain. Aujourd’hui, on exploite la même tactique contre les LGBT. La deuxième « panique morale sexuelle » a commencé fin 2015 sachant que l’idée de perversion sexuelle est profondément ancrée dans la société, elle est perçue comme une grave menace pour la structure sociale, et contre l’islam, majoritaire. Ce qui explique que les deux – LGBT et PKI – se rejoignent aussi clairement. Je suis très inquiète à la perspective de 2024 parce que 2019 a montré que les partis politiques ont, en fait, très peu de points qui les différencient. Vous avez des leaders politiques, des visages, des egos avec un vague programme qu’ils sont prêts à échanger contre un autre. Personne n’a de fondement idéologique solide.
En 2019, Prabowo Subianto (actuel ministre de la Défense) et son parti, le Gerindra [le Mouvement de la grande Indonésie], et plusieurs tenants de la ligne dure ont retourné leur veste le plus vite possible pour faire ami-ami avec l’ancien rival, Jokowi. On est proche de ce que pense Ben Anderson : le pouvoir est au centre, et tant que ce pouvoir est contesté, vous avez des conflits, en revanche s’il est clair qu’un leader s’impose, le pouvoir est partagé. Parce qu’il faut maintenir la cohésion. C’est ce qui s’est passé en 2019, très clairement. Et j’ai peur que ce soit encore le cas en 2024. Regardez ce que les principaux candidats aux présidentielles ont à dire sur leurs programmes : rien. C’est un problème de personnalités. D’où la désinformation et la calomnie qui peuvent être très utiles : il suffit de dire que vos adversaires sont épouvantables parce qu’ils sont LGBT, parce qu’ils encouragent le communisme. Ils vont jusqu’à organiser des descentes dans des bars, des boîtes de nuit ou des séminaires. Tout ça parce que la société n’a toujours pas surmonté la profonde blessure de 1965, qui est, je le répète, un génocide.
Vous êtes connue pour avoir contribué à la création de l’IPT 19652. Y a-t-il eu des résultats du côté des Nations unies ?
Nous avons soumis un rapport au Conseil des droits de l’homme [des Nations unies] pour le cycle précédent, au moment où l’Indonésie a fait l’objet d’un Examen périodique universel. Le problème, c’est qu’il faut avoir un statut de consultant, ce que nous n’avons pas. Nous avons essayé de nous associer avec une autre organisation, mais personne n’avait envie de collaborer avec nous. Les gens pensaient que c’était un dossier trop dangereux. Personne n’a osé tenir compte de notre rapport. Nous avons soumis une déclaration en sous-entendant qu’elle n’émanait pas de notre contre-rapport, qu’elle n’avait pas de statut officiel, mais elle a été plus ou moins ignorée. Cette fois-ci, nous avons réessayé, mais personne ne voulait nous accueillir, du coup nous nous sommes efforcés d’obtenir un statut consultatif nous-mêmes. C’est un processus extrêmement important, long, difficile. Nous avons du mal à l’obtenir parce que nous sommes une petite association. Personne n’a envie de nous financer. Tout le monde pense : « L’Indonésie est un pays génial, merveilleux, mieux vaut ne pas le contrarier. » Conclusion, personne ne veut s’associer avec nous parce que personne ne veut prendre le risque.
Le GERWANI était un des mouvements féministes les plus importants d’Indonésie. Quel rôle a-t-il joué dans les années 1960, pourquoi était-il considéré comme un ennemi du régime et quel legs a-t-il transmis aux mouvements sociaux indonésiens actuels ?
Cela fait deux questions, non ? Commençons par essayer de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi il a fini par être controversé. Pendant la guerre d’indépendance (1945-1949), beaucoup de ses membres étaient actives, mais pas encore en tant qu’organisation, plutôt individuellement, à titre de membre du PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia ou Association des étudiants indonésiens), le mouvement de guérilla étudiant. Beaucoup avaient été radicalisées par le travail idéologique qui avait commencé avec la révolution. La rhétorique révolutionnaire était très antiféodale. C’était à la fois un mouvement antiféodal, un mouvement anticolonial et, bien sûr, un mouvement nationaliste. Beaucoup de femmes ont découvert le socialisme et le féminisme pendant la guérilla, quand elles y participaient. Certaines acceptaient la mission la plus dangereuse, celle de messagères chargées d’acheminer des courriers en franchissant les lignes ennemies. Par ailleurs, vous aviez pas mal de membres des mouvements socialistes et féministes antérieurs à 1942 qui s’étaient radicalisées et voulaient poursuivre la lutte. Quand elles se sont réunies en 1950, on comptait six ou sept associations de femmes assez radicales. Cette petite troupe de jeunes femmes et de dirigeantes plus âgées étaient très nationalistes, en même temps elles tenaient à mettre fin à ce qu’elles appelaient les vestiges féodaux de la société : les mariages forcés et tout ce qui empêchait les femmes d’être scolarisées, etc. Elles faisaient partie de l’avant-garde. Mais elles n’étaient pas les seules à l’époque. Il y avait aussi des associations de femmes de la classe moyenne qui étaient contre le féodalisme et pour le nationalisme.
Elles étaient très radicalisées, pas comme le GERWANI qui avait une sensibilité socialiste ; elles avaient une sensibilité nationaliste, indépendante et féministe. Beaucoup d’entre elles, dont les Femmes catholiques, de nombreuses associations musulmanes mais aussi des organisations nationalistes, sauf la Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia ou Fédération des femmes de la République indonésienne) se sont plus ou moins résignées à revenir au foyer, suivant l’idée que les femmes sont responsables de la cuisine et autres – la Perwari est la seule à avoir conservé ses références féministes sous la présidence de Soekarno. Elles étaient satisfaites de ce qui avait été obtenu, mais c’est aussi parce que leurs dirigeantes les ont freinées et que la révolution avait été accomplie. Soekarno répétait sans cesse « nous avons besoin d’une révolution complète », mais ce qu’il sous-entendait, c’était l’obtention de l’Irian Jaya (la Papouasie occidentale). Il y voyait l’accomplissement du mouvement nationaliste, de la libération totale du peuple. Il voulait aussi plus de socialisme de terrain. Or il a longtemps gouverné sans avoir assez de pouvoir pour y arriver.

Saskia Wieringa, Sexual Politics in Indonesia, New York, Palgrave Macmillan, 2002.
Peu à peu, de nombreuses associations plus traditionnelles de femmes ont perdu la ferveur liée à la révolution. Mais pas le GERWANI dont les femmes suivaient des cours, lisaient, avaient des leaders d’envergure internationale comme Alexandra Kollontaï et Clara Zetkin. Elles réfléchissaient, travaillaient, débattaient entre elles. Elles réclamaient davantage, elles voulaient participer à la vie politique. Elles voulaient que les hommes soient un peu plus responsables du foyer, voulaient continuer à militer. Dans Sexual Politics in Indonesia, je les appelle les « mères militantes ». Car elles étaient aussi mères. Vous savez que ibu est un mot indonésien qui signifie à la fois « mère » et « femme ». Elles ont conservé le statut et la fonction de la mère qui s’occupe des enfants et de la cuisine, mais elles tenaient à ce que les hommes soient un peu plus actifs à la maison. Elles étaient contre l’arrogance masculine qui consiste à empêcher son épouse ou ses filles de faire de meilleures études que soi-même. Du reste leurs femmes ont pris la direction de certaines associations, alors qu’eux-mêmes ne dirigeaient rien. Elles luttaient contre la polygamie, plus que la plupart des associations, à part, ça va de soi, les organisations de femmes chrétiennes. Au PKI et au Lekra (Institut pour la culture du peuple), si les hommes voulaient avoir une seconde épouse, elles pouvaient compter sur le GERWANI pour réagir et essayer, parfois avec un franc succès, de les écarter de l’association. Du côté des femmes, si les femmes acceptaient de devenir la seconde épouse d’un membre du PKI, elles étaient exclues du GERWANI. Elles étaient très radicales de ce point de vue, du moins l’époque les jugeait très radicales, sauf, évidemment, Soekarno qui a toujours été leur héros, à qui elles n’ont jamais reproché d’être un coureur.
La seule organisation qui a continué à s’y opposer est la Perwari, mais elle l’a payé très cher. Les femmes ont été stigmatisées sous prétexte d’anti-nationalisme parce qu’elles étaient contre la polygamie. Elles ont eu droit à des menaces de mort et de nombreux bâtons dans les roues. Cela dit, à leurs yeux Soekarno était toujours un leader exceptionnel, qui ne se trompait jamais. Le clivage entre le GERWANI et les autres associations de femmes s’est accentué en ce qui concerne les références socialistes. Beaucoup d’idées féministes socialistes ont commencé à essaimer à propos des salaires et autres. Les femmes du GERWANI continuaient à parler des droits des travailleurs et des paysans. Le fossé se creusait entre elles et les associations plus nationalistes qui s’opposaient moins au moule de femme au foyer dans lequel elles s’étaient plus ou moins coulées. Il s’agissait de femmes traditionnelles, heureuses de voir que leur mari faisait carrière alors qu’elles-mêmes n’avaient pas à en faire. Les tensions se manifestaient davantage à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, cadre où les femmes continuaient à s’impliquer parce que c’était un travail très concret : cours d’alphabétisation, cours de couture, etc. S’il y avait une catastrophe, une inondation ou une éruption volcanique, tout le monde se réunissait et travaillait main dans la main.
Quoi qu’il en soit, le GERWANI était l’association de femmes la plus radicale. Mais la plus féministe était la Perwari, qui a pourtant été ignorée et a perdu beaucoup d’importance à cause des encouragements qu’elle a obtenue du gouvernement Soekarno. Vous aviez aussi les associations de femmes musulmanes qui n’avaient aucun problème avec la polygamie. Beaucoup de dirigeantes affirmaient à titre individuel : « Ça n’existe pas, une femme qui aime la polygamie, mais notre religion l’autorise, donc nous devons l’autoriser. » Le clivage est devenu évident en 1965, mais le GERWANI dominait toujours. Il se targuait d’avoir trois millions de membres. Je pense que le chiffre est exagéré parce qu’en général les chiffres étaient très importants – le PKI affirmait aussi avoir plusieurs millions de membres. En fait, le GERWANI en comptait sans doute entre un et deux millions, ce qui est énorme et en faisait l’association de femmes la plus importante hors du bloc communiste, juste après les fédérations russe et chinoise ; ses membres ont joué un rôle de premier plan dans le monde. Elles dominaient les associations-cadres nationales, ce qui provoquait du ressentiment parce que les voix des autres associations, beaucoup plus traditionnelles, étaient étouffées.
Le GERWANI dominait idéologiquement, côté féminisme et socialisme, mais il dominait aussi quantitativement et grâce au travail sans relâche de ses cadres. Aucune association ne travaillait aussi dur que les membres du GERWANI. J’en ai rencontré beaucoup, et aujourd’hui encore je discute avec des dirigeantes locales qui allaient pieds nus, leurs jours de congé, dans des villages reculés pour enseigner aux femmes à lire et à écrire. Vous savez, aucune association de femmes ne s’y collait. Elles s’en tenaient aux villes et organisaient des réunions sympathiques ; le GERWANI, lui, réunissait les femmes des quartiers et leur demandait quels étaient leurs problèmes. Il les approchait en tenant compte des usages des femmes indonésiennes, par exemple en leur proposant des cours de cuisine. Sauf qu’il ne s’est jamais limité aux cours de cuisine. Ces cours étaient toujours imprégnés de ce qu’elles appelaient « un contenu juridique ». « Pourquoi le prix du riz est-il aussi élevé ? Pourquoi est-il si difficile d’avoir du tofu ? Pourquoi nos salaires sont-ils aussi faibles ? Pourquoi nous ? Pourquoi est-ce qu’on a autant de mal à avoir des bons produits ? Et pourquoi sommes-nous si pauvres ? ». Elles leur donnaient toujours un contenu politique. Plus tard, après 1973, quand le PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, ou Éducation au bien-être familial) est né, cette association d’État a repris de nombreux programmes du GERWANI, notamment les réunions de quartier, mais elle a complétement effacé le contenu politique.
Dans les années 1970, quand j’ai découvert le PKK et que j’ai assisté à leurs réunions, ce qui comptait, c’était la présentation des plats, comment présenter les tomates ou les légumes. Est-ce que c’est élégant ? Il ne s’agissait pas de savoir : est-ce que c’est un plat nourrissant ? Est-ce que ces produits sont adaptés aux plus pauvres ? Aucune discussion sur le prix du riz, des légumes et du reste. Elles choisissaient certains éléments, l’habillage extérieur, je dirais, et laissaient de côté le contenu. Voilà exactement ce qui s’est passé entre le 30 septembre 1965 et la destruction du GERWANI. Quand j’ai commencé mes recherches sur le GERWANI au début des années 1980, personne n’était au courant de toutes ces choses. Personne n’en parlait.
Les jeunes féministes n’étaient pas encore actives à l’époque. Je ne trouvais personne avec qui parler de ces questions et j’ai été très surprise quand brusquement je me suis dit que tout ce que je pourrais étudier, c’était la transition entre certaines associations de femmes avant 1965 et après 1965. Je pensais à l’Association des femmes catholiques et à la Perwari, mais je ne pensais pas avoir accès au GERWANI, c’est lui qui est venu vers moi. Les militantes m’ont contactée parce que j’avais un peu travaillé sur le socialisme. Elles m’ont demandé de poursuivre ces recherches pour elles. C’est ce que j’ai fait. Ç’a été une décision difficile à prendre, mais je crois que ce fut une décision très importante. Et je suis, bien sûr, heureuse de l’avoir prise.
Finalement, ça m’a coûté cher. J’ai été sur liste noire pendant 13 ans quand ils ont découvert que j’avais travaillé sur le GERWANI. Cela dit, mes premiers articles, ce qui nous amène à votre deuxième question, ont tout de suite été repris, car dès le milieu et la fin des années 1980, alors que je n’avais plus le droit d’aller en Indonésie, les premiers groupes féministes sont réapparus. Notamment à Yogyakarta et à Jakarta. Certaines des femmes que je rencontrais hors d’Indonésie – j’enseignais les études sur les femmes un peu partout – ont mis la main sur mes articles, elles les ont traduits et les ont utilisés pour leurs formations. Elles ne m’ont rien demandé, évidemment. C’est en 1995, à Pékin, lors de la Conférence mondiale des femmes, que j’ai compris qu’elles s’étaient formées en s’appuyant sur mes articles ; elles avaient lu mes papiers, découvert la critique du PKK, les effets du changement, l’histoire du GERWANI. Elles avaient conscience que leur association était terriblement faible à ce moment-là. Les restrictions politiques, elles les connaissaient, mais elles ont découvert l’histoire de leur propre mouvement de femmes grâce à mes articles. C’était donc du matériel de formation pour elles. Comme en Russie, on parlait de samizdat, non ? C’était illégal. Elles les photocopiaient, elles les retapaient. Plus tard, je suis tombée sur certaines copies, elles s’en servaient vraiment.
En 1995, je me suis manifestée par des lettres et des visites, mais pas en allant en Indonésie. Je n’ai pu y aller qu’en 1998, alors que mon analyse était désormais acceptée et devenue un classique du mouvement des femmes indonésiennes. Il m’a fallu beaucoup de temps pour finir ma thèse de doctorat parce que je ne pouvais pas retourner en Indonésie. J’étais interdite d’entrée, mais je m’étais engagée à être responsable de la sécurité de mes informatrices, des femmes que j’interviewais. Il fallait que j’y retourne et que je leur demande de me relire parce qu’il ne s’agissait pas seulement de les anonymiser. Si j’écrivais que telle femme avait été interviewée à tel endroit, et qu’elle dirigeait telle ou telle chose, ils pouvaient la retrouver ; ces femmes seraient à nouveau emprisonnées ou exécutées à cause de mes recherches. C’était exclu. Il a fallu que je vérifie avec elles, ce qui a pris du temps. C’est pourquoi mon livre n’est sorti qu’en 1995. En 2002, il a été publié en anglais. Mais à cette date, le mouvement des femmes indonésiennes avait accepté ma thèse sur leur politisation profonde, sur la destruction de leur mouvement et les calomnies sexuelles auxquelles elles continuaient à avoir droit parce qu’on les accusait souvent d’être un GERWANI baru (un nouveau GERWANI) si elles s’engageaient politiquement. La situation est toujours très difficile. J’ai suivi le mouvement des femmes et le développement de la société civile en Indonésie. Le mouvement des femmes n’est pas le seul à avoir perdu, évidemment. C’est tout le mouvement socialiste, toute la famille socialiste qui a été détruite. Pas seulement la famille au sens physique, les membres, mais la pensée, l’idée qu’il existe un avenir fait de plus d’égalité, d’humanité, et de droits humains.
Ce que j’aimais avec le GERWANI, c’est qu’elles avaient une vision de la société qu’elles voulaient créer. Aujourd’hui, le mouvement des femmes se bat sans cesse en interne, comme toute la société civile. Elles se battent pour la KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, ou Commission pour l’éradication de la corruption) et pour la loi sur les violences sexuelles. Ce sont des questions importantes, mais qui s’inscrivent dans un cadre plus large qui n’est jamais explicité. Je veux dire que le LBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, ou Institut indonésien d’aide juridique) ou les mouvements de défense des droits humains n’ont pas de vision de ce à quoi l’Indonésie pourrait ressembler ni de ce qui est nécessaire. Avoir un cadre des droits humains, ce n’est pas seulement revenir sur des crimes contre l’humanité. Il s’agit d’envisager une société plus égalitaire, où les revenus sont répartis de façon plus équitable, où le pouvoir n’est pas entre les mains de l’armée et des magnats de l’économie, mais entre les mains du peuple. C’est ce que j’aimais avec le GERWANI. Par ailleurs, l’ensemble du PKI et le leadership de Dipa Nusantara Aidit, bien sûr, étaient très importants. Muhammad Hatta Lukman, Njoto et beaucoup de ces dirigeants, dont Soekarno – on peut ne pas être d’accord avec lui du point de vue académique et je pense qu’au cours des dernières années, il a fait beaucoup d’erreurs –, avaient une vision. Aujourd’hui, l’idée de vision s’est perdue. Et elle s’est perdue à partir de 1965. C’est un des effets du « coup d’État rampant », comme je l’appelle, de la façon dont Suharto a évincé Soekarno et détruit tout un mouvement, tout un mode de vie, toute une culture et une façon de voir la société. Voilà, en quelques mots, ce que je vous répondrais.
Dans ce contexte, quel rôle la religion joue-t-elle au vu des élections à venir ?
Commençons par ce qui se passe en ce moment même. Si l’on considère le KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, ou Congrès des femmes oulémas d’Indonésie), on peut constater l’impuissance critique de la religion dans la politique indonésienne. Des femmes leaders musulmanes et des milliers de membres participent à ce congrès. Ce sont les musulmanes considérées comme les plus progressistes du pays. Ce sont toutes des femmes éduquées. Beaucoup dirigent ou enseignent dans des pesantren (internats islamiques), des madrasa (écoles islamiques) et dans les différentes universités d’État islamiques. Ce qu’elles disent, c’est qu’elles sont là pour toutes les victimes, et elles ont un point de vue progressiste sur l’islam. Mais il y a deux questions qui ne sont jamais abordées au KUPI : qu’en est-il des victimes de la violence que vous avez infligée au GERWANI, parce que ces femmes étaient très actives dans cette histoire ? Beaucoup d’entre elles sont membres d’Aisyiyah (la branche pour femmes de l’organisation moderniste Muhammadiyah, fondée en 1917) et Aisyiyah a repris la main sur les jardins d’enfants du GERWANI et largement contribué à dénoncer et souiller les femmes du GERWANI. Pas une seule n’est allée dans les prisons où les femmes du GERWANI étaient détenues, torturées et violées. Il n’y a eu pour ce faire que des ministres et des prêtres chrétiens. Aucun dirigeant ni dirigeante musulmane n’y est allée. Elles avaient été collègues et avaient travaillé ensemble, mais elles ne sont pas allées rendre visite à leurs anciennes amies, elles ne leur ont pas tendu la main et n’ont pas élevé la voix. J’ai voulu leur poser la question à l’époque, mais le KUPI n’a jamais rien dit à ce propos.
Deuxième point, et je viens de finir un livre sur ce sujet, les dirigeantes musulmanes les plus progressistes n’ont pas un mot sur la violence infligée par leurs familles et leurs associations aux personnes LGBT. Ce sont leurs associations qui encouragent les thérapies de conversion inhumaines, les mariages forcés et les viols correctifs de jeunes lesbiennes. Elles n’en disent pas un mot. J’aimerais leur poser la question, mais je ne peux pas le faire publiquement. J’ai interrogé certaines dirigeantes que je connais personnellement sur les thérapies de conversion, elles m’ont dit qu’il était impossible d’en parler. Ce que je veux dire, c’est que les femmes oulémas devraient au moins prôner une vision légèrement progressiste de l’islam ; leur analyse comporte de nombreux trous noirs et elles ne proposent pas de perspective assez radicale, à mon sens, sur la liberté et l’humanité. Elles disent rahmatan lil alamin, l’islam est « une miséricorde pour l’univers ». Sauf que ce n’est pas une bénédiction pour toute l’humanité. L’islam peut être très intolérant, il l’a déjà été, il l’est toujours vis-à-vis de la communauté LGBT, et il encourage toujours l’homophobie et la phobie communiste qui peut resurgir. Nous avons peur des prochaines élections parce qu’aucun des candidats qui briguent la présidence n’a de vrai programme politique. C’est exclusivement une question de personnalités et de pouvoir. Comme ils n’ont pas de programme, ils vont se contenter de s’en prendre aux plus faibles de la société, les anciens communistes ou ceux qui leur sont associés, et la communauté LGBT, parce que ce sont les plus vulnérables.
Notes
1
Jasper Griffin, « It’s all Greek! », The New York Review of Books, 18 décembre 2003.
2
L’IPT1965, soit le Tribunal populaire international 1965, est un tribunal indépendant qui a enquêté sur la purge anti-communiste indonésienne de 1965. Le « Rapport final de l’IPT 1965 : découvertes et documents » fait référence au rapport complet, dont les documents qui l’étayaient, remis par le tribunal.










