(FLEPES - Académie de Versailles)

Andrea Jacchia, The Brother
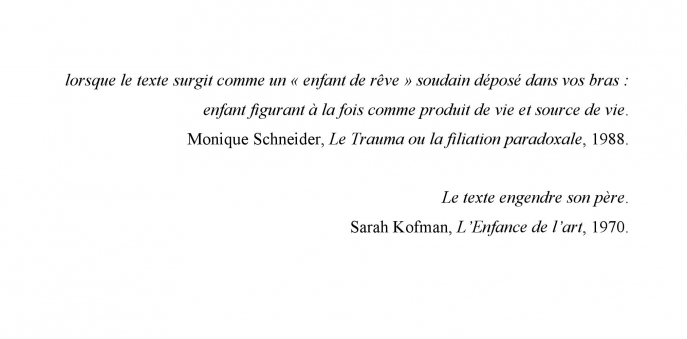
Paris 2013. Lors d’une conversation avec Janine Altounian à propos du recueil L’Enfant et le génocide1, j’osais lui confier la quasi-impossibilité où je me trouve d’y lire les paroles d’enfants rapportées ; poèmes, mots transmis, passages de témoignages écrits bien après. Textes orphelins. Impossibilité tout à coup de lire ça parmi tant d’autres paroles de témoins déjà vues, lues. Impossibilité sauf à imaginer d’en ritualiser la lecture à deux ou trois ou plus, pour n’être pas livrée aux montées contradictoires d’affects avec ce livre qui fait parler de leur mort des enfants tués. Ritualiser la lecture serait une micro-tentative de réplique en commun, de maillage en creux d’un tissu psychique préparant une possibilité plus collective ou plus culturelle de deuil, réouvrant de l’à-venir, et ceci politiquement (dans la sphère publique de la socialité pourtant la plus intime). Deuil et avenir que le génocide veut interdire dès avant qu’il est commis. Ritualiser pour devenir capable de lire aussi intensément et sobrement que d’autres, avant, ont écouté, recueilli, réverbéré dans des intervalles plus privés les témoignages des survivants (je parlerai de ces autres plus loin).
Toute publication de témoignage d’un « trauma historique » ressortit d’un arraisonnement éthique inévitable mais insupportable pour le lecteur, l’auditeur, le destinataire soudain atteint, ainsi que d’une réexposition du témoin survivant qui, si on la perçoit, projette vers la négation intime visée, subie. En toute impuissance : le destinataire touché n’est dépositaire que d’un « savoir sans savoir » ; ne l’atteint pas ce que seul chaque témoin peut rapporter. Ce dialogue sidérant, dans sa proximité perturbée, peut provoquer un trou dans la socialité radicale, si on peut le dire si prosaïquement.
Janine Altounian se souvenait vivement qu’on lui avait recommandé de lire ce livre dont je lui parlais, brutal aussi dans sa facture archivistique de recueil quasi philologique. Elle l’avait acheté. Cet écrivain, elle-même témoin en tant qu’enfant de survivants du génocide arménien2, lance devant moi tout à coup (je me souviens que nous étions boulevard Montparnasse) l’interrogation fulgurante qui monte en elle et que je l’entendis reposer lors d’une de nos réunions de travail, l’année suivante : « Il y a des livres illisibles ; la question, c’est : qu’est-ce qu’on fait avec ces livres illisibles qu’il faut lire ? »
Et si notre héritage était précédé d’un tel testament paradoxal3?
Témoignage et philosophie : une fin de non-recevoir ?
Lors de la décade de Cerisy, été 1980, « Les fins de l’homme. À partir du travail de Jacques Derrida », Jean-François Lyotard expose une grande lecture antagoniste, très commentée depuis, de la philosophie dialectique de Hegel (contrant celle d’Adorno4), « Phraser après Auschwitz »5. Il traque la complicité rétrospective6 de la philosophie de l’histoire avec l’extermination des Juifs d’Europe : spéculer anéantit le rapport au réel dans le nom, anéantit tout « sujet externe », toute « identité collective » dans le nom. « Auschwitz » dit l’anéantissement du nom, de la mort. Négatif, « sans nom » en cela. Enchaîner « après Auschwitz » revient à être confronté dans le discours à ce qui « dévore les noms » (p. 303 et suivantes). La réflexion épouse la négation de l’expérience, qu’on le veuille ou non. On l’entend, l’approche est encore magistrale, elle cherche par quel travail systématique et de contradiction généalogique le concept peut accueillir l’expérience historique impossible qui l’excède.
Durant les débats qui suivent (p. 310-315), que Jean-François Lyotard aura scrupuleusement résumés pour la publication, le lecteur se retrouve au plan plus direct d’une conversation vive ; quelqu’un y fait un pas (bizarrement très peu commenté depuis) décisif au cœur de cette étrange scène philosophique en débat trop spéculatif avec le nom d’un centre génocidaire érigé en concept-négatif, emblème en soi qui se suffirait à lui-même et n’a, dans ce dispositif, besoin ni du témoignage ni de l’enquête historiographique :
« Sarah Kofman note que dans les camps, l’appel par numéros matricules signifiait déjà la mort par anonymat avant la mort tout court. De même pour le travail : sans but et sans répit, comme celui de Sisyphe, il interdisait aux juifs de respecter le shabbat. “Mon père qui était rabbin est mort d’avoir voulu se reposer le jour du shabbat à Auschwitz ” » (p. 310).
La philosophe Sarah Kofman témoigne pour la première fois sur la « scène philosophique » (publique) à la première personne. Traquée enfant, elle fut cachée de fin 1942 à août 1944. À 7 ans, elle a assisté à la rafle de son père, chez eux, le 16 juillet 1942. Elle n’a appris, d’un survivant, que bien tard la façon dont il aurait été assassiné par un kapo à coups de pelle et enterré vivant pendant qu’il priait. Dans l’échange qui continue, Maurice de Gandillac puis Jacques Derrida associent directement cela avec l’incorporation matricule des Indochinois et des Arabes d’Algérie dans l’armée française coloniale. Kofman se tait définitivement mais les échos de ce jour-là reviendront dans ses textes7.

Andrea Jacchia, Plaid (détail)
De fait, le matricule militaire et celui des centres de mise à mort ne sont assimilables ni quant à leurs finalités respectives (le matricule militaire sert à retrouver les morts), ni quant aux réalités historiques dont ils procèdent (colonialisme ou génocide) – sauf sans doute à passer par le registre spéculatif de la philosophie : c’est une même suppression du réel que le chiffre effectue ; il suffit de dire « Auschwitz » pour représenter l’innommable, etc. Plus loin, pour « briser l’entente » avec Jean-François Lyotard, Jacques Derrida s’inquiète du risque d’« occidentalocentrisme » de sa critique : il faut n’accorder aucune « centralité » à un sans-nom ou un autre, ne pas risquer que « se reconstitue un nous référé à Auschwitz » (p. 311).
Ce type d’épure logique est propre à la morale universelle. Cela procède de l’abstraction du dire et du sujet du dire, associée à la relativisation de la particularité la plus forte, ici de la réalité génocidaire. Voilà ce que Sarah Kofman récuse en fichant le témoignage à même le registre de la réflexion phénoménologique et se faufilant par la brèche critique qu’y a creusée Jean-François Lyotard. Témoignage sans reprise, aussitôt dilué dans le travail discursif de la célèbre Décade qu’on n’évoque jamais par ce détail8. J’y lis une auto-contradiction saisissante dans son performatif… dénégatif.
Ce qui est ici « illisible » en philosophie (on a aussi parlé d’irreprésentable, indicible, etc.), c’est la rupture en déchirures ou arrachements qu’y provoque le témoignage. Non seulement une rupture létale du registre éthique de la parole (d’écoute, de compréhension, de distance, d’échanges, due à l’acte génocidaire remémoré) mais aussi la déchirure radicale des rapports au réel et à la réflexivité dont la philosophie se nourrit, propre à la parole de témoignage. Sans parler de l’effet d’une telle parole, de ce qu’elle dit de l’atteinte subie (non pas objectivement mais bien affectivement, psychiquement).
Sans doute est-ce trop difficile de recevoir publiquement la parole du témoin survivant9, aussi sobre soit-elle, précisément de « phraser » après toute évocation publique intime du génocide. Combien de psychanalystes éprouvent, en effet, que dans la cure des survivants la parole n’est pas libératrice, sidère aussi l’analyste10? Or le survivant ne peut témoigner sans s’exposer, parlant à la première personne, ni, par ce geste pénible, sans assigner subjectivement l’interlocuteur à la sidération qu’il réactive, l’invitant à réverbérer, comprendre malgré tout quelque chose sans renvoyer l’effroi remontant.
L’alternative inadmissible à laquelle le lecteur des actes de cette Décade est confronté, non sans malaise, tient à la suppression ou non du rapport humain et au réel humain en instance dans la parole : le témoin tient parole, son dire bat en brèche la pure réflexivité du discours, sa propre recherche réflexive sait n’être légitime qu’au prix d’y faire revenir l’humain nié, la concrétude psychosomatique inassimilable de cela même.
Quand la psychanalyse a bouleversé ses approches du trauma et de l’histoire dans le setting de la cure, sous le choc de la clinique des survivants de la Shoah11, la philosophie a-t-elle effectivement bouleversé son rapport de réflexivité avec la parole humaine et ce qu’elle atteste d’humain dans le rapport complexe au réel ? N’est-ce pas ce philosopher « autrement » que les rares survivants également philosophes réclament et, très diversement, tentent ou entreprennent ? Tels Vladimir Jankélévitch12, André Neher13, Emmanuel Levinas bien sûr14, et, donc, Sarah Kofman… Mais sont-ils reconnus comme témoins (position qui met à mal celle de l’intellectuel engagé15) ? Il semble au contraire que l’un exclue l’autre dans la mesure où tout particularisme et toute parole intime invalident le dit philosophique16.
Cette norme discursive est-elle tenable face au « trauma historique » ?
La scène intellectuelle, celle-là même qui étudie aussi les témoignages (où il faut inclure ceux des bourreaux et des intellectuels complices), récuse l’irruption subjective de la parole affectée (rien à voir avec le sentiment, il s’agit d’une altération de nature physique, psychique et morale).
La proposition kofmanienne aura été, en rigueur, de ne jamais séparer la parole de celui qui s’y engage en première personne, condition pour que penser, écrire, lire, agir restent liés au devenir-moi nietzschéen17 et freudien18, pour que l’économie réflexive de ce processus ambivalent se rapporte, dit-elle, au « cœur de la vie »19. Or, dans la bouche du survivant philosophe, cet enjeu « narcissique » et « vitaliste » de la philosophie la plus ancienne prend un relief incandescent.
Parmi les noms fameux de la Décade tant commentée depuis, Sarah Kofman ne figure pas. Elle n’est pas tant reconnue, aujourd’hui, pour ses textes philosophiques parce qu’on la situe, épigone, dans le sillage de Jacques Derrida : « Sarah Kofman n’est qu’un des personnages secondaires qui gravitent autour de lui » dit le biographe de celui-ci20 (on vient d’apercevoir en quoi elle n’est pas derridienne), et pour ses témoignages autobiographiques21. Dans la mémoire de ceux qui l’ont connue comme dans celle des commentaires, elle s’est suicidée six mois après la parution de son souvenir d’enfance cachée en 199422. Ce livre est le plus lu de tous ses écrits dont certains ont sombré dans l’oubli – à l’instar de ce qui se passe avec sa prise de parole sur la scène philosophique. Sa biographie est en quelque sorte réduite à sa nécrologie, d’aucuns en font même un destin philosophique :
« Écrivain et philosophe, Sarah Kofman s’est donné la mort à Paris, le 15 octobre 1994. Agrégée de philosophie, elle était professeur à l’université de Paris I-Sorbonne, où elle enseignait depuis 1970. Le fait que coïncident, au jour près, sa disparition volontaire et le cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Nietzsche n’est sans doute pas un simple hasard. […] Avec Rue Ordener, rue Labat, Sarah Kofman publia en 1994 le récit de son enfance juive sous l’Occupation nazie. Elle dit le souvenir de la détresse longtemps muette après la déportation et la mort à Auschwitz de son père rabbin et la séparation d’avec sa mère. Ensuite, elle se tua23. »
Le questionnement s’ouvre entre un choc personnel de lecture philosophique – l’essai de Kofman sur l’aporie chez Platon qui se termine brutalement par un rêve/souvenir aporétique d’enfance traquée, Comment s’en sortir ? Cauchemar (1983) – et la stupéfaction de découvrir la scène répétitive de la non-réception du témoignage en philosophie. Sarah Kofman est reconnue comme victime plutôt que pour sa pensée (elle a publié plus de vingt-cinq essais, plus de la moitié sur Nietzsche et sur Freud, salués en leur temps24). Son suicide, me semble-t-il, sidère l’espace de la lecture. Nulle part la scène philosophique ne prend acte du sobre déplacement qu’elle propose (que je n’évoque ici qu’a minima) : déconstruire le systématique, renverser le spéculatif avec la métaphore, recourir à la parole où le sujet est exposé à la première personne pour en faire matière philosophant. Il y a là une mise en tension entre le pulsionnel et la rencontre éthique comme condition du penser (très différente de celle de Jean-François Lyotard). C’est philosopher, dit-elle, en rapportant le texte à « la vie comme texte » : la vie psychique tient lieu de tissu transcendantal, son économie de réflexivité anime l’« exode » hors des pièges mortels du discours de maîtrise qui se substitue à « la vie mixte » et à la difficile remémoration du réel qui a eu lieu25.
Comment sortir de cette impasse ? Comment lire Sarah Kofman de telle sorte que la scène philosophique assume d’être bouleversée « par delà » la morale, modifiée sans retour non par le problème de l’édification négative d’un concept Auschwitz, non par un arraisonnement moral mais, plus décisivement et plus tangiblement, par le setting éthique de la réception vive des témoignages survivants d’un génocide26? Le déplacement n’est pas mince : au lieu d’invoquer une entité tenant lieu du réel impossible, le nom d’un sans-nom, il s’agit de se poser intimement et publiquement dans l’intrigue humaine à même son énigme éthique. L’enjeu, que Sarah Kofman partage avec Jean-François Lyotard27, est celui d’un penser esthétique du juste et de la sensibilité qui prend acte de la perte de confiance dans la culture, sans renoncer à cette dernière, entre différend insurmontable et aspiration au partage. Voire à l’espérance sous la figure (nietzschéenne et biblique) de la promesse et, même, d’un terme auquel revient Sarah Kofman à la toute fin de son propre témoignage publié pour son père : « l’humanisme ». En dépit de ce que cette signification a subi d’irrémissible, nous n’avons pas d’autre mot, dit-elle.
Témoignages : un temps des générations dans la réception
Cette interrogation nécessite des scènes interrogatives apposées pour signifier un tournoiement et un travail de déplacement vis-à-vis de ce que « trauma historique » entend signifier.

Andrea Jacchia, Tabnit
Le déplacement relève d’une économie générationnelle, acceptée comme déterminité et problème dynamique, telle que Karl Mannheim l’a revalorisée dans la modernité28. Le problème des générations trame l’engendrement, la filiation, la succession, cœurs intimes de la vie aux prises avec la mort, qui s’en déprennent sans y échapper. Ce problème est plus qu’un mouvement naturel, chacun y est assigné sur la scène plurale, hétérogène, finie et interminable du « deviens ce que tu es ». C’est la voie par laquelle le temps est humain en des rapports irréductibles aux seuls liens politiques ou sociaux dont, pourtant, l’humain particulier ne peut être isolé. C’est aussi la voie que vise la destruction génocidaire dans son ressentiment apocalyptique29, pour briser l’espèce humaine en deux, l’épurant d’une part qu’arbitrairement elle décrète exterminable30. Ce désastre brise le temps ou le fige, qualifie et disqualifie le politique, montre l’inanité, l’ambivalence inhérentes à sa prétention constitutive pour toute société : de fait, ni la culture ni la morale ni les institutions n’endiguent ce désastre, au contraire31. Il puise aux sources inscrutables de l’insociable socialité qu’il transforme en effroi performatif32. La politique offre à cela un habit ordinaire, l’inscrit dans l’économie, l’administration stratégique de la destruction et un recours pervers au droit pour légitimer l’illégitime, l’acte d’exterminer33. Par la désubjectivation du langage, tous les moyens sont « bons ».
La scène de la réception des témoignages des survivants est celle de la reprise de la qualité humaine du temps : la succession appelle la remémoration, l’adoption rétrospective de ceux qui précèdent. Scène d’une même espèce, même société d’appartenance, à laquelle ces survivants furent arrachés et revinrent avec, en eux, la hantise de ceux qui ne sont pas revenus. Scène civile stratifiée que le politique ne suffit à définir. Le legs et l’héritage d’un tel « trauma historique », que réclame la prise de parole du témoin survivant, n’est pas la seule affaire des survivants et de leurs enfants, ni des enfants de leurs enfants. Elle est affaire sociale de générations. Dans la mesure où le politique est mêlé à l’extermination, que le pacte humain bien en deçà du contrat social est abîmé par le terrorisme total, la scène blessée qui refuse la rupture en deux de l’humanité est nécessairement civile en même temps que juridico-politique. Par l’implication espérée de chaque successeur potentiel des témoins, elle affirme, une seule espèce humaine et la pluralité irréductible de ses membres, à travers la discrète scansion du temps de la finitude et des générations. Là où la mort « redevient » la mort et non sa négation.
Ce legs peut être ignoré, dénié, refusé, combattu mais aussi héritage consenti.
Répétition. « Trauma historique » : ni concept ni objet de transmission didactique
« Trauma Historique34». Expression forgée devant l’évidence atroce des faits, en équilibre précaire à la croisée de disciplines cliniques et des sciences morales, « trauma historique » reconnaît un effet attesté par les survivants, en eux, où s’effondrent les règles logiques et causales de la raison commune : incapacité de parler à cause des mots qui, pour parvenir à dire ce qui fut, réactivent l’effet. Qu’on pressent quand on reçoit le témoignage, à la façon d’un coup profond, d’un spasme intérieur de souffrance incompréhensible. Le signe qui fait parler de « trauma historique » répond d’une sidération irradiante. Difficile de penser le gel de la pensée. Mais il a fallu longtemps et beaucoup de gestes patients pour que la mesure de ce péril du dire soit prise35.
J’utilise le terme « trauma historique » de façon contrainte, ainsi que Sabina Loriga l’indique et non, pour ma part, comme un concept : s’impose en effet de réagir à la banalisation actuelle qu’opère le recours généralisé au terme alors il faut en reconsidérer le sens. J’y reviens et l’emploie à partir de deux sources qui le laissent polyvalent mais heuristique, ouvert en rigueur aux variations particulières que telles ou telles recherches se soucieront de souligner :
- D’une part les travaux de Freud sur la vie psychique et la culture, à partir de la guerre de 1914-191836, qui observent que les névroses traumatiques de guerre sont un effondrement interne du sujet, un trauma psychique avec un effet en quelque sorte structurel, provoqué par un choc externe inassimilable en termes d’expérience. Dans les mêmes circonstances et de façon très proche bien qu’en philosophie (sans clinique), Walter Benjamin fait le constat d’une irréversible perte culturelle de l’expérience37. Détaillant « le deuil dans la culture » vécu par les Juifs soumis à la relégation et la traque dans leurs propres sociétés, deux psychanalystes ont plus récemment souligné la « contrainte au deuil de soi » qu’engendre la vie quotidienne assignée à un régime d’extermination à partir des détails de la socialisation attaquée38. Il n’est pas assuré que nous soyons politiquement indemnes de cette onde de choc complexe qui a traversé, fut-ce sans bruit souvent, l’économie de la socialisation.
- D’autre part (selon la seconde source de travaux que je réfère), de façon contemporaine cette fois : se serait étendu, après le « 9.11 », un « empire du traumatisme » mis en relief par Didier Fassin et Richard Rechtmann selon leur anthropologie de « l’espace moral des sociétés contemporaines » : ils visent à élucider certaines conditions de mise à mal de la subjectivation39. Bien qu’ils ne focalisent pas ce terme, « trauma historique » renvoie dans leur perspective d’étude à une politisation excessive par effraction, par effacement de l’intime : négation délétère du devenir-moi qui ne laisse possible que de la parole victimaire. L’hypothèse, ici (que j’évoque sans ses analyses constitutives), est que l’effondrement de la subjectivation, si l’on peut dire, devient un motif politique répétitif dans le contemporain.
Ainsi entendu de façon nécessairement polyvalente, ce que « trauma historique » entend saisir et penser renvoie inévitablement à des analyses cumulées et, au moins, à une double dimension qu’il affecte : psychique, d’effondrement dans/de la culture d’une part et, de l’autre, politique stricto sensu, effet retour répété d’une culpabilité morale diffuse associant négativement, dans le problème des générations, les victimes, les bourreaux et tous les autres, et leurs descendants. Enfin, je l’étendrais jusqu’à dire qu’il désigne aussi ce testament « illisible qu’il faut lire », un certain « patrimoine négatif40» de l’humanité ; la Shoah et la seconde guerre mondiale renvoyant inlassablement à cette profondeur redoutable où fut scellée une sorte d’atemporelle et potentielle jouissance exterminatrice de l’humain.
Si dire « trauma historique » prend acte de ce complexe et d’une sidération irradiante, on ne peut en rigueur plus interroger comment on le « transmet ». Enseigner le « trauma historique » se révèle un programme absurde : immédiatement intellectuel et moral, externe et conceptuel, normatif sans réflexivité simultanément subjectivante. « Ça » (ce « trauma historique ») répète le genre de politisation de l’intime qui défait l’intime. Ostinato d’une auto-contradiction délétère.
Quelque chose d’un tel impact toxique s’impose, diffus et, tel, reçu à l’insu. Qu’on le veuille ou non. Élaborer ça en héritage signifie en contre le choix d’engager simultanément une élucidation intime et critique, individuelle (subjective) et d’auto-compréhension culturelle (psychique). Est-ce possible ? Comment ? S’il y a choix possible – et ne pas renoncer au choix s’impose41– ce ne peut être une allégeance volontaire et immédiate à l’assignation de recevoir le « trauma historique » et ses sources (tel événement précis et cette jouissance épouvantable).
Il est inévitable que l’adresse performative du témoignage coupe la parole car elle rejoue la scène de son étouffement. Au plan social, c’est-à-dire de nos formes de vie sociale, entre intersubjectivité et politique, l’adresse éthique du témoignage survivant est nécessairement négative aussi (« n’oublie pas ») ; elle contraint le témoin, la réception qui ne l’ignore pas ne peut s’en prétendre indemne. Or, arrachée à son locuteur, orpheline de tout site relationnel, de toute intersubjectivité tangible en étant publiquement relayée à la façon d’un mot d’ordre (« transmettre le trauma historique »), cette adresse peut irradier, impérieuse, à la façon d’un destin contagieux : écrasante fatalité si on la pervertit en norme ou programme, si le destin devient un ordre négatif de surcroît (« contre l’oubli »). En contre, accepter cette adresse destinale réclame dans le même mouvement un travail patient d’émancipation de la reprise de parole, de la parole capable d’entendre et faire entendre l’unicité de chaque voix. La parole du témoin relaie des paroles fantômes qui furent en deçà du décret génocidaire et, telles, demeurent à inscrire en « auront été », en attente de devenir dans le futur du passé. Faute de quoi, ce serait répéter leur effacement. Cette alternative est aussi impérieuse qu’insupportable, propice dès lors, si on ne pense pas comment la recevoir ou dans quelles conditions, à piéger la socialisation en impasse morale, où ses rapports avec la subjectivité continuent de s’effondrer longtemps après les faits historiquement traumatiques (cette description n’a aucune prétention clinique ni épistémologique, elle vise l’effet éthique de la circulation idéologique du « trauma historique », qui sépare la parole du sujet qui la porte et en est porté).
À cause de l’effraction politique, de l’impasse moraliste, des imbrications qu’il recouvre, le terme « trauma historique », même ouvert, est fatalement réducteur. La voie qu’il convient de penser pour en sortir n’est ni conceptuelle ni d’analyse politique, elle est devant la politique, la conditionne. S’y tient l’humanité comme capabilité éthique au « devenir-moi » et, dans le temps (passé/futur), comme promesse de subjectivation dans la socialité « avec et pour autrui » (Paul Ricœur). Cela n’est tout simplement jamais possible hors rapports, intrigues, ambivalences, inter/intrasubjectivité, rituels, eux-mêmes inscrits dans les tensions du temps et les insuffisances de la culture (politique comprise).
Retournement, renversement, élaboration ?

Andrea Jacchia, Athènes
Pour indiquer comment j’ai repéré ce que je viens d’évoquer plutôt abstraitement, je rapporte une expérience en série. J’avais d’abord été touchée par les réactions de jeunes adolescents sortant d’un cours d’histoire où ils avaient vu Nuit et brouillard ou rencontré un témoin survivant de la Shoah. De diverses façons affectés, ils le taisent pour la plupart ou protestent. Effet de sidération non reconnu, non dit. Voulu comme leçon historique ? Comme connaissance de l’humain pour son devenir ? (adage philosophique repris par la modernité critique).
Mais quelle connaissance prétend être transmise ainsi ? Que vise cet enseignement de l’insupportable réduit à un instant (quelle que soit la plus grande qualité didactique ou éthique de l’heure, du film, du témoin), qui s’impose à la façon de l’interdiction morale de le refuser ? C’est dans l’impensé de la temporalité patiente et longue de cette situation éducative que j’ai peu à peu compris que la « réception » de la Shoah, s’il en est, commence à ce moment précis où l’instruction civique est débordée. Ne faudrait-il chercher un passage d’élaboration dialoguée de cette sourde sidération avant que toute réaction défensive ne s’installe en intellectualisme, en moralisme ?
Enseignant depuis plus de quinze ans, en séminaires annuels, la philosophie de l’éducation et l’histoire de l’éducation spécialisée à des éducateurs en formation professionnelle d’adultes, j’ai remarqué ces réactions défensives plus d’une fois lors de séances d’études consacrées au travail de placement clandestin des enfants juifs traqués à Paris, des maisons d’enfants en France impliquées dans la cache puis l’accueil, après guerre, des orphelins de la Shoah. Les propos des stagiaires vont du rejet de cette histoire « trop dure » (« on y a déjà eu droit au lycée, ça suffit ») à une hostilité singulière (« encore les Juifs. Il n’y en a que pour eux »). Contre l’occidentalocentrisme, on me demande pourquoi je n’étudie pas le sort des enfants d’esclaves ou celui des migrants de deuxième génération. Objections à la fois stéréotypées, sincères, abusives et à fleur de peau qui ne seraient pas même légitimes si seul ce sujet leur était proposé (ce qui n’est pas le cas).
J’ai appris comment laisser se détendre ces mouvements. Il faut de la durée (28 h de cours cumulés minimum et y revenir l’année suivante au moins une journée42), des redites, refuser à la fois l’impudeur et le débat moral universel qui ne se penche pas sur le détail des études de situation. Pièces à l’appui, textes entre nous, nous avons plusieurs fois fait une découverte : à mesure qu’avance la lecture d’analyses historiographiques, cliniques ou de témoignages de vie de rescapés43, allant aussi à leur vie d’après44, le séminaire occasionne une adoption progressive des enfants pris dans le destin génocidaire, non pas en bloc, mais tel ou tel. Quand l’imagination des lecteurs se lâche en acceptant les faits historiques, l’enfant de papier devient une voix vive (on réinvente sa silhouette, on investit ses questions en les laissant monter en soi).
Ne pouvant détailler cette expérience didactique, ses limites aussi (ce qui m’empêche d’en étayer plus la prétention à la validité), j’en retiens que cette situation d’adoption à contretemps advient chaque fois qu’est éloigné ou neutralisé l’arraisonnement empathique moral : le souci du devenir-moi de l’autre, non de sa condition de victime, reprend alors le pas sur les réactions initiales – qui font l’objet d’un examen contradictoire final, de jugements subjectivés, délivré de « l’ordre du discours ».
Les accueils de témoins dans les classes de lycée, les visites de lieux de mémoire, toutes les approches de la Shoah qu’effectuent les enseignants qui s’y impliquent visent cet idéal. Toutefois, il convient de repérer dans quelles conditions intersubjectives et comment cela peut être co-construit. Je ne peux parler en rigueur que de l’expérience que j’ai pu répéter quatre années successives, en dialogue réflexif avec les stagiaires : j’ai remarqué que la lecture patiente de textes importe, dont certains de ces textes « illisibles qu’il faut lire » qu’on n’approche pas sans préparer puis prolonger la scène de lecture par la lenteur dans la conversation (silence, ruptures de registre, pauses, brouhaha, reprise…) ; la scène de lecture elle-même est limitée en séquences brèves (inutile d’inviter à la « traumatophilie »). Les dialogues en séminaire créent des conditions d’accueil à l’actualisation d’un tel passé, en ouvrant des voies de rapports comparatifs et différentiels entre les situations des enfants cachés et celles des enfants de guerre ou handicapés avec lesquels travaillent les éducateurs (différentiels car il n’y a ni généralisation ni amalgame entre les moments historiques et politiques). Cela permet d’engager l’expression et le déchiffrement des paroles et positions en première personne des stagiaires, invités un à un à une telle autoréflexion partagée – où, souvent, a surgi inopinément de l’autobiographique générationnel : des stagiaires ont remonté leur lignée en la situant dans l’histoire par rapport à leurs réactions à la période étudiée. En ce cas, la réception agit de façon surprenante et visiblement féconde comme une prise de greffe dans le générationnel.
Cette expérience d’enseignement fut une certaine épreuve négociée vis-à-vis du « trauma historique ». J’y ai pris la mesure de mon hypothèse de recherche face à la question de l’héritage : le legs n’est pas le « trauma historique » – cette non-expérience – mais le retour vers ce qui a subi la destruction, les voix subjectives singulières et la temporalité de l’héritage, cette succession des générations à rebours. L’accès à ces voix n’est pas direct, objectif, immédiatement cognitif ; il passe par l’élaboration d’un dialogue intersubjectif, par une écoute réceptive qui, en ce cas didactique, protège l’intime des destinataires, le place en retrait. Paradoxalement, plus l’écart des générations est perceptible, plus il favorise l’intersubjectivité entre les voix : voix du lecteur, du texte, absentes, proches, lointaines. Il y a comme une collusion bénéfique entre la respiration temporelle recouvrée et la réverbération subjective qui se laisse aller, venir à contretemps. Je fais l’hypothèse qu’elle correspond à un certain travail de renversement du court-circuit traumatique entre le politique et l’intime. Tout le séminaire que j’évoque procède de la suspension de l’impératif moral normatif, en éloignant ou contournant les superpositions projectives et idéologiques entre différents sites de traumas historiques (ce qui n’a d’autre effet qu’entraver l’approche précise d’un meurtre de masse en particulier).
Hériter comme élaboration créative ?

Andrea Jacchia, Mémoire
La réception de la Shoah est paradigmatique en ce qu’elle s’accompagne, sur plusieurs décennies et plusieurs générations, d’un patient travail collectif de recueil systématique des témoignages et de reconnaissance esthétique de l’innovation littéraire intellectuelle qu’ont provoquée les écrivains survivants45. Sans chacun de tous ces efforts innombrables, pionniers – où les témoins sont en première ligne – il n’y aurait tout simplement pas de legs.
Ce legs étant archivé, s’impose de l’inscrire dans le temps humain, l’y faire vivre comme passé en commun disponible, germinal.
La réception du legs (le travail d’héritage) s’ouvre avec l’accueil effectif de la parole survivante et ce qu’elle a d’insupportable. Le psychanalyste Dori Laub est parmi les premiers à l’avoir fait, analysant le processus d’inscription de l’expérience négative, l’enjeu culturel « transvalué » et l’économie de co-élaboration que cela met en branle :
« Le processus réel de porter témoignage d’un trauma massif commence avec quelqu’un qui atteste […] d’un événement qui n’est pas encore parvenu à l’existence, cela en dépit de la nature accablante et pressante de la réalité des circonstances. Alors que les preuves historiques de l’événement qui constituent le trauma sont abondantes et largement documentées, le traumatisme pourtant – événement comme connu et pas seulement comme choc accablant – n’a pas encore, en vérité, reçu de témoin […]. L’émergence d’un récit que l’on puisse écouter – et entendre – est donc le processus même, et la place où peuvent prendre naissance la connaissance et le savoir de l’événement. L’auditeur fait donc partie de la création de ce savoir nouveau. Le témoignage du traumatisme inclut son auditeur, qui est, pour ainsi dire, l’écran blanc sur lequel l’événement vient s’inscrire pour la première fois. […]
Aussi loin qu’ils se souviennent d’un passé horrible et traumatique, aussi loin qu’ils portent témoignage sur notre propre défiguration historique, les survivants nous effraient. Ils nous posent une énigme et une menace dont nous ne pouvons nous détourner. Nous sommes, en effet, profondément terrifiés quand il s’agit de faire face aux traumas de notre histoire, tout comme le survivant et l’écoutant. Que pouvons-nous apprendre de la réalisation de notre peur ? Que pouvons-nous apprendre du trauma, du témoignage et du processus même d’écoute ?
Dans la suite des atrocités et des traumatismes qui prirent place pendant la Seconde Guerre mondiale, les valeurs culturelles, les conventions politiques, les mœurs sociales, les identités nationales, les investissements, les familles et les institutions ont perdu leur sens, ont perdu leur valeur. Comme un événement qui trace une ligne de partage des eaux, l’Holocauste a entraîné une révolution implicite de toutes ces valeurs, une réévaluation ou, selon le mot nietzschéen, une « transvaluation » dont nous n’avons pas encore mesuré l’éventail d’implications culturelles pour le futur. […] Les survivants qui affirment le droit à la vie à partir de la désintégration et de la déflation de la vieille culture, incarnent involontairement un choc culturel des valeurs qui n’a pas encore été assimilé. Leur affirmation même de la vie, de façon paradoxale, constitue encore une autre menace, dans la mesure où elle véhicule une transvaluation historique inexorable, dont il nous reste à comprendre les implications46. »
Le travail premier de l’accueil engendre donc un scriptible de l’expérience négative, dans une rencontre singulière, chaque fois unique, créant le témoignage. L’hypothèse que mes pages ont servi à configurer est que la lecture des archives ou littératures de témoignages survivants s’engage de façon similaire : dans une temporalité seconde spécifique.
Lorsque le texte surgit comme un enfant de rêve…
Pour penser cela47, outre les analyses de Dori Laub, plusieurs réflexions sur le rapport au texte sont disponibles, à commencer par celle de Sarah Kofman lorsqu’elle conclut un de ses derniers essais sur Nietzsche, Explosions (t. II, 1993) :
« Tout au long de ce travail qui l’a suivi pas à pas, on l’aura, en tout cas, aimé : on se sera avec lui symbiotiquement uni au point d’être avec lui confondu, on aura été fécondé sans cesse par lui en tentant aussi quelque peu, à notre tour, de le féconder.
Aurais-je pu écrire sur Nietzsche et sur ses enfants avec justesse, en leur rendant justice, sans devenir moi-même un enfant de Nietzsche ? Un enfant qui, après tant d’heures passées durant « sa » vie auprès de sa « mère », se trouve contraint, en fin de compte, à couper le cordon ombilical pour devenir ce qu’il est.
Et à faire peut-être lui aussi son “autobiographie”. » (p. 371)
La lecture est un investissement subjectif parce qu’il rend possible, envisageable, l’autobiographie du lecteur. Les métaphores de fécondité sexuelle et de filiation attestent la nature psychique du lire. Le tournoiement des positions entre l’auteur et le lecteur (amant, fœtus, enfant, père, mère) est délibéré. En 1970, contre la toute puissance métaphysique de l’auteur, Sarah Kofman affirmait déjà que « le texte engendre son père » et non l’inverse : tout se passe au moment miroitant de la réception, de la reconnaissance de « l’enfant » par son père auteur et de l’accueil par le lecteur du livre orphelin, enfant exposé au public. Vivra-t-il ? Sera-t-il adopté ? Ces métaphores qu’elle emploie, en lisant le Phèdre de Platon, font signe vers son propre souvenir d’enfance48. Aux miroitements du texte, le sort du lecteur se joue tout autant que celui de l’auteur, chaque devenir-moi y est en jeu. Une telle réflexion est inédite en philosophie.
Je voudrais, pour finir, indiquer quelques jalons permettant d’élaborer une telle pensée de la lecture comme acte éthique, voire comme une certaine façon de tenir une promesse reçue en héritage comme un désir immémorial (culturellement phylogénétique ?).
Le premier psychanalyste de Sarah Kofman, Serge Viderman, était parmi les initiateurs de cette réflexion, relisant, lui, Sarrazine de Balzac en débat avec S/Z de Roland Barthes :
« Le texte est un objet libidinal, un objet d’investissement. Le lecteur lit (devrait lire) pour développer les harmoniques du texte et dévoiler la pluralité des sens par le truchement d’un “moi”, lui-même pluriel, capable de réfracter, comme le prisme la lumière, la diaprure […]. Le scriptible, qui fait du travail littéraire l’enjeu et la valeur, doit faire que le lecteur devienne non plus le conservateur du texte mais son co-auteur. […] C’est la liberté de l’interprétation qui est visée. Davantage : le texte là devient le lieu d’une expérience singulière, privilégiée, d’une re-création […]. Le lecteur apprendra que le texte lui apporte dans un langage codé, qu’il n’appartient qu’à lui de décoder, le souffle nocturne de sa vie la plus lointaine, ensevelie, indicible. Que de chacun des lecteurs, centre d’une lecture qui lui appartient, rayonnent des sens multiples et une lecture plurale sera devenue possible49. »
Mais il n’y est question ni de trauma ni de « trauma historique ». C’est le travail de Dori Laub, en regard, qui permet de mesurer combien l’écran blanc de l’accueil effrayé du témoignage est inassimilable à l’investissement libidinal et narcissique du texte, si « jubilatoire » (dixit Sarah Kofman). Le setting éthique (proximité humaine attentive) et psychique (co-création effective engendrant autobiographie et connaissance historique) est toutefois similaire.
Dans le champ du « trauma historique », la psychanalyste Rachel Rosenblum souligne la fonction vitale d’étayage qu’assure le texte pour l’écrivain-témoin : étayage fatal si le texte-tuteur, dont le témoin emprunte le dire pour le sien propre, le rapproche trop brutalement de l’après-coup du trauma50.

Andrea Jacchia, Partout
Lorsque le texte n’est pas écran blanc mais miroir sans tain, Monique Schneider, entre psychanalyse et philosophie, pousse quant à elle la réflexion du rapport « paradoxal » que permet la lecture entre celui qui écrit et le destinataire lorsque s’y mêle le trauma51. Le lecteur est pris dans l’adresse du texte parce qu’il l’accueille à son profond insu, ce qui active le dire-lisant. Dans une étude sur les rapports et la correspondance entre Sigmund Freud et Sándor Ferenczi, elle montre par le détail comment c’est par son propre trauma d’enfance que Sándor Ferenczi comprend l’adresse traumatique de Sigmund Freud celée/scellée dans son écriture. De texte à texte, une telle relation est asymétrique. D’un trauma l’autre, un dialogue psychique créateur advient aux sources de l’éthique : dans la détresse et l’attention ouvertes chez le lecteur par la parole de détresse adressée52. Monique Schneider lit le trauma comme « une exigence de filiation » (p. 175). Le lecteur se berce dans l’illusion qu’il va pouvoir ranimer l’auteur. Animation réciproque. Cette lecture fonctionne dans l’économie du fantasme à la façon d’une « filiation paradoxale ». Traumkind, « enfant de rêve » (p. 130 ; on pourrait dire Traumakind, enfant de trauma…), le « texte surgit soudain déposé dans vos bras : enfant figurant à la fois comme produit de vie et source de vie »…
À cette croisée dense pourrait être pensé l’âpre travail de lecture des « textes illisibles », élaborant une réception culturelle (esthétique en un sens kantien) des archives des témoignages survivants, à la façon fantasmatique mais constructrice53d’une filiation paradoxale : engendrant un savoir autre, à partir du devenir-scriptible du « trauma historique ».
Notes
1
L’Enfant et le génocide. Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah [éd. C. Coquio, A. Kaliski], Paris, Robert Laffont, 2007.
2
Janine Altounian, L’Intraduisible. Deuil, mémoire, transmission, Paris, Dunod, 2005 ; avec le journal de son père Vahram Altounian, Mémoires du génocide arménien. Héritage traumatique et travail analytique, Paris, PUF, 2009 (avec Krikor Beledian, Jean-François Chiantaretto, Manuela Fraire, Yolanda Gampel, René Kaës, Régine Waintrater).
3
Voir Hannah Arendt (citant René Char), préface à La Crise de la culture. Huit exercices de pensée politique [1968], Paris, Gallimard, 1972.
4
Theodor W. Adorno, La Dialectique négative [1966], Paris, Payot, 1978. Ce livre a été traduit par « le groupe de traduction » du Collège de philosophie créé par Jean Wahl. Ces traductions étaient, à partir de 1974, animées par Luc Ferry et Alain Renaut (qui s’opposent politiquement au Collège international de philosophie où l’on retrouve notamment Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Sarah Kofman, et bien d’autres).
5
Jean-François Lyotard, « Discussions, ou : phraser “après” Auschwitz », in P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy (dir.), Les Fins de l’homme. À partir du travail de Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1981, p. 283-310.
6
La démarche de Jean-François Lyotard n’a rien d’une épuration moraliste : il ne s’agit pas, pour lui, de juger que cette philosophie anticipait ou aura préparé la destruction des Juifs d’Europe mais de la relire à la lumière du choc irrémissible que fut cette destruction (hahurban) et qu’elle est au fondement du pacte humain (pour le dire avec les mots de Nathalie Zaltzman, voir ici, Roberta Guarnieri). L’enjeu est de cesser, modifier la répétition des modes de référence et de recours à ce type de philosophie dialectique que la destruction génocidaire rend désormais, et à jamais sans doute, intenable.
7
Voir notamment un court poème anti-négationniste qu’elle ouvre par une citation de la philosophie du droit de Hegel concernant la grâce, « Shoah ou la Dis-grâce », Les nouveaux cahiers de l’alliance israélite, no 95, 1988/89, p. 67 (repris dans le périodique trimestriel Actes. Les cahiers d’action juridique, no 67/68, 1989). Par ailleurs, sur son amitié avec Jacques Derrida, en cours de publication : Isabelle Ullern, « “Acquiers-toi un compagnon d’études” L’amitié qu’écrivit Sarah Kofman pour Jacques Derrida », dossier « Apostrophe – Konflikt – Dialog zu einer Poetik der Freundschaft. Un chassé-croisé franco-allemand », Lendemains, 2017/1 (sous presse), et « Kofman lit Derrida. Ecarts philosophiques et d’amitié », à paraître dans Ginette Michaud et Isabelle Ullern, Sarah Kofman, Jacques Derrida : croisements, écarts, différences suivi de Sarah Kofman, Lettres à Jacques Derrida, Paris, Hermann, collection Le Bel Aujourd’hui (publication en cours pour 2018).
8
Encore récemment, Michèle Cohen-Halimi, revient sur le détail des lectures adorniennes de Jean-François Lyotard et de Jacques Derrida (M. Cohen-Halimi, Stridences spéculatives, Paris, PUF, 2014).
9
L’artiste Esther Shalev-Gerz l’a exposé dans un dispositif dissociant l’image et la parole de ses enregistrements des derniers témoignages de soixante rescapés, soixante ans après : Entre l’écoute et la parole : Derniers témoins, Auschwitz 1945-2005, Hôtel de Ville de Paris, du 25 janvier au 12 mars 2005. Sur le site de l’artiste : http://www.shalev-gerz.net/?portfolio=between-listening-and-telling (consulté le 15 novembre 2016). Dans son article, ici, Roberta Guarnieri rapporte par ailleurs le setting singulier de lecture du témoignage survivant.
10
De Jacques Angelergues et Eva Weil (dossier « Devoir de mémoire : entre passion et oubli », Revue française de psychanalyse, vol. 64, no 1, 2000) à Laurence Kaplan-Dreyfus (Encore vivre à l’écoute des récits de la Shoah, Paris, L’Harmattan, 2014).
11
Rachel Rosenblum, « Cure ou répétition du trauma ? », Revue française de psychosomatique, no 28-2, 2005, p. 69-90 ; « Postpononing trauma: the danger of telling », The International journal of psychoanalysis, no 6, 2009, p. 1319-1340 ; « “In more favourable circumstances”: ambassadors of the wound », in J. Szekacs-Weisz, T. Keve (dir.), Ferenczi for our time. Theory and practice, London, Karnac Books, 2012, p. 117-145 (Elise M. Hayman Award for the Study of the Holocaust and Genocide, International Psychoanalytical Association, 2013).
12
Vladimir Jankélévitch, L’Imprescriptible. Pardonner ? Dans l’honneur et la dignité, Paris, Le Seuil, 1986.
13
Notamment : Victor Malka, Le Dur bonheur d’être juif, Paris, Le Centurion, 1978 ; André Neher L’Exil de la parole. Du silence biblique au silence d'Auschwitz [1970], Paris, Le Seuil, 1991. Anecdote : ce livre d’André Neher vient d’être réédité, en 1980, lors de la Décade consacrée à Jacques Derrida. Avant l’intervention de Sarah Kofman, un premier intervenant évoque la pensée que propose Neher à propos de ce « silence d’Auschwitz » mais personne (pas même Sarah Kofman) ne reprend cette ouverture, sauf Jean-François Lyotard brièvement ; quelles que soient les raisons sociétales, par ailleurs, de minoration intellectuelle de toute figure communautaire (Neher est un intellectuel juif), il n’en ressort pas moins qu’alors, la parole de ce témoin-là (survivant au génocide en ce qu’il est survivant du régime de Vichy et non de la déportation) n’est philosophiquement pas plus reçue, voire recevable ?, que celle de l’ancienne enfant cachée.
14
Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974. La dédicace en exergue du livre (évoquant le génocide des Juifs) comporte, en bas de page, une seconde partie, brève, en hébreu, qui ne traduit en rien la dédicace française du haut de page (je traduis) : « À la mémoire de l’âme / de mon père, mon maître, rabbi Yekhyel, fils de rabbi Avraham Halevi / de ma mère, ma maître, Deborah, fille de rabbi Moshé, / de mes frères Dov, fils de rabbi Yekhyel Halevi / et Aminadov, fils de rabbi Yekhyel Halevi / de mon beau-frère rabbi Shmuel, fils de rabbi Guershon Halevi, / et de ma belle-sœur, Malka, fille de rabbi Haïm / TaNeTSeVaH ». Toutes ces personnes ont été assassinées dans leur ville lituanienne par les Nazis. Le dernier terme est l’acronyme d’une citation biblique (1 Samuel 25, 29) que l’on inscrit traditionnellement sur les pierres tombales et qui fait écho à « Matsevah » signifiant la pierre tombale. Employer « maître » pour une femme (« Moreti ») est rare.
15
Anny Dayan-Rosenman, Carine Trévisan, « Avant-propos », in A. Dayan-Rosenman, C. Trévisan (dir.), « Le Survivant, un écrivain du XXe siècle », Textuel, n° 43, 2003.
16
En 2002, un philosophe israélien entreprend de penser le témoignage en philosophie même, la position singulière du « témoin moral » : Avishaï Margalit, L’Éthique du souvenir [trad. française C. Chastagner], Paris, Climats, 2006.
17
Sous-titre de Ecce homo (1888) : « Wie man wird, was man ist » (voir Pindare, IIe Pythique, v. 72 : « genoi oios essi mathôn », « Puisses-tu devenir qui tu es en l’apprenant »).
18
Sigmund Freud, « Wo Es war, soll Ich werden » [1932], 31e des Nouvelles conférences sur la psychanalyse.
19
Voir mon débat avec Jean-Luc Nancy dans : Isabelle Ullern, Pierre Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport, Paris, Beauchesne, 2015, p. 143-184.
20
Benoît Peeters, entretien du 9 mai 2015 avec Jade Bourdages, Trahir, n° 6, 2015, p. 29-30. En ligne (consulté le 28 décembre 2016) : https://trahir.files.wordpress.com/2015/06/trahir-peeters-biographie.pdf.
21
Isabelle Ullern, « La voix oubliée de Sarah Kofman », in I. Ullern, P. Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport, Paris, Beauchesne, 2015, p. 195-200.
22
Sarah Kofman, Rue Ordener, rue Labat, Paris, Galilée, 1994.
23
Roger Pol-Droit, Le Monde, 18 octobre 1994, base de son article « Sarah Kofman » pour l’Encyclopédia Universalis.
24
Bibliographie à jour (1963-2010) de Sarah Kofman (sauf ses entretiens audios et conférences) dans : Karoline Feyertag, Sarah Kofman : eine Biographie, Vienne, Turia + Kant, 2013, p. 323-335 ; avec ses traductions (1963-1994), in Les cahiers du Grif, 1997/HS no 3, p. 175-190 (établie par Duncan Large et Sarah Kofman). Coopérant au catalogage du fonds Kofman à l’IMEC (Institut de la mémoire de l’édition contemporaine), depuis 2013-14, j’ai eu accès aux revues de presse de ses publications. Cela a servi aux annotations et notices de la publication en cours de sa correspondance avec Jacques Derrida, en préparation chez Hermann, avec Ginette Michaud.
25
Dès son premier livre sur l’esthétique de Freud : L’Enfance de l’art, Paris, Payot, 1970. Je reprends ici aussi Comment s’en sortir ? Voir mon étude « Dire sous la contrainte/Lire vers la liberté ? », in I. Ullern, P. Gisel (dir.), Penser en commun ? Un rapport sans rapport, Paris, Beauchesne, 2015, p. 235-273.
26
Je ne parlerai pas de ceux des bourreaux ici.
27
Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris, Éditions de Minuit, 1983. Elle lui dédie Un métier impossible. Lecture de « Constructions en analyse » (Paris, Galilée, 1983) et commence Paroles suffoquées (Paris, Galilée, 1987) en évoquant « Discussions, ou : phraser “après” Auschwitz », (in Jean-Luc Nancy (dir.), Les Fins de l’homme. À partir du travail de Jacques Derrida, Paris, Galilée, 1981).
28
Karl Mannheim, Le Problème des générations [1928, trad. fr. de G. Mauger et N. Perivolaropoulou], Paris, Nathan, 1990.
29
Philippe Burrin, Ressentiment et apocalypse. Essai sur l'antisémitisme nazi, Paris, Le Seuil, 2004 ; Farhad Khosrokhavar, L’Islamisme et la mort. Le martyre révolutionnaire en Iran, Paris, L’Harmattan, 1995.
30
Voir la contribution Roberta Guarnieri à ce dossier (je me démarque de toute reprise de la distinction entre « exterminable / non exterminable », qu’elle-même utilise en référence à Janine Altounian).
31
Voir la contribution d’Hugo Vezzetti.
32
Emmanuel Kant, « Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique » [1784], commentaire de sa quatrième proposition : « J’entends par antagonisme l’insociable socialité des hommes, c’est-à-dire leur penchant à entrer en société, penchant lié toutefois à une répulsion générale à le faire, qui menace constamment de dissoudre cette société », (cité d’après la traduction de Luc Ferry pour les éditions Gallimard, 1985).
33
Richard Rechtman, « Faire mourir et ne pas laisser vivre. Remarques sur l’administration génocidaire de la mort », Revue français de psychanalyse, vol. 80, no 1, 2016, p. 136-148.
34
Voir la contribution de Sabina Loriga au présent dossier. J’attire l’attention sur l’acception originale que Roberta Guarnieri propose finalement pour ce terme, que je n’utilise pas tout en l’écoutant avec attention : à partir de sa distinction entre « trauma psychique » et « trauma de la psychè », elle le pense comme comprenant la possibilité d’une perlaboration collective.
35
Rachel Rosenblum, « Peut-on mourir de dire ? Sarah Kofman, Primo Levi » [1998], Revue française de psychanalyse, vol. 64, no 1, 2000, p. 113-137.
36
Sigmund Freud, « Introduction à “La psychanalyse des névrosés de guerre” » [1919], Résultats, idées et problèmes. I : 1890 - 1920, Paris, PUF, 1984, p. 243-247.
37
Walter Benjamin, Expérience et pauvreté [1933], Paris, Payot & Rivages, 2011.
38
Sylvie Dreyfus-Asséo, Robert Asséo, « Deuil dans la culture. L’actuel détail par détail », Revue française de psychanalyse, vol. 78, no 5, 2014, p 1263-1335.
39
Didier Fassin, Richard Rechtmann, L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion, 2007.
40
Sophie Wahnich, « L’impossible patrimoine négatif », Les Cahiers IRICE, no 7, 2011, p. 47-62.
41
C’est à partir de ce choix à rendre envisageable, pour le laisser possible me semble-t-il, que Roberta Guarnieri accepte l’alternative à l’intérieur du terme « trauma historique », tandis que, pour des raisons politiques et « au-delà de la morale », je choisis de distinguer le négatif caractéristique du « trauma historique » du difficile et « salutaire » ou « curatif » Kulturarbeit que constitue l’exode hors du trauma historique.
42
En formation professionnelle, un cours fait souvent 6 à 7 heures d’affilée, soit une journée de travail.
43
Voir au moins : Danielle Bailly (dir.), Traqués, cachés, vivants. Des enfants juifs en France (1940-1945), Paris, L’Harmattan, 2004, puis Enfants cachés. Analyses et débats, Paris, L’Harmattan, 2006 ; Jacques Sémelin, Claire Andrieu, Sarah Gensburger (dir.), « La résistance au génocide. De la pluralité des actes de sauvetages », Paris, Presses de Sciences Po, 2008, et les travaux de Katy Hazan (historienne à l’association juive OSE (œuvre de secours aux enfants, créée en 1912), Paris).
44
Pour la clinique des enfants cachés, voir les publications de Marion Feldman (Paris V).
45
Anny Dayan-Rosenman, Carine Trévisan (dir.), « Le Survivant, un écrivain du XXe siècle », Textuel, n° 43, 2003 ; Anny Dayan-Rosenman, Les Alphabets de la Shoah. Survivre, témoigner, écrire, Paris, CNRS éditions, 2007. Voir aussi toutes les contributions dans : Luba Jurgenson, Alexandre Prstojević (dir.), Des témoins aux héritiers : l’écriture de la Shoah et la culture européenne, Paris, Pétra, 2012.
46
Je souligne. Dori Laub, enfant rescapé de la Shoah, psychiatre, fondateur des Archives Fortunoff à Yale : « Porter témoignage ou les vicissitudes de l’écoute » [1992], Le Coq-héron, no 214-3, 2013, p. 146, 158. À l’initiative de Françoise Davoine, cette revue a consacré deux dossiers à Dori Laub : « Une clinique de l’extrême », Le Coq Héron, no 214-3, 2013, p. 143-158 et no 220-1, 2015, p. 9-124. Shoshana Felman, Dori Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, London, Routledge, 1992 ; Dori Laub, Andreas Hamburger (dir.), Psychoanalytic Approaches to Social Trauma and Testimony: Unwanted Memory and Holocaust Survivors, London, Routledge, 2017.
47
Voir Isabelle Ullern, « Vitale del testo? Sarah Kofman: “come uscire” dal “trauma storico”? », Notes per la psicoanalisi, no 8, 2016, « il trauma, la Storia », p. 65-78 (article traduit en italien par Nicola Jacchia).
48
Lettre de Sarah Kofman à Jacques Derrida du 11.11.1968 (IMEC, fonds J. Derrida).
49
Serge Viderman, « Éclats des textes », Le Céleste et le sublunaire, Paris, PUF, 1977, p. 40-66 (S/Z fut publié en 1970).
50
Sarah Kofman, Rue Ordener, rue Labat, Paris, Galilée, 1994.
51
Monique Schneider, Le Trauma et la filiation paradoxale : de Freud à Ferenczi, Paris, Ramsay, 1988.
52
Monique Schneider, La Détresse aux sources de l’éthique, Paris, Le Seuil, 2011.
53
Isabelle Ullern, « Construction en philosophie ? Autour d’une lettre d’André Green à Sarah Kofman », Revue française de psychanalyse, vol. 79, no 3, 2015, p. 880-886 (suivi de la lettre inédite de Green, p. 887-888).










