« N’être ni dedans à la manière d’un
gardien de l’ordre, ni dehors comme
un barbare ou un béotien. »1
Travailler en politiste sur le parti politique dans lequel on est engagé en tant que militant, dont on est également salarié et/ou élu, ne relève ni de l’évidence, ni de la banalité. Si quelques chercheurs ont rendu compte de leurs expériences passées de candidat·e·s en campagne (Lévêque, Taiclet 2018 : 257-304 ; Navarre 2015 : 223-238 ; Paoletti 2002), Rémi Lefebvre est le seul à avoir revendiqué « la fécondité » de la double position qui caractérise le politiste prenant pour objet de recherche son propre parti (Lefebvre 2010 : 127-139). Rompant avec les travaux d’ex-militants – ces derniers auront sans doute installé l’idée qu’il convient d’en être sorti, pour ne pas dire de s’en être sorti, pour oser prendre la plume –, il ne s’est pourtant risqué à faire fructifier sa proximité avec cet objet (le Parti socialiste) qu’une fois soutenue une thèse dont la perspective socio-historique lui avait permis, souligne-t-il, de le « refroidir », et longtemps après que sa position dans le champ académique ait été sécurisée. C’est qu’en matière de (science) politique, deux précautions valent mieux qu’une.
Alors que les sciences sociales dominent l’espace des réflexions sur le rapport du chercheur à son objet, que la littérature foisonne de textes méthodologiques qui guident l’esprit et la main de ce dernier en toutes circonstances participantes ou immersives, et que sont explorées à longueur de séminaires les délicatesses auxquelles expose l’enquête de proximité ou dite « par distanciation », prendre son parti politique pour objet reste un au-delà de la méthode. Rien n’est jamais tout à fait énoncé, interdit, mais l’on sent bien à travers les silences, les non-dits, la lourdeur des interrogations sur le dispositif d’enquête, qu’il faudra payer de profits de recherche inespérés les gardiens du temple weberien, et montrer bien des pattes blanches méthodologiques pour se voir reconnaître d’avoir dit quelque chose de vrai, de pertinent, d’utile et surtout de scientifique sur son objet. À mi-chemin du comble et de l’ironie d’une science qui se dit politique, le politiste politique porte comme un fardeau particulier l’outrecuidance qui l’a conduit à prendre pour objet la politique qu’il fait et/ou le collectif militant auquel il appartient. Et on l’attend au tournant.
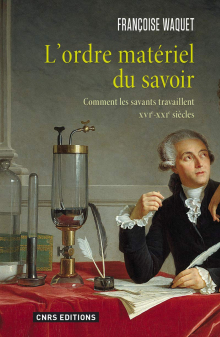
Françoise Waquet, L’Ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles,
Paris, CNRS Éd., 2015.
D’une certaine manière, on a raison. Pris dans les polysémies du politique, il court ici peut-être plus qu’ailleurs le risque de (se) perdre (dans) son objet. Mais à toujours renvoyer l’engagement politique dans la sphère privée au motif qu’il ferait mauvais ménage avec l’œuvre savante, ne prend-on pas un autre risque : celui d’entretenir à trop grands frais et secrets de Polichinelle l’illusion d’une Science politique neutre, désidéologisée, et de laisser s’imposer les manières de questionner le champ politique et d’en rendre compte de ceux qui sont d’autant plus agis par leurs préférences partisanes qu’ils (se) les cachent ? Craignant de faire une Science politique engagée – et il faut ici entendre le terme comme un stigmate –, ne se prive-t-on pas, surtout, des profits de recherche que savent déjà tirer de leurs méthodes d’enquête les historiens, les sociologues et les ethnologues qui travaillent sur des collectifs associatifs dans lesquels ils militent et qui sont, comme les partis politiques, de nature à susciter l’adhésion en valeur et l’embrigadement (par exemple Havard-Duclos 2007, Marakemi 2008 : 165-183 et Broqua 2009 : 109-124) ? Enfin, les préventions ne seraient-elles pas l’aveu d’une confiance trop fragile dans les matérialités de la recherche (Mauss 1936 ; Waquet 2015) et les habiletés réflexives (Bourdieu 2004) que la Science politique a su forger depuis les emprunts faits aux disciplines soeurs et qui la distinguent tout autant que ces dernières de l’intérêt profane ?
Loin de la maladroite tentative prosélyte, l’expérience de mon enquête de thèse conduite sur, par et pendant l’engagement chez les Verts/EELV (Jérome 2014)2 laisse penser que faire le terrain en politiste politique n’a rien d’une gageure méthodologique ou d’une offense épistémologique3. À la double condition de ne pas considérer l’engagement uniquement comme une sorte de Jiminy Cricket malfaisant susceptible de se jouer du chercheur à tout instant, et de consentir à enquêter dans le cadre de dispositifs de supervision qui donnent sens – et juste place – aux expériences personnelles mobilisées, il est en effet possible de tenir le pari que la prise de parti, dans les deux sens du terme, peut produire des effets de connaissance (Becker 1967 : 239-247).
L’entreprise s’avère couteuse, guettée par la désillusion militante et le procès en illégitimité académique. Mais elle offre la possibilité d’explorer, au paroxysme des spécificités méthodologiques fondatrices de l’enquête en sciences sociales, les méandres de l’apprentissage du terrain politique « par corps » (Bourdieu 1997 : 155-193 ; Wacquant 2002 et 2015) et de récolter les fruits d’une « familiarité » (Retière 2006) avec l’objet politique qui ne devrait plus être à craindre.
Autopsie de l’engagement
D’une autre nature que les exercices d’ego-histoire ou d’ego-sociologie – il n’était pas question de parler de moi pour démontrer quelque chose du monde (politique) tel qu’il est4 –, mon travail s’est inscrit, à plusieurs titres, dans la lignée des travaux qui revendiquent une approche biographique, entendue au sens de la méthode (récits de vie, analyse des trajectoires sociales des membres d’une même famille, entretiens - individuels ou collectifs - par unité familiale ou cercle d’interconnaissance élargi…) et du matériel d’enquête mobilisé (correspondances, photos, journaux intimes, autobiographies publiées…).
Développée en Science politique depuis la fin des années 1980, cette approche m’a offert de ne pas envisager mon engagement comme un simple élément facilitateur de l’accès sur le terrain (je peux enquêter parce que je suis déjà là) ou une garantie d’analyse ex post (je suis clairvoyante parce que j’en ai été) mais comme l’unité de temps et de lieu grâce à laquelle je pouvais éprouver, de manière continue, la mise en intelligibilité du milieu partisan étudié. J’ai ainsi fondé ma politique du terrain – entendue comme une pratique et une éthique de travail – sur un ensemble de dispositifs, que l’on pourrait dire supra-méthodologiques, qui ont armé mon esprit et mon bras tout au long d’une enquête, et m’ont permis de mettre à profit toutes les vertus de la familiarité.
Un certain regard
Débutant ma recherche en 2005, alors que j’étais adhérente depuis trois ans et collaboratrice d’élue depuis 20035, je n’ai pas pu compter sur l’étrangeté qu’aurait pu susciter a priori mon objet d’étude. Intéressée à comprendre les logiques qui structurent les carrières militantes vertes (qui s’engage ? où ? comment ? à quel moment ? pour faire quoi ? de quelle manière ? jusqu’à quand ?), j’ai fondé ma recherche sur un déplacement de regards – celui porté sur mon objet et celui que je portais sur moi-même prise dans mon objet – susceptible de produire les conditions d’une « objectivation participante » (Bourdieu, Wacquant 2014).

Olivier Fillieule (dir.), Le désengagement militant,
Paris, Belin, 2005.
Plaçant au centre de cette construction les flux et les reflux de mon engagement (Fillieule 2005), j’ai parié que je pourrais les considérer comme des supports de connaissance. Ils permettent en effet, tant que l’engagé tient à son engagement autant que son engagement le tient, d’éprouver la succession des déconstructions et reconstructions de l’univers de croyances et de pratiques qui fondent l’engagement politique et le matérialisent. Faisant ainsi, je suspendais la recherche à ma capacité toujours renouvelée de livrer à la confrontation critique les éléments constitutifs de mon illusio (Bourdieu 1997) militante. L’enquête s’envisageait alors dans un double mouvement et avec un double risque : compter sur l’engagement et la connaissance du milieu pour résoudre les obstacles classiques (difficulté à entrer sur le terrain, difficulté à saisir les enjeux stratégiques et relationnels ainsi que les entre-soi, incompréhension de la langue indigène…) au risque de ne pas réussir à les objectiver tout à fait ; risquer l’engagement militant (les croyances, les valeurs, les intérêts, les apprentissages, les pratiques quotidiennes, les rétributions militantes… qu’il implique), quitte à le saper au point de voir disparaître l’objet de la recherche.
J’ai malgré tout saisi ce que je considérais comme l’occasion de me tenir à la seule frontière qui promettait, ce qui n’avait jamais été fait, de théoriser in situ et in vivo les (dés)engagements militants verts.
Supervision(s)
Consciente d’entamer une enquête dans laquelle j’étais déjà « affectée » (Favret-Saada 2009 : 145-161) et sans savoir toujours de quelle(s) manière(s), j’ai procédé à une auto-socioanalyse (Bourdieu 2004 ; Noiriel 1990 : 138-147). Engagée en phase exploratoire de la recherche, elle n’a en réalité jamais pris fin.
Consistant dans des dispositifs d’écriture introspective ; dans l’adjonction aux journaux de terrain, à côté des rubriques classiques (observations factuelles / analyses), d’une page dédiée à la dissociation entre le je de l’enquête et le je militant ; dans l’analyse des entretiens accordés dans le cadre de mes fonctions d’enseignante et d’élue ainsi que dans celle des échanges informels qui ont émaillé ma présence sur le terrain, l’auto-socioanalyse m’a permis de formuler de nombreuses hypothèses. Leur potentiel opératoire a tenu sur les similitudes qui apparaissaient au fil de l’enquête entre mes caractéristiques sociologiques et celles, variablement mais sûrement distribuées, d’enquêté·e·s dont j’avais décidé d’analyser en profondeur et sur plusieurs générations la trajectoire.
Une fois dépassé le sentiment d’étrangeté qu’induit le fait de devenir « à [s]oi-même, un ‘autre social’ » (Noiriel 1990 : 138-147), j’ai tenté de tirer parti au mieux de cette proximité. La trame du guide pour les entretiens biographiques et plus tard l’objectivation des trajectoires militantes ont été nourries de la comparaison avec les enquêté·e·s. Les questions dédiées à l’analyse des (dés)engagements et des étapes qui jalonnent le processus de semi-professionnalisation politique qui caractérise les Verts/EELV6 ont, quant à elles, été inspirées par l’objectivation des moments clés de mes (dés)illusio militantes et de l’observation de mes manières de jouer de mon « identité stratégique » (Collovald 1988 : 29-40) verte dans le cadre de l’exercice de mes mandats.
Transformer l’auto-socioanalyse en véritable habitude de travail a été d’autant plus constructif que ma relation particulière au terrain a été, en elle-même, l’objet d’échanges spécifiques lors des séances de guidance de thèse7 et d’analyse8. Les précautions et conseils formulés dans ces cadres m’ont permis d’objectiver en confiance et en toute transparence les relations à chaque enquêté·e·s et surtout, de mettre à distance les jugements militants ou personnels. L’analyse de telle trajectoire militante ou l’écriture de tel passage de l’histoire récente du parti ont par exemple, dans ce cadre, pu être repoussées jusqu’à ce que les affects militants soient contrôlés.
Condition de possibilité de mon enquête, la combinaison de ces pratiques réflexives et de ces dispositifs apparaît comme le point nodal du développement d’une « réflexivité réflexe » (Bourdieu 2001) qui m’a permis, pour peu que j’accepte d’être sans cesse et sans répit « en enquête », de contrôler l’essentiel des biais constitutifs de ma double position. Elle est d’autant plus indispensable que je devais négocier avec des formes d’apprentissage du terrain complexifiées. Si les perturbations créées par les changements de rôles (militante/politiste) sont autant d’occasions de voir et/ou faire apparaître les logiques sociales du milieu, elles portent en effet à leur paroxysme l’aspect « connaissance par corps » de la récolte des données.
(Des)apprentissage(s)
Profiter du caractère assez paisible de l’entrée dans l’enquête – l’antériorité de ma présence sur le terrain empêchait le plus souvent les militant·e·s de la ressentir comme un événement disruptif – m’a permis de déployer un dispositif de récolte et d’interprétation des données adapté aux délicatesses de ma double position.
Mes expériences ont tout d’abord été mobilisées pour construire mes interrogations de départ. La diffusion de tracts et les séances d’assemblée ont, par exemple, été très structurantes : je n’aurais en effet pas pris au sérieux les menaces de mort, les injures ou les moqueries qui fondent l’habitus minoritaire des militant·e·s si je ne les avais pas subies pour commencer ; pas plus que je n’aurais compris, si je n’avais pas été élue, comment l’on peut jouer de toutes les identités stratégiques vertes pour ne pas perdre la face lors des séances d’assemblée, ou comment l’on fabrique des politiques publiques vertes si je n’avais pas eu à en créer.
Ma connaissance incorporée du terrain a ensuite éclairé la construction des hypothèses et modèles d’analyse. Socialisée de longue date chez les Verts, je maîtrise leurs catégories de pensée, leurs pratiques et leur vocabulaire. Mon effort méthodologique a donc, à l’inverse de celui que doivent souvent fournir les politistes, consisté à me dés-imprégner, à dé-construire ma socialisation, mes catégories de pensée, et parfois mes automatismes pratiques. Soutenue par l’habitus primaire de catholique que je partage avec nombre d’enquêté·e·s, qui dispose aux introspections évaluatives, et par mon habitus secondaire de sociologue dont l’esprit est entraîné aux objectivations sociales, j’ai remonté le fil de mes souvenirs pour retracer les modalités de mon intégration à ce milieu et celles de la modification de mes pratiques quotidiennes. J’ai aussi porté une attention particulière aux conversations anodines pour re-découvrir les catégories du langage vert, les jugements de valeur et les manières vertes de découper la réalité sociale, et me suis laissée re-prendre par tel ou tel rituel pour reconstruire les séquences de la socialisation partisane. Peu à peu, l’effort de dés-apprentissage et de dés-imprégnation, que j’ai consigné dans mes carnets de terrain au même titre que mes observations ou comptes rendus de conversations informelles, m’a permis de retracer la chronologie du processus qui m’a faite « verte » et de poser des hypothèses que je ne retenais que si elles valaient pour une majorité de mes enquêté·e·s. (Dés)apprendre « par corps » a ainsi été plus qu’une incidence du travail intellectuel : un impératif méthodologique, qui me faisait être mon propre outil pédagogique.
(Se laisser) faire (par) le terrain
Ayant préalablement à ma recherche éprouvé toutes les interprétations disponibles en science politique à propos des Verts sans qu’aucune de me paraisse entièrement rendre compte des complexités militantes que je vivais, et ayant engagé mon enquête dans un moment de – relatif – désengagement, je me suis souvent laissée faire par le terrain. Profitant de la sorte de souplesse que me permettaient les différents rôles et postures d’enquête disponibles, lesquels autorisent d’ailleurs quelques découvertes insoupçonnées (Fainzang 1994) – comme, par exemple, le maquillage d’adhérent·e·s vert·e·s en candidat·e·s dits « d’ouverture » ou l’existence de violences sexistes et sexuelles dans le parti –, j’ai eu le sentiment, non pas de faire du terrain, ni même de faire le terrain (De la Soudière 1988), mais plutôt de le re-faire.
Dans ce cadre, la sensation de flou dans laquelle j’ai parfois enquêté – ne sachant plus quelle casquette emprunter pour saisir le plus clairement possible les situations dans lesquelles je me trouvais – m’est apparue comme une opportunité heureuse, y compris du point de vue la production des données. J’ai en effet pu objectiver ma place dans un dispositif de récolte parfois désordonné, faisant la part de ce qui m’était adressé en tant que chercheuse, et de ce qui l’était à la militante ou à l’élue que j’étais aussi. Chaque retranscription d’entretien et de conversation comportait ainsi une rubrique « à qui il/elle parle ? » qui m’a permis de délier les différents je destinataires. Je n’ai toutefois pas eu le sentiment de vivre la sorte de dédoublement que décrit parfois la littérature (par exemple Weber 2009) ni même de schizophrénie. L’enquête en double position nécessite en effet assez de rigueur et de méthode pour prémunir le chercheur de toute expérience hallucinée.
Politique de l'enquête
Jonglant entre impératifs méthodologiques et réalités de mon terrain, j’ai procédé à une « construction progressive » (Fabre 1986) des matériaux d’enquête et des analyses.
Récoltes
Les observations ont été réalisées en trois temps. Le premier a consisté dans l’observation directe, plus ou moins participative, de réunions et événements internes proposés dans les espaces du parti dans lesquels j’évoluais déjà et qui sont, de ce fait, l’expression la plus spécifique de ma double position. Ici, j’ai dû trouver le moyen de perturber mes routines au point d’être capable de re-découvrir le milieu pour y voir quelque chose. Aidée de précis de méthode qui permettent de dresser une liste quasi exhaustive de ce qu’il convient d’observer, j’ai, par exemple, pris des notes en changeant physiquement plusieurs fois de place. Me tenir à l’arrière de la salle ou sur ses côtés, parfois même en surplomb ou dans l’espace réservé à la presse, m’a permis de juger scénographies, discours… et de me déprendre des dispositifs émotionnels utilisés pour susciter la mobilisation (Traïni 2009). Dans d’autres occasions, j’ai pu théâtraliser la posture de l’ethnologue, pour mieux faire accepter que je m’isolais ou que je ne prenais plus part aux commentaires et traits d’humour qui qualifient l’entre-soi militant. Le plus souvent, un « Là, je fais la sociologue, on se voit après », suffisait dans un échange de sourires à faire accepter ma nouvelle manière d’assister aux événements militants. Lorsque je devais animer ou co-animer les événements, je notais, en différé et de mémoire, les faits ou propos les plus marquants, à partir de notes ou de mots clés que j’avais pris l’habitude de griffonner en cachette dans ce type de circonstances. J’ai aussi adopté cette méthode pour commenter ex-post des entretiens (description des lieux, des vêtements, des impressions relatives à l’interaction d’enquête…) ou noter quelques remarques sur la vie privée des militant·e·s ou sur leurs modes de vie. Inscrire ostensiblement celles qui concernent les intérieurs de maison ou les produits – ménagers ou culinaires – utilisés alors que l’on vous parle « comme à une amie » aurait en effet été fort indélicat (Bizeul 1998 : 751-787).
Le deuxième temps d’observation a concerné les terrains formels (une commission nationale thématique et des groupes locaux représentatifs). Ici, j’ai plus spécialement géré mes interactions avec les militant·e·s proches qui avaient en quelque sorte parrainé mon entrée sur ces terrains. Ces complices, parfois aussi informateurs, ont fait attention à ne pas trop surjouer leur rôle de militant·e·s observé·e·s, et sûrement veillé à leurs conduites et propos sachant que j’avais de multiples moyens et occasions de recouper les informations, et de les obliger à me répondre et à en répondre plus tard (certains m’avaient déjà livré en entretien – ou s’apprêtaient à le (re)faire – des éléments de leur biographie ou relatifs à leur engagement militant). Consciente de ce biais, je ne me suis pas trop engagée dans les activités de ces groupes, les différenciant ainsi, par ailleurs, des espaces de mon propre investissement militant. Ceci à quelques exceptions près, dans lesquelles j’ai agi en tentant de satisfaire aux usages du groupe observé : apporter à boire et à manger lors de réunions dans un groupe local dans lequel cela se fait ne m’a, par exemple, pas paru trop engageant, pas plus que ne l’était le fait, de récupérer, autre exemple, les tracts mis dans les poubelles lors de distributions matinales pour les rapporter aux militant·e·s qui ne souhaitaient pas les gâcher. Ces actions ont par ailleurs donné lieu à quelques plaisanteries ou remerciements qui m’ont permis d’explorer, au-delà de l’entre-soi qu’elles créent, les pratiques spécifiques mises en œuvre en période de campagne électorale. En revanche, je me suis interdit de distribuer les tracts et de m’engager dans la relation prosélyte à laquelle cette pratique engage.
Enfin, j’ai observé des situations et des interactions nouvelles, au moment de la transformation, en 2010, des Verts en EELV. Les conflits et les déséquilibres dans les rapports de force auxquels cette transformation a donné lieu ont en effet subtilement modifié quelques us et coutumes qu’il m’a été, après tant de temps passé sur le terrain et me trouvant ici dans une situation d’enquête plus classique, facile de repérer. De nouvelles hypothèses sont ainsi apparues, infirmant ou saturant les anciennes.
Les observations directes ont été complétées par des observations par personnes interposées, grâce à plusieurs militant·e·s que j’ai considérés, avec leur consentement, comme des interlocutrices et interlocuteurs privilégié·e·s. Ils me rendaient compte, lors d’entretiens réguliers (de visu ou téléphoniques), d’événements auxquels je n’avais pas pu assister. Nous échangions ainsi parfois longuement autour des informations transmises et de celles que je leur proposais de continuer à récolter.
Toutes ces observations ont contribué à élaborer des hypothèses plausibles, et donné lieu aux « descriptions denses » (Geertz 2003 : 208-233) qui donnent à voir, dans la thèse, comment fonctionne le parti vert et de quoi est fait le milieu militant dans lequel il s’intègre.
L’entretien a constitué le deuxième outil de l’enquête. Je l’ai utilisé de manière classique, sans méconnaître son caractère complexe et fragile, propice aux dominations symboliques (Chamboredon, Pavis, Surdez, Willemez 1994 : 114-132) et aux reconstructions biographiques (Bourdieu 1986 : 69-72), pour repérer les caractéristiques socio-professionnelles des enquêté·e·s, retracer le fil de leur engagement, répertorier l’ensemble de leurs pratiques quotidiennes et politiques, ainsi que pour comprendre l’action des élus (Pinson, Sala Pala 2005 : 555-597). Deux sortes d’entretiens ont été mobilisés : des entretiens informatifs, non enregistrés, réalisés de visu ou au téléphone ; et des récits de vie formels enregistrés, en face à face dans l’immense majorité des cas.
Si cette part de la récolte des données est souvent pointée comme étant la plus sensible aux effets pervers de la familiarité, elle révèle plutôt ici un continuum relationnel finalement peu surprenant. Les entretiens avec les militant·e·s que je ne connaissais pas avant mon enquête ont surtout été facilités par le partage d’une histoire partisane commune et la compréhension des mots et références de l’entre-soi. Quant à ceux conduits auprès d’engagé·e·s dont j’étais plus proche, ils n’ont rien révélé que de très classique : domination symbolique (un académique versus une doctorante), mauvaise gestion de la proximité (échange sympathique mais pas toujours très informatif)… En revanche, leur analyse a été plus délicate. Si ma familiarité avec les (prises de) positions des enquêté·e·s et la connaissance du vocabulaire « indigène » a facilité le travail, la nature biographique des entretiens et la confiance avec laquelle certain·e·s s’étaient livré·e·s m’engageait sûrement à éprouver une forme d’empathie interprétative. La violence symbolique inhérente au travail d’objectivation sociologique de l’engagement des autres m’était en effet d’autant plus perceptible que je savais fort bien ce que me coûtait le mien. J’en ai finalement tiré parti une fois prise l’habitude de noter, comme pour adoucir dans un premier temps mon regard sur leurs trajectoires, les motifs de proximité que j’avais avec chacun d’eux et les raisons qui me les faisaient éprouver. L’analyse des entretiens a nourri les fiches individuelles établies pour chacun des enquêté·e·s, lesquelles ont été complétées et actualisées pendant toute la durée de l’enquête. J’ai ainsi pu comparer propos tenus en entretien et pratiques partisanes, motifs de (dés)engagement et évolution des trajectoires partisanes.
D’autres méthodes de récolte de données ont, enfin, été mises en œuvre pour compléter les observations et les entretiens. Si elles ne diffèrent en rien des enquêtes plus classiques (revues de presse ; collecte de documents internes du parti – journaux, lettres, documents institutionnels, brochures thématiques, document de formation… – ; échanges informatiques – mails, listes de discussion, web lettres… – ; archives9), elles ont autant servi à obtenir des informations directes qu’à trianguler, sur le long terme, les informations données par les enquêté·e·s.
Les archives d'EELV avant dépouillement.
Elles sont désormais conservées au Centre international de recherche sur l’écologie (CIRE)
de l’Agrotech Grignon et à la Fondation de l’écologie politique.
Conformément aux principes de l’enquête ethnographique, je n’ai par ailleurs pas attendu la fin de l’enquête proprement dite pour commencer à analyser et à interpréter les données. J’ai classiquement procédé à de nombreuses micro-interprétations (Schwartz 1993 : 265-308), par itération, concevant ici les phases interprétatives comme un va-et-vient entre problématique et données. Tout aussi attentive aux motifs récurrents qu’aux cas négatifs qui viendraient les contredire, j’ai, parmi la somme conséquente d’éléments accumulés depuis 2002 et tout au long de l’enquête, retenu ceux dont la lecture, faite au long cours et selon leur degré de « significativité » (Gossiaux 1998), atteignait le degré de saturation et permettait, de ce fait, de monter en généralité. Dans ce cadre, me référer à mes expériences, de manière ni honteuse, ni inconsciente, ni incontrôlée, m’a permis de faire de mon engagement militant une ressource scientifique irremplaçable. Les biais induits par l’appartenance au milieu étudié ne semblent ainsi pas plus insurmontables que ceux induits par l’altérité.
Restitutions anonymes ?
Le travail d’écriture a été réalisé dans le double souci de rendre compte de la recherche et de préserver les enquêté·e·s. En être, n’a, contre toute attente, pas été à ce moment le plus important des problèmes. En effet, si j’ai parfois écrit en pensant que je serais peut-être suspectée de nourrir du ressentiment à l’égard du parti ou de certain·e·s de ses élu·e·s, ou d’instrumentaliser les conclusions de mon enquête, la petitesse du parti – qui rend facilement reconnaissables ses militant·e·s – et le niveau de médiatisation de ses dirigeant·e·s et élu·e·s, a été plus problématique. Non pas qu’il se soit agi de savoir qui anonymiser, comment et sur tel principe, mais plutôt de faire face à l’évolution rapide du statut des enquêté·e·s. En 2002 par exemple, Cécile Duflot entrait au parti ; elle en a finalement été l’une des figures principales ces dernières années. De la même manière, Pascal Canfin n’était pas connu du grand public lorsqu’il a accepté, en 2006, que je teste avec lui mon guide d’entretien. Quant à Dominique Voynet, finalement peu présente dans mon travail, elle était encore la personnalité verte de référence au début de mon enquête. De ce fait, des enquêté·e·s qu’il aurait été impossible d’identifier dans le temps de mon enquête sont désormais impossibles à anonymiser, alors que d’autres, parfois mieux connu·e·s, semblent n’occuper qu’une place mineure dans mon travail.
Conséquemment, j’ai pris le parti de procéder à des anonymisations à géométrie variable. Considérant qu’être élu·e ou dirigeant·e de parti nécessite d’avoir accepté une forme de publicisation de son engagement, je n’ai pas caché le nom des élu·e·s, ni celui des figures vertes, qui sont par ailleurs, vu la petitesse du parti, vite reconnaissables. Je n’ai pas non plus caché les noms des ex-militants qui répondaient aux mêmes critères, ni celui des intellectuels qui avaient accepté de rendre publique leur appartenance aux Verts. J’ai en revanche anonymisé les noms des militant·e·s dit « de base » et ceux de leurs enfants. Dans leur cas, je me suis aussi refusée à utiliser tout extrait d’entretien qui me semblait de nature à alimenter des conflits professionnels, militants ou familiaux. J’ai enfin souvent attribué à des sources journalistiques des informations dont j’avais connaissance avant leur publication, pour préserver l’identité de mes informateurs, avec qui je me suis parfois mise d’accord sur ce que je pouvais, ou pas, leur attribuer comme propos. Cette précaution a surtout été prise lorsqu’il s’agissait de divulguer des stratégies de négociation ou d’investitures, ou de recueillir des informations relatives aux violences sexuelles dans le parti. Ayant conscience que les risques du métier, qui ne finissent pas toujours avec la fin de l’enquête, seraient d’autant plus prégnants que je n’envisageais pas de sortir du terrain, j’ai adopté une posture qui peut paraître délicate : divulguer tous les faits et protéger au mieux les personnes. Car dans le cadre d’enquêtes en double position plus que dans d’autres, les coûts et les profits de la recherche ne sont pas univoques. Ils travaillent même de manière paroxystique l’ensemble des frontières de l’enquête.
Les frontières de l’enquête
Les particularités d’une enquête en double position sont liées au fait que le chercheur « en est », et de plusieurs manières. Si ceci lui permet d’accéder à une forme d’ubiquité généralement peu envisageable, cela le conduit dans le même temps à (ré)interroger l’ensemble des frontières temporelles, spatiales et interactionnelles qui délimitent habituellement les enquêtes de terrain. Alors que ces interrogations s’entrecroisent dans la réalité, elles sont exposées ici successivement, pour plus de clarté.
Un terrain qui n’a ni début ni fin ?
Je ne suis pas entrée sur le terrain depuis l’ailleurs à un moment précis, ni n’en suis sortie au bout d’un certain temps pour aller autre part. Le début de l’enquête, tout comme sa fin, procèdent ici, comme c’est parfois le cas (par exemple Navarre 2015 : 223-238), d’une logique déclarative. Décidant en 2005 de me transformer en enquêtrice, et de le faire savoir, j’ai, de la même manière, annoncé, en 2014, que je cessais d’enquêter tout en restant adhérente du parti. Si ma présence sur le terrain antérieurement au début de l’enquête a minimisé les coûts et les risques d’une entrée plus classique sur le terrain – notamment liés à l’(auto)censure qu’implique la distance sociale, genrée et/ou générationnelle qui sépare souvent enquêteurs/trices et enquêté·e·s dans les partis politiques –, elle ne doit pas laisser penser que j’ai, pour autant, pu contrôler l’officialisation de mon entrée en enquête, ni même mon accès aux différents terrains.
Compte-tenu du fort turn-over militant et des variations dans l’espace de mes observations, tous les militant·e·s n’ont pas été informé·e·s de ma recherche. Ceux qui l’ont été n’ont, par ailleurs, pas tous obtenu l’information de ma part, ni dans des termes adéquats et similaires. J’ai en effet parfois été dépossédée de l’annonce de ma recherche ou d’une demande d’entretien – l’un·e des militant·e·s agissant en ma présence mais dans des termes si peu adaptés qu’il m’était difficile de les rattraper, ou tout à fait en dehors de moi – m’obligeant de ce fait à renoncer aux interactions dont je ne pouvais pas contrôler les contextes dans lesquelles elles avaient été acceptées. D’autres militant·e·s ont eu l’information alors que je n’avais pas prémédité de la leur donner, par exemple lorsqu’au cours d’une réunion ou d’un événement ils me demandaient ce que je faisais « avec un carnet de notes à la main ». Cette situation s’est rarement produite, ma prise de notes ne suscitant guère d’interrogations – était-elle autorisée ? par qui ? au nom de quoi ? – dans un parti où les militant·e·s en prennent souvent et de manière spontanée, et dans lequel ma présence longue et continue invisibilisait beaucoup cette pratique lorsqu’elle était moins partagée. Vivant l’inconfort de ne pas toujours savoir si mes interlocuteurs savaient si j’enquêtais, ni par qui ils avaient eu l’information (et laquelle précisément ?), ni même ce qu’ils savaient exactement de ma recherche, j’ai pris beaucoup de précautions pour présenter mon travail à ceux qui acceptaient de m’accorder des entretiens formels ou d’être observés. Il s’agissait ici, classiquement, de contenir au mieux les effets d’une annonce faite par d’autres que moi, et qu’ils pouvaient toujours me cacher, sur le contenu des échanges.
Je n’ai par ailleurs pas toujours été dispensée du travail de présentation de soi – et de sa recherche – auquel se livre généralement tout enquêteur ; soit pour « rattraper » une présentation malencontreuse de ma recherche par un·e militant·e, soit pour entrer sur des terrains d’observation qui, bien qu’adhérente du parti, ne m’étaient pas familiers (tel groupe local ou telle commission partisane). Dans ces cas, j’entrais puis sortais du terrain de manière plus classique, sous le parrainage et le contrôle de militants. Grâce à eux, l’accès à certaines informations était facilité, les délais d’entretiens parfois raccourcis, et je pouvais observer des pratiques ou détenir des informations qui ne m’auraient pas été accessibles autrement. Ces terrains dans le terrain, pourrait-on dire, m’ont ainsi permis d’expérimenter, comme n’importe quel chercheur étranger à son objet, le rôle de gatekeeper que jouent certains militant·e·s. Ouvrant et fermant l’accès à la portion de terrain qu’ils contrôlent et dont les ramifications sont parfois étendues, ils autorisent le chercheur autant qu’ils le contraignent, et contribuent ainsi à façonner la géométrie – variable – des espaces et des temps d’enquête.
Au moment de la soutenance de ma thèse en 2014, et malgré l’annonce faite de l’arrêt de mon enquête formelle, il était évident que je faisais toujours partie de mon terrain. Contrairement à la plupart des chercheurs, même les plus engagés dans leurs objets, je me refusais ainsi le confort ordinairement attaché au statut de l’enquêteur qui est le plus souvent, par définition, celui qui peut partir. Restant sur et dans mon terrain, je conservais un accès privilégié à certaines informations, ce qui me permettait de continuer à saturer mes hypothèses ou à réajuster mes analyses, si besoin, à moindre contrainte de temps10.
J’avais ainsi fait, dans des temps et des espaces qui se chevauchaient sans toujours se recouvrir, l’expérience de terrains courts, délimités et contraints, et celle d’une immersion longue et relativement libre dans le parti. Mettant à profit ces espaces et temporalités distinctes, sans m’interdire d’utiliser l’ensemble des données, y compris rétrospectives (Bulmer 1982 : 251-264), auxquelles mon ancienneté sur le terrain m’avait permis d’accéder, j’ai composé avec le fait de (ne pas) en être.
Les conséquences de (ne pas) en être
Au-delà des interrogations classiques sur le degré à consentir dans la participation aux activités du collectif observé, le fait d’en être suscite un ensemble de problèmes dont il convient d’évaluer la spécificité. Si l’on comprend que l’immersion longue en terrain partagé permet de découvrir ce que d’autres enquêteurs moins bien socialisés au milieu n’auraient pas vu, ou de saisir le caractère très codifié des interactions et ce qu’elles contiennent d’implicite ou d’inavouable, le confort apparent de l’appartenance complique les relations avec les enquêté·e·s.
Non contente d’être réputée « sachante des affaires locales » (Ouattara 2004 : 635-658), ce qui invite les enquêté·e·s à être très précautionneux, ou au contraire, très prolixes, j’ai dû composer avec les changements de statut impliqués par l’évolution de ma trajectoire militante. Militante identifiée ou observatrice incognito (Broqua 2009 : 109-124), collaboratrice, experte sur des groupes thématiques ou encore élue, il m’a été difficile de saisir le poids et l’impact de ces changements sur les relations qui se nouaient avec les enquêté·e·s. Considérant que l’on est choisi par eux autant qu’on les choisit, on peut malgré tout penser que les interactions auront été d’autant plus acceptables et riches d’enseignements que nous avions le sentiment de partager assez de croyances et d’intérêts pour que chacun soit satisfait des échanges.
Nombreux ont été, par exemple, les entretiens formels qui ont été précédés – ou se sont prolongés – par une discussion d’un autre genre, sur tel dossier sur lequel nous devions travailler ensemble ou sur la situation de tel ou tel candidat à une investiture. Soucieuse de tenir compte des effets de ces échanges et de ceux induits par la relation entretenue avec chacun·e des enquêté·e·s, j’ai systématiquement consigné informations factuelles et impressions dans une rubrique intitulée « autour de l’entretien » que je renseignais tout de suite après l’échange. Je n’ai considéré qu’à une seule occasion que l’entretien réalisé n’était pas exploitable. L’enquêté, en désaccord avec les prises de position de l’élue pour laquelle je travaillais alors, ne l’avait accepté que pour me transmettre, sans grande subtilité d’ailleurs, les messages qu’il souhaitait faire passer à cette dernière.
Il me semble ainsi avoir enquêté dans un espace réciproque de multiplicité de (jeux de) rôles plus ou moins savamment contrôlés. De ces jeux dépendaient parfois, non pas mon maintien sur le terrain de l’enquête, mais les conditions de confort dans lesquelles je travaillais. Faire circuler des informations, ou faire bénéficier tel ou telle de mon « carnet d’adresse », en plus d’attester de la qualité de mon écoute, de ma capacité à comprendre et de ma volonté de savoir, m’ont parfois permis de conserver une relation de confiance avec mes enquêté·e·s. Établie en différé dans le temps plutôt que dans un donnant-donnant immédiat, cette irréfragable part d’échange a suscité des effets qui restent parfois difficiles à évaluer. Elle a en tout cas permis que j’enquête dans des conditions acceptables, y compris aux moments les plus délicats de la vie d’un parti politique (négociations électorales, tractations de congrès, renouvellement des équipes dirigeantes…). Ainsi, si mon enquête a malgré tout été déstabilisante, c’est surtout parce qu’elle a parfois suscité, chez certain·e·s adhérent·e·s, des formes de démoralisation ou de démotivation que je n’avais pas anticipées.
Ayant fait des (re)flux de mon engagement le support de ma connaissance, j’ai en effet sous-estimé l’effet, sur le long terme, d’interrogations propres à dépister ces reflux chez les militant·e·s auprès desquels j’enquêtais. S’ils n’ignoraient pas eux-mêmes ces aléas de l’illusio militante, mon enquête avait le défaut de les souligner. M’en rendant compte, j’ai tenté de contrôler l’image – nécessairement – évolutive que j’avais de mon objet de recherche, et dont je craignais d’autant plus les effets « autoréalisateurs » sur mes enquêté·e·s qu’ils formaient, pour la plupart, des groupes militants très interconnectés.
Militante encartée, je n’ai jamais rejoint de courant en particulier – ce qui constitue en soi le signe d’un moindre degré d’intégration – ni jugé publiquement les (dys)fonctionnements du parti. Une fois l’enquête décrétée, j’ai d’autant plus tenu à cette sorte d’extériorité que je pensais qu’elle serait un avantage et qu’elle me prémunirait de tout phénomène supplémentaire d’« enclicage » (De Sardan 1995 : en ligne). J’ai ainsi pris un soin particulier à entretenir une sorte de flou, me déclarant « hors courant » ou ne détrompant pas les interlocuteurs qui m’attribuaient quelques préférences partisanes – d’ailleurs souvent contradictoires entre elles. Si cette marque d’attachement particulière au parti que constitue l’appartenance à un sous-groupe a pu me faire défaut, me privant notamment d’une socialisation militante plus soutenue, elle n’a pas été d’un coût prohibitif pour l’enquête. Je bénéficiais en effet d’un réseau d’informateurs qui me tenaient informée de ce qui se débattait et se décidait dans ces espaces, me permettant ainsi d’inclure le point de vue de chacune des sensibilités dans mes réflexions. Ma distance avec les luttes internes a par ailleurs été compensée par mon engagement militant, qu’il était impossible de remettre en cause vu mes fonctions successives. Il m’a aussi protégée de toute forme de prosélytisme, qui n’est pas, il faut le souligner, très forte chez les Verts, toujours enclins à penser que la vérité de leurs discours et la pertinence de leurs positions suffisent à susciter l’adhésion, tant à leur parti qu’à l’un de leurs courants.
Même sans affiliation à un courant, mon engagement a par ailleurs permis qu’il ne soit jamais formulé à mon endroit de demande de discours apologétique ou de légitimation (Massicard 2002 : en ligne), ni même de contrôle sur ce qui sera dit (Matonti 1996 : 114-127). Les enquêté·e·s, comme la plupart des dirigeant·e·s, auront sans doute pensé qu’ils pouvaient compter sur mon adhésion à la cause écologiste pour ne pas présenter une image trop négative des Verts. Je me suis ainsi contentée de songer à l’effet électoral que la publication de tel ou tel passage de mon travail pourrait avoir, surtout lorsqu’il s’est agi de décrire certaines logiques d’investiture qui s’accordent mal avec l’image que certain·e·s militant·e·s ou électeurs se font de ce mouvement.
Si l’appartenance permet d’apprécier la possibilité d’endosser plusieurs rôles et de participer, de manière plus ou moins engagée, aux diverses activités du parti, il ne faut pas nier que les interlocuteurs de l’enquête ne se privent pas d’user aussi de ces rôles à leur avantage. Tel enquêté·e a ainsi pu me présenter, en fonction de ses interlocuteurs et des relations qu’il entretenait avec eux, comme une amie, une militante verte, une élue ou une sociologue enquêtant soit « sur le parti » ou « sur leur action », ce qui était alors une manière de se valoriser.
En être aura ainsi été, malgré toutes ces délicatesses, un atout significatif pour enquêter sur une population extrêmement rétive à toute tentative d’objectivation et sur un parti politique dont l’(in)organisation spécifique – elle rend difficile d’accès un ensemble de matériaux nécessaires à la recherche – se combine avec des caractéristiques plus classiques : existence d’espaces non autorisés et de différents niveaux de transparence. Être son propre informateur, sans se passer d’en avoir par ailleurs, être présent lors des « tambouilles » et « manigances entre courants » sans y prendre part, jouer sur plusieurs tableaux et endosser plusieurs rôles, auront été ici autant de compromis utiles.
Unique en son genre, cette enquête m’a laissé la conviction profonde qu’il y a une différence indépassable entre celui qui vit le rôle politique dans sa chair et celui qui ne fait que l’observer. Les peurs liées aux menaces de mort, les excitations sensorielles lors des campagnes électorales, les battements de coeur au moment de faire des discours qui comptent, l’épuisement lié à l’obligation de combiner des vies multiples et de tenir la succession des séances nocturnes, le partage des colères des citoyens, les nuits blanches de doute avant les votes… font la part irréductible, et peut-être intransmissible, de l’expérience de politiste politique. Pourtant, loin de moi l’idée d’affirmer qu’il faudrait à tout prix « en être » pour faire meilleure oeuvre de science (politique). Prétendre cela équivaudrait, c’est évident, à voir s’évanouir tout projet de connaissance, et à faire disparaître jusqu’à l’idée même de science.
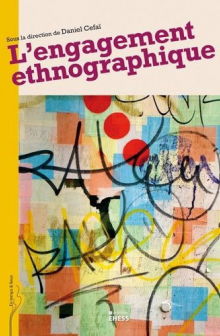
Daniel Cefaï (dir.), L’engagement ethnographique,
Paris, Éd. de l’EHESS, 2001.
Celle que j’ai pu faire est, à bien des égards peu originale ; surtout si l’on considère que « la question de l’engagement ethnographique doit […] se penser à partir de l’empêtrement, plutôt que du désengagement » (Gonzalez 2001 : 107-128). Les données récoltées, que l’on a vite tendance à réifier et mythifier, ne sont en effet rien de plus, il faut le rappeler, que « les produits de notre histoire sur le terrain » (Bensa 2008 : 323-328) et de l’« inquiétude ethnographique » (Fassin 2008 : 7-15). La capacité à produire une enquête en double position n’est ainsi que la résultante d’une expérience à la fois intellectuelle et corporelle, faite d’épreuves successives, où l’on aura autant appris grâce à que malgré soi, et dont on ne ressort qu’empli d’une forme d’humilité créatrice qui fait peut-être l’essentiel du savoir-faire ethnographique. Cette dernière est sûrement, ce que l’on ne souligne guère, une condition sina qua non de la valeur scientifique des interprétations.
L’enquête en double position dans un parti politique se révèle ainsi, surtout, comme une radicalisation des attendus de l’enquête ethnographique, une occasion – à défaut d’une méthode – de se frotter de manière paroxystique à quelques frontières épistémologiques et méthodologiques. Elle procure d’évidents bénéfices, pendant qu’elle en interdit d’autres. À distance assumée des préjugés de ceux qui la constituent en déviance, elle séduira ceux qui considèrent qu’il faut être bien naïf ou bien inexpérimenté, en science comme en politique, pour affirmer qu’un·e politiste ne peut être qu’un individu désengagé·e, et un·e miliant·e politique un être amputé de toute distance critique et réflexivité.
Notes
1
Pinto 2004 : 38.
2
Le texte actualisé de ce travail paraîtra en avril 2021 aux Presses de Sciences Po sous le titre Militer chez les Verts.
3
C’est aussi le cas du “faire le terrain en féministe”. Il n’est pas question ici de théoriser la comparaison mais elle mérite d’être évoquée tant le rapport à l’objet, les délicatesses d’enquête et les critiques (pour ne pas dire les tentatives de délégitimation du travail) sont proches. Voir Isabelle Clair (2016).
4
On lira alors plus volontiers, parmi de multiples références, le désormais classique Jean-Noël Retière (2006) ou le tout récent Rose-Marie Lagrave (2021).
5
Pour un récit plus détaillé de mon parcours politique, voir « Politistes en campagne. Les savoirs académiques à l’épreuve de l’action » (Lévêque, Taiclet 2018 : 275-279).
6
Je l’entends à double titre : au sens de ne pas vivre entièrement – ou majoritairement – de la politique, et, cela va de pair, de ne pas maîtriser ou de ne pas être en situation de déployer l’ensemble des savoirs et savoir-faire qui caractérisent le métier politique.
7
Je remercie ici Frédérique Matonti qui a su, au fil des années, diriger mon travail avec autant de rigueur scientifique que de patience et de délicatesse.
8
Il faudrait, ce que je ne peux faire ici, consacrer quelques réflexions à ce type de dispositif. Impossible à recommander à d’autres et difficile à transmettre, pour des raisons évidentes, il questionne, entre autre, les modalités routinières d’évaluation de la scientificité du travail par les pairs. On ne peut en effet ici que croire sur parole le chercheur, et saluer, peut-être, la peine qu’il a prise de pousser jusque sur le divan l’analyse de son rapport à son objet de recherche.
9
Sauvées in extremis de la destruction, les archives avaient été livrées au Centre international de recherche sur l’écologie (CIRE) de l’Agrotech Grignon qui attendait quelque moyen de les prendre en charge. J’ai contribué à en faire le premier inventaire (18 palettes, 221 cartons). Depuis, elles ont été inventoriées et sont mises à disposition des chercheurs. D’autres archives sont aussi désormais consultables auprès de la Fondation de l’écologie politique.
10
Je me préparais par ailleurs à ouvrir de nouveaux terrains en milieu vert, auprès des militant·e·s de l’organisation de jeunesse Jeunes écologistes, et auprès de collaborateurs/trices du groupe d’élu·e·s à l’Assemblée nationale.
Bibliographie
Becker, Howard S. « Whose Side are We on ? », Social Problems, n° 4, 1967 : 239-247.
Bensa, Alban. « Remarques sur les politiques de l’intersubjectivité », in D. Fassin, A. Bensa (dir.), Les politiques de l’enquête, Paris, La Découverte, 2008 : 323-328.
Bizeul, Daniel. « Le récit des conditions d’enquête : exploiter l’information en connaissance de cause », Revue française de sociologie, vol. 39, n° 4, 1998 : 751-787.
Bourdieu, Pierre. « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 62-63, 1986 : 69-72.
Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes, Paris, Le Seuil, 1997.
Bourdieu, Pierre. Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001.
Bourdieu, Pierre. Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons d’agir, 2004.
Bourdieu, Pierre ; Wacquant, Loïc. Invitation à la sociologie réflexive, Paris, Le Seuil, 2014 [1992].
Broqua, Christophe. « L’ethnographie comme engagement : enquêter en milieu militant », Genèses, vol. 2, n° 75, 2009 : 109-124.
Bulmer, Martin. « When is disguise Justified ? Alternatives to covert participant observation », Qualitative Sociology, vol. 5, n° 4, 1982 : 251-264.
Chamboredon, Hélène ; Pavis, Fabienne ; Surdez, Muriel ; Willemez, Laurent. « S’imposer aux imposants. À propos de quelques obstacles rencontrés par des sociologues débutants dans la pratique et l'usage de l'entretien », Genèses, vol. 16, n° 16, 1994 : 114-132.
Clair Isabelle. « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, n° 213, 2016, p. 66-83.
Collovald, Annie. « Identités stratégiques », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 73, n° 73, 1988. : 29-40.
Fassin, Didier. « L’inquiétude ethnographique », in D. Fassin, A. Bensa (dir.), Les politiques de l’enquête, Paris, La Découverte, 2008. : 7-15.
Fabre, Daniel. « L’ethnologue et ses sources », Terrain, n° 7, 1986 [en ligne].
Fainzang, Sylvie. « L’objet construit et la méthode choisie : l’indéfectible lien », Terrain, n° 23, 1994 [en ligne].
Favret-Saada, Jeanne. Désorceler, Paris, Édition de l’Olivier, 2009.
Fillieule, Olivier (dir.). Le désengagement militant, Paris, Belin, 2005.
Geertz, Clifford. « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », in D. Cefaï (dir.), L’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2003 : 208-233.
Gossiaux, Jean-François. « L’ethnologie au bout du compte », Terrain, n° 30, 1998 [en ligne].
Gonzalez, Philippe. « (D)écrire : catégorisation, prise de notes et écriture », in D. Cefaï (dir.), L’engagement ethnographique, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001 : 107-128.
Havard-Duclos, Bénédicte. « Les coûts subjectifs de l’enquête ethnographique », SociologieS, 2007 [en ligne].
Jérome, Vanessa. Militants de l’autrement. Sociologie de l’engagement et des carrières militantes chez Les Verts / EELV, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014.
Jérome, Vanessa. « Politistes en campagne. Les savoirs académiques à l’épreuve de l’action », in S. Lévêque, A-F. Taiclet (dir.), À la conquête des villes. Sociologie politique des élections municipales de 2014 en France, Presses du Septentrion, 2018 : 275-279.
Lagrave, Rose-Marie. Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe, Paris, Éditions de l’EHESS, 2021.
Lefebvre, Rémi. « Politiste et socialiste. Une politique d’enquête au PS », Revue internationale de politique comparée, vol. 17, n° 4, 2010 : 127-139.
Lévêque, Sandrine ; Taiclet, Anne-France. À la conquête des villes. Sociologie politique des élections municipales de 2018 en France, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2018.
Massicard, Élise. « Être pris dans le mouvement. Savoir et engagement sur le terrain. Partie 1. » et « Être pris dans le mouvement. Partie 2. », Cultures & conflits, Les risques du métier, 2002 [en ligne].
Matonti, Frédérique. « ‘Ne nous faites pas de cadeau’. Une enquête sur les intellectuels communistes », Genèses, vol. 25, n° 1, 1996 : 114-127.
Marakemi, Chowra. « Participer en observant. Étudier et assister les étrangers aux frontières », in D. Fassin, A. Bensa, (dir.), Les politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La Découverte, 2008 : 165-183.
Mauss, Marcel (1934). « Les techniques du corps », communication à la Société de Psychologie ; reproduit dans Journal de Psychologie, XXXII, avril 1936.
Navarre, Maud. 2015. « Une jeune femme en campagne. Participation observante des élections législatives de 2012 », Terrains & travaux, vol. 1, n° 26, 2015 : 223-238.
Noiriel, Gérard. « Journal de terrain, journal de recherche et auto-analyse. Entretien avec Florence Weber », Genèses, vol. 2, n° 2, 1990 : 138-147.
Ouattara, Fatoumata. « Une étrange familiarité. Les exigences de l’anthropologie ‘chez soi’ », Cahiers d’études africaines, EHESS, vol. 3, n° 175, 2004 : 635-658.
Paoletti, Marion. Cahiers de campagne. Une campagne contre Alain Juppé, Saint-Étienne, Le Bord de l’eau, 2002.
Pinto, Louis. « Volontés de savoir. Bourdieu, Derrida, Foucault », in L. Pinto, G. Sapiro, P. Champagne, Pierre Bourdieu, sociologue, Paris, Fayard, 2004 : 38.
Pinson, Gilles ; Sala Pala, Valérie. « Peut-on vraiment se passer de l’entretien en sociologie de l’action publique ? », Revue française de science politique, vol. 57, n° 5, 2007 : 555-597.
Retière, Jean-Noël. Ego-histoire de sociologue. Les bonheurs de l’éclectisme, mémoire pour l’Habilitation à diriger des recherches, Université de Nantes, 2006.
De la Soudière, Martin. « L’inconfort du terrain », Terrain, n° 11, 1988 [en ligne].
De Sardan, Jean-Pierre Olivier. « La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, Les terrains de l'enquête, 1995 [en ligne].
Schwartz, Olivier. « L’empirisme irréductible », postface à Nels Anderson, Le Hobo. Sociologie du sans-abri, Paris, Nathan, 1993 : 265-308.
Traïni, Christophe (dir). Émotions… Mobilisation !, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
Wacquant, Loïc. Corps et âme. Carnets ethnographiques d'un apprenti boxeur, Marseille et Montréal, Agone, 2002.
Wacquant, Loïc. « Pour une sociologie de chair et de sang », Terrains & travaux, vol. 1, n° 26, 2015 : 239-256.
Waquet, Françoise. L’Ordre matériel du savoir. Comment les savants travaillent XVIe-XXIe siècles, Paris, CNRS Éditions, 2015.
Weber, Florence. Le travail d’à-côté, étude d’ethnographie ouvrière, Paris, EHESS, 2009.












