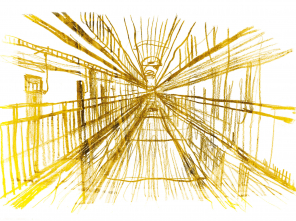Dans cet article, je souhaite examiner la question d’une éventuelle culture professionnelle des surveillants de prison en France à partir d’une enquête qui a duré vingt-cinq ans. Les suivis de très longue durée (autour d’un quart de siècle) d’un métier sont, à ma connaissance, inexistants dans la littérature mondiale. Les suivis les plus longs sont de l’ordre de trois ou quatre ans. Cependant, avant d’aller plus loin, il est nécessaire que je m’explique sur ce que j’entendais au début de cette enquête, concernant la notion de culture. Cela est nécessaire car, déjà en 1952, Alfred Kroeber et Clyde Kluckhohn écrivaient avoir rencontré plus de 150 définitions différentes de la notion de culture1 ! Comme on le verra, dès le début je me suis donc inspiré de la définition proposée par le sociologue québécois Guy Rocher, qui écrivait : « Nous pourrions définir la culture comme étant un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte2 ». Et bien sûr, c’est par les apprentissages plus ou moins longs et compliqués, par la socialisation professionnelle, qu’on finit par acquérir une culture. Il s’agit donc de suivre dans le temps un long et lent phénomène d’acculturation, difficile et souvent pénible.
Or, cette idée de culture des surveillants semble contradictoire et opposée à ce que décrit le dernier chapitre d’un ouvrage publié en 1994 dont j’étais l’un des cosignataires. En effet à la suite d’une très longue et très vaste enquête, partiellement en observation participante sous l’uniforme, a été publié Le Monde des surveillants de prison3. Dans cet ouvrage, le dernier chapitre s’intitule « La culture des surveillants : culture d’un mythe et double discours ». Le mythe dont il s’agit là est « celui qui véhicule la croyance en l’existence d’une culture surveillante anti-détenus, anti-réinsertion, disciplinaire et sécuritaire ». Plus précisément le dernier chapitre de notre ouvrage commun indiquait que la naissance d’une culture professionnelle des surveillants français était impossible. À la suite de notre très longue enquête longitudinale, je pense que nous nous sommes trompés et qu’une culture professionnelle des surveillants de prison existe bel et bien.
En 1993, avec Françoise Orlic (hélas décédée en 2010), je débutais donc la très longue recherche longitudinale sur la socialisation professionnelle des surveillants de l’administration pénitentiaire avec l’aide financière du Groupe d’intérêt public (GIP) « Droit et Justice ». Il s’agissait de suivre une promotion d’élèves-surveillants, la 130e, depuis son entrée à l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) jusqu’à la veille de son départ en retraite vingt-cinq ans plus tard car les surveillants, tout comme les policiers, ont un régime spécial de retraite très favorable. On notera que la durée exceptionnelle de cette étude était telle que, l’ayant démarrée, j’ai dû passer la main à un chercheur plus jeune en raison de mon départ à la retraite ! Cette recherche s’est donc terminée en 2018 sous la responsabilité de Fabrice Guilbaud. Je le remercie très vivement pour avoir magnifiquement terminé cette très longue et difficile recherche4.
En France, c’est mon ami Dominique Monjardet qui, le premier, a proposé de travailler sur la socialisation professionnelle et la culture dans les métiers de sécurité et il a entamé une longue recherche sur les policiers5. Avec Catherine Gorgeon, il a donc interrogé six fois une cohorte de 1167 élèves policiers depuis leur recrutement en 1992 jusqu’à 20026. Sa disparition en 2006 a malheureusement stoppé le suivi de cette cohorte et son exploitation, personne n’ayant repris ce magnifique travail. Notre recherche se situait directement dans les pas tracés par Dominique Monjardet : nous nous sommes inspirés de ses travaux, à la fois dans l’idée d’un suivi de très longue durée d’un même groupe de sujets et par l’utilisation de nombre de ses questions. Au passage on peut noter que la Commission informatique et libertés (CNIL) a eu parfois un drôle de comportement à notre égard : conformément à la loi, nous lui avions transmis notre questionnaire pour contrôle. La CNIL a refusé certaines des questions, notamment sur l’usage des armes à feu, qu’elle avait acceptées dans le cas de Monjardet (cela s’explique par un changement de rapporteur).
Précisons donc les objectifs de notre recherche tels qu’ils avaient été très longuement affichés au début de notre premier rapport de recherche par Françoise Orlic et moi (1997) :
L’objectif de cette recherche était l’étude de la socialisation professionnelle des surveillants de l’Administration pénitentiaire […]. Ici la socialisation sera conçue comme le processus par lequel les individus acquièrent la culture de la société, du ou des groupes auxquels ils vont appartenir. La culture est dans ce contexte habituellement entendue comme l’héritage social qui provient de ceux qui nous ont précédés, qu’il s’agisse de valeurs, de comportements ou de techniques. C’est essentiellement par la socialisation que nous apprenons les manières de penser et de se comporter qui sont considérées comme adéquates dans la société et dans les groupes auxquels nous appartenons. […] Ce processus est d’ailleurs ce qui permet aux individus de se forger une identité, […]. Ici il s’agissait d’étudier la socialisation professionnelle, c’est-à-dire le processus par lequel on devient membre d’un métier et plus généralement d’un groupe professionnel […]. Cette socialisation débute à l’École nationale d’administration pénitentiaire (ÉNAP). […] Le processus de socialisation professionnelle passe aussi par la découverte du métier dans son environnement institutionnel et sur le terrain. Ce sont alors les personnes vivant dans les établissements et les modalités de fonctionnement qui constitueront l’agence de socialisation. Pour le dire en d’autres termes le processus de socialisation professionnelle des surveillants est, comme c’est très souvent le cas, une combinaison de différents éléments, une sorte d’alchimie bien difficile à débroussailler. […]
Il est clair que se proposer d’étudier la socialisation professionnelle, c’est faire l’hypothèse que les individus entrant dans le métier y viennent avec une certaine variété d’opinions, de valeurs, de comportements et que l’ensemble du système pénitentiaire va peu à peu modifier et homogénéiser ces opinions, ces valeurs et ces comportements. Autrement dit on devrait observer dans les réponses à nos questions une relativement grande hétérogénéité au début de la carrière (qui débute avec le succès au concours de recrutement des surveillants) qui peu à peu évoluerait vers une certaine notamment de l’environnement de travail. C’est sur la base de cette uniformité qu’on devrait ensuite être capable de définir les grands traits de la culture du groupe professionnel des surveillants […]. On aura compris que notre objectif central était d’analyser comment on devient peu à peu, au fil du temps, un surveillant adoptant certains comportements et certaines valeurs. En fin de parcours on pourra se poser la question de ce qu’est vraiment la culture surveillant qui a fait l’objet de plusieurs controverses.
Il était donc très clair que notre objectif était l’étude de la culture professionnelle des surveillants de prison, dont on peut dire qu’elle est essentielle dans la mesure où elle finit notamment par prescrire quelles attitudes avoir, comment se comporter face aux autres (détenus, collègues, hiérarchie, etc.). La culture professionnelle est en fait ce qui permet véritablement l’adoption d’un métier.
La socialisation professionnelle n’est donc pas seulement ce qu’on apprend à l’école, c’est bien évidemment aussi le processus par lequel on apprend sur le terrain, des connaissances, des savoirs, des habiletés et savoir-faire, ce que Monjardet appelait les « outils du métier ». Cette sorte d’appropriation du métier est un long chemin où se rencontrent notamment les contradictions entre l’école et les diverses situations sur le terrain tout au long de la carrière. Ce dernier point, entre autres, montre l’intérêt majeur d’une longue étude longitudinale. Pour résumer l’hypothèse de base que nous avions, Françoise Orlic et moi, était qu’au début de leurs carrières, les réponses des surveillants à nos questionnaires devaient être d’une grande hétérogénéité pour évoluer peu à peu vers une très forte homogénéité, et que là était la base d’une culture professionnelle spécifique. Notre recherche était donc fondée sur un suivi longitudinal de très longue durée d’une cohorte de surveillants, une durée couvrant pratiquement toute une carrière. Dans la pratique elle repose donc sur une strate constituée, comme on l’a vu, par la cohorte de la 130e promotion.
Il faut relever que, bien avant nous, Robert Regoli et ses collègues ont, eux aussi, voulu suivre l’évolution des surveillants7. Ils ont remplacé le suivi dans le temps des mêmes individus par l’interrogation des surveillants par tranches d’ancienneté dans la même prison. Cette méthode est évidemment nettement plus rapide, et nettement plus économique. Cependant elle ne paraît pas adaptée car elle ne semble pas tenir réellement compte des évolutions réelles dans le temps.

La littérature américaine
On le sait, la littérature anglo-saxonne est depuis très longtemps particulièrement abondante sur les questions de la socialisation et de la culture des surveillants de prison, à la différence de la littérature française qui, de toutes les façons, a toujours été très pauvre en matière d’étude des surveillants. Dans l’un des premiers grands ouvrages sociologiques sur la prison, Donald Clemmer aux États-Unis, plutôt que d’utiliser le mot assimilation a forgé le concept de prisonization pour décrire le processus par lequel les détenus sont transformés dans et par la prison en prenant à des degrés plus ou moins importants les traditions, les coutumes et la culture de la pénitentiaire8. Une large part de la littérature sociologique sur les prisons aux États-Unis insistait donc depuis fort longtemps sur l’existence d’une culture du groupe surveillant9 et sur son importance dans l’explication de la défiance entretenue entre ces groupes antagoniques que sont les surveillants et les détenus. D’autre part les manifestations d’une culture des prisonniers, avec leur propre code ont fait l’objet de nombreuses analyses, ici aussi depuis fort longtemps, qu’il s’agisse de formes spécifiques d’argot ou d’un code des détenus10.
Les différents travaux successifs aux États-Unis ont donc montré depuis longtemps que les surveillants possèdent eux aussi une culture professionnelle propre au sein des prisons. C’est notamment le cas de Lucien Lombardo11. C’est aussi surtout le cas de Kelsey Kauffman, elle-même ancienne surveillante, qui dans un très remarquable ouvrage sur les surveillants de prison aux États-Unis écrivait que les surveillants possèdent eux aussi une sous-culture distincte au sein des prisons avec leurs propres croyances, leur code de conduite, différents de ceux des administrateurs, des travailleurs sociaux et bien sûr des détenus12. Dans ce qu’elle appelle le Code des surveillants, elle décrit cette culture en 9 points :
- Toujours porter secours à un surveillant en détresse.
- Ne pas apporter de drogue.
- Ne pas « balancer » car cela détruit la solidarité.
- En face des détenus, ne jamais discréditer un collègue surveillant.
- Toujours soutenir un surveillant lors d’une dispute avec un détenu.
- Toujours soutenir les sanctions d’un surveillant contre les détenus.
- Ne pas être proche des détenus en ayant des attitudes positives face aux détenus et négatives face aux surveillants.
- Maintenir la solidarité entre surveillants face à tous les autres groupes.
- Montrer une préoccupation positive pour les collègues surveillants.
Nous avons là essentiellement l’expression, d’une part de la très forte solidarité entre surveillants, d’autre part de la défiance envers les détenus et envers tous les autres groupes. Tous les écrits américains suivants sur les surveillants vont dans le même sens. Ainsi en 2001 John Jones et Daniel Carlson notamment reprennent cette idée de culture professionnelle des surveillants en des termes très proches13.
Cette question de la culture professionnelle des surveillants continue à intéresser les sociologues américains. C’est le cas par exemple de Heather Schoenfeld et Grant Everly dans un article tout récent où elle et il parlent de l’état d’esprit des surveillants qui renvoie à la culture « traditionnelle » des surveillants, incluant un haut niveau de méfiance par rapport aux détenus, l’évitement des relations, l’écart par rapport aux objectifs de réinsertion14.
La littérature britannique
Depuis assez longtemps cette question de la culture des surveillants de prison a très souvent été reprise dans la littérature britannique. De très nombreux chercheurs britanniques ont donc dépeint une culture des surveillants en s’inspirant d’une part des travaux classiques menés aux États-Unis, dont nous venons de parler, d’autre part de l’importante littérature anglo-saxonne produite sur la culture des policiers. Cette importante recherche britannique sur les surveillants de prison livrait des résultats remarquablement intéressants sur la socialisation des surveillants et sur leur culture. Les sociologues britanniques indiquent tous que c’est un très fort sentiment d’isolement qui est le plus souvent indiqué par les surveillants, à la fois par rapport à leurs dirigeants et par rapport à la société en général15. À partir de ces très nombreux travaux effectués au Royaume-Uni et malgré certaines variations entre les différents auteurs, on observe généralement un noyau central commun à propos de la culture des surveillants de prison composé des trois grands traits caractéristiques majeurs suivants :
- une attente de loyauté et solidarité entre les membres ;
- une méfiance et une hostilité envers les autres groupes ;
- un sentiment d’isolement social et de coupure vis-à-vis de la hiérarchie et de la société en général.
On trouve donc des points communs entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, puisque la solidarité du groupe est déjà très clairement soulignée par de nombreux auteurs américains, par exemple Lombardo puis Kauffman, déjà cités, et reprise par tous les auteurs britanniques. Cette solidarité professionnelle renvoie à la cohésion nécessaire du groupe professionnel vis-à-vis des autres groupes en prison et vis-à-vis de l’extérieur. Un des traits caractéristiques de cette culture des surveillants, vue par les auteurs anglo-américains, est donc une attitude particulièrement négative de méfiance, de défiance et de confrontation envers tous les autres groupes au sein des prisons et bien sûr en premier lieu les détenus.
Notre étude de suivi de la 130e promotion d’élèves-surveillants
Dans la suite de notre texte, nous verrons si les réponses des membres de notre 130e promotion de surveillants, qui ont fait donc l’objet de ce très long travail sur vingt-cinq ans, correspondent aux trois thèmes anglo-américains que nous venons d’évoquer. Il s’agit donc de savoir si il existe une culture des surveillants de prison français proche de celle décrite par les Anglo-Américains. Nous avons donc utilisé un long questionnaire tout au long de la recherche avec un noyau d’environ une cinquantaine de questions identiques pour les six prises d’information. Les quatre premiers questionnaires comportaient une centaine de questions. Ils étaient soumis en face-à-face, soit durant les séjours à l’ENAP, soit dans de très grandes prisons où les surveillants étaient massivement affectés au début de leur carrière. Les suivants ayant été transmis par voie postale, il a été décidé de le raccourcir afin d’augmenter le taux de retour. L’effectif de la promotion à l’entrée à l’ENAP était de 455 personnes, mais en moins de 3 ans cet effectif était descendu à 422. Cette chute est banale et relativement fréquente dans bien des promotions lors des débuts de carrière. C’est ainsi que par exemple, Laurent Gras et Nicolas Boutin ont montré que le taux moyen de démission de la 167e à la 178e promotion d’élèves surveillants était de 4,6 % durant la formation et de 1,5 % durant l’année de titularisation, soit plus de 6 %, ce qui est relativement important16. Notre promotion, à l’inverse des promotions suivantes, était massivement de sexe masculin : il n’y avait que 5 % de femmes et donc la variable sexe n’a pratiquement jamais pu être utilisée. Il faut noter par ailleurs, que contrairement aux policiers étudiés par Monjardet qui entrent dans la police très jeunes avec une véritable vocation, nos surveillants déclarent toujours n’avoir pas eu de vocation et ils sont entrés dans l’Administration pénitentiaire assez tardivement.
Finalement, lors de la dernière prise d’information, 214 surveillants ont répondu, c’est-à-dire pratiquement la moitié de 422, effectif réel de la promotion trois ans après son entrée à l’école. Ce nombre de réponses a été vérifié d’un point de vue statique, il est tout à fait satisfaisant. Parmi les raisons d’attrition il y avait les déjà retraités, les décès, les malades, les démissionnaires, les révoqués, etc. et ceux pour lesquels, aussi incroyable que cela puisse paraître, l’administration pénitentiaire était incapable de fournir les bonnes adresses !
La 130e promotion de surveillants a donc, comme on l’a vu, été interrogée six fois par voie de questionnaire sur une période de vingt-cinq ans alors que dans la littérature anglo-américaine, quand il y a suivi d’un groupe de surveillants, cela ne dépasse jamais quatre ans. Trois rapports remis à la Mission Recherche Droit et Justice qui a financé toute cette très longue recherche ont rendu compte des différentes étapes du suivi des surveillants de la 130e promotion.
- Le premier rapport, publié en 1993, rendait compte des quatre premiers questionnaires : entrée à l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), sortie de l’ENAP, titularisation après un an de stage et un an plus tard.
- Le second rapport, publié en 2008, rendait compte du questionnaire soumis approximativement en milieu de carrière, 15 ans après l’entrée à l’ENAP.
- Le dernier rapport, publié en 2018, rendait compte de la fin de carrière de la promotion.
Les deux premières interrogations ont eu lieu dans les amphithéâtres de l’ENAP dans lesquels l’ensemble des élèves-surveillants étaient présents. Les interrogations 3 et 4 ont eu lieu en face-à-face dans de grosses prisons urbaines où l’énorme majorité des nouveaux surveillants avaient été affectés. Les deux derniers questionnaires ont été remplis par voie postale, vu la très grande dispersion des surveillants. En effet, nos surveillants n’étant que 13 % à être originaires de grandes villes, ils se sont retrouvés dans des prisons moyennes ou petites, ayant obtenu des mutations successives pour se rapprocher de leurs régions d’origine. Les surveillants étaient alors très dispersés et les rencontrer en face-à-face était devenu impossible en termes financiers et en termes de temps. Pour augmenter le taux de retour, les questionnaires ont alors été raccourcis.
L’utilisation d’une méthode d’enquête longitudinale, c’est-à-dire le suivi d’une cohorte sur une très longue période, avait donc pour but de tenter un suivi de la socialisation des surveillants et de la constitution d’une culture spécifique. D’une certaine manière, il s’agit de suivre le plus clairement possible l’appropriation progressive du métier de surveillant. Au passage, il est très important de noter que dans la littérature sociologique, il est extrêmement rare qu’on tienne compte de l’effet du moment d’interrogation des individus à l’intérieur d’un cycle de vie sur les réponses recueillies. Bien souvent, à propos des réponses obtenues à des questionnaires, on fait comme si les réponses étaient valables une fois pour toutes. Or on sait très bien que lorsqu’on interroge un individu à un moment donné, on ignore totalement si à un autre moment il n’aurait pas répondu différemment. Tout ceci fait qu’il y a là un risque de faute méthodologique très grave et malheureusement extrêmement banale, alors que grâce au suivi d’une cohorte on sait à chaque reprise à quel moment de la vie d’un individu on se trouve.
Les processus de socialisation sont de réels processus de transformation. Everett Hughes allait jusqu’à dire que cette socialisation est une sorte de conversion au cours de laquelle le profane devient initié17. Dans notre recherche, il s’agissait donc de comprendre comment, tout au long de leur carrière, les svailurveillants sont transformés par la socialisation professionnelle, c’est-à-dire le processus par lequel on devient membre du groupe professionnel des surveillants de prison et comment l’appartenance à ce groupe évolue dans le temps. Cette socialisation débute par la formation à l’ÉNAP. Cependant, il est clair que devenir surveillant ne passe pas uniquement par ce qui est enseigné au cours de la formation. Bien évidemment le processus de socialisation professionnelle s’opère aussi et surtout, par la découverte du métier sur le terrain et ce sont alors les groupes travaillant ou vivant dans les prisons (principalement les surveillants, les gradés, les détenus mais aussi les personnels socio-éducatifs et même parfois les aumôniers) ainsi que les modalités d’organisation de ces prisons qui constituent les différentes instances de socialisation.
Quelle culture commune ?
Nous l’avons vu plus haut, dans une partie très importante de la littérature, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le processus de socialisation des surveillants de prison se caractérise notamment par l’acquisition d’une culture spécifique. D’une certaine manière, devenir surveillant correspondrait donc à l’intégration d’une culture propre au groupe surveillant, ses normes, ses idées, ses valeurs, ses comportements. Je rappelle qu’une des hypothèses initiales de notre recherche que nous avions formulée alors Françoise Orlic et moi, était que le processus culturel allait se manifester, notamment à partir d’une forte homogénéisation au cours du temps des réponses des membres de la 130e promotion. Cette hypothèse d’homogénéisation est très nettement vérifiée à la fin de l’enquête. En effet, après vingt-cinq ans de carrière, pour 82 % des questions concernant le métier de surveillant et sa pratique quotidienne, on obtient des réponses égales ou supérieures à 55 % et ce pourcentage est encore de presque la moitié pour les réponses où le taux de réponses est égal ou supérieur à 60 %. Nous considérerons donc la culture professionnelle des surveillants à partir de ce que ces derniers partagent le plus. L’hypothèse de construction d’une culture professionnelle semblait se vérifier et, bien évidemment, on constatait que les variables sociodémographiques de la population (telles que l’âge ou le niveau de diplôme) avaient tendance à s’affaiblir dans le temps, étant donné justement le phénomène d’homogénéisation. Cette dernière s’est poursuivie à un degré très élevé et elle est très probablement une des preuves de l’existence de la culture du groupe. En suivant les trois traits majeurs observés dans la littérature anglo-américaine relevés plus haut, nous allons tenter de vérifier notre hypothèse initiale.
Désabusement, isolement
De nos jours le métier de surveillants est si peu attractif, comparé à la police nationale ou à l’armée, qu’une prime de 8 000 euros est accordée à ceux qui s’engagent en Île-de-France pour 6 ans, dont les deux tiers sont versés dès la prise de service ! Dans leurs réponses, nos surveillants apparaissent très nettement désabusés sur leur métier. D’ailleurs, pratiquement partout dans le monde, le personnel pénitentiaire se perçoit comme un groupe professionnel bien peu apprécié.
À la différence de ce qui se passe dans la police nationale, les raisons d’entrer dans l’administration pénitentiaire ne sont pratiquement jamais des raisons qu’on pourrait appeler professionnelles (contribuer au maintien de l’ordre ou être utile par exemple). À l’entrée à l’ENAP, les réponses étaient très fortement utilitaristes (par exemple la sécurité d’emploi), ce qui se retrouve dans un très grand nombre de pays. Les surveillants sont insatisfaits, bien que leur situation matérielle soit bien meilleure que celle de la majorité des gens de leur génération de même milieu social et de même niveau scolaire, et bien que cette situation matérielle au sein de l’administration pénitentiaire se soit très nettement améliorée avec le temps. Cette insatisfaction peut même prendre parfois des formes tragiques puisqu’une étude de l’unité Inserm U897 de Bordeaux, publiée en 2011, et une autre de l’Institut de veille sanitaire publiée en 2015, montrent que les surveillants ont tendance à se suicider plus fréquemment que la population générale et même plus fréquemment que la police. Toujours à propos de l’entrée dans l’administration pénitentiaire, un nombre considérable de surveillants déclarent qu’on n’entre pas dans l’administration pénitentiaire par vocation (80 %), ce qui très différent des élèves policiers qui, dans l’enquête de Dominique Monjardet, pour 65 % d’entre eux, ont pensé très tôt à entrer dans la police nationale au collège, au lycée et parfois même dès leur enfance. Comme disait un surveillant : « dans les cours de récréation de l’enfance on joue aux gendarmes et aux voleurs, jamais aux surveillants et aux détenus ! » D’ailleurs, les surveillants ne conseillent pas à leurs amis ou à leurs proches d’entrer dans l’administration pénitentiaire (71 %) et s’ils avaient eu le choix, ils auraient choisi un autre emploi (69 %). En outre, ils n’auraient pas été heureux que leur enfant fasse la même activité qu’eux (82 %). Ceci me rappelle que, lors de mon expérience des années 1990 où je faisais un stage comme élève-surveillant sous l’uniforme à la prison de la Santé à Paris, j’avais assisté à un pot de départ en retraite d’un brigadier. Ce dernier avait déclaré lors de son discours de remerciement et d’adieu : « Je n’ai jamais aimé ce métier ! » Tant et si bien qu’à la fin de la vie professionnelle, les surveillants déclarent de plus en plus ne pas faire un métier comme les autres (78 %), ce qui ne veut pas dire qu’on refuse de se reconnaître publiquement comme surveillant ou au moins comme fonctionnaire de l’administration pénitentiaire. Tous ces éléments renvoient au sentiment d’isolement social dépeint dans la littérature sur la culture professionnelle des surveillants : on a conscience de faire un métier déprécié, pas comme les autres (78 %), qui n’apporte pas beaucoup de satisfaction dans la vie. Il faut ajouter qu’une fois sortis de la prison, les surveillants n’ont pas d’amis proches parmi les surveillants, ce qui après 25 ans de service apparaît très surprenant. Seuls 17 % d’entre eux ont ce type d’amis. Les deux tiers de nos surveillants ne participent pas aux amicales ou aux clubs locaux de surveillants. C’est aussi un métier dont on parle rarement ou très rarement à son entourage (73 %), Tout se passe comme si les surveillants voulaient ainsi protéger leurs familles. Il existe cependant un des groupes vivant en prison, les personnels socio-éducatifs, avec qui 65 % des surveillants déclarent avoir des relations fréquentes.

Les détenus comme groupe adverse
Par construction, les surveillants et les détenus se retrouvent dans un monde clivé et dans un rapport d’opposition très clair. Le Monde des surveillants de prison, cité au début de ce texte, indiquait que « la prison est traversée par le conflit central très dur, structurel et irréductible entre ceux qui ne rêvent que de sortir et ceux qui sont payés pour les en empêcher ». La prison est une institution totale pour reprendre l’expression de Erving Goffman, particulièrement formalisée, notamment par la loi. Goffman précise : « Une institution totale peut être définie comme un lieu de vie et de travail où un grand nombre d’individus dans la même situation, coupés de l’ensemble de la société pour une durée non négligeable, évoluent tous ensemble dans un milieu fermé et administré de façon formelle. » La prison est tout entière structurée autour de ce conflit, autour d’un rapport de force. Il est rare de rencontrer une organisation où ce rapport de force est aussi permanent et aussi évident. Ceci se manifeste ici ouvertement par des grilles, des serrures, des miradors, des barbelés concertina, des appareils électroniques sophistiqués et des armes à feu. Ce rapport de force est tel que la notion d’objectifs communs ou partagés est plus difficile à concevoir qu’ailleurs En réalité cette notion est pratiquement impossible en prison. Comme le notait Gresham Sykes dans The Society of Captives, il y a un fossé, un gouffre entre gardiens et détenus. Or il n’en reste pas moins que l’informel et la négociation, le non-écrit existe bel et bien dans les prisons18.
Pour 80 % des surveillants la prison est faite pour protéger la société ou pour avoir un effet de dissuasion, elle n’est pas faite pour les délinquants à punir ou à réinsérer. Ceci est rigoureusement le contraire de la réforme Amor des années 1945, dont l’article 1er déclarait que la peine privative de liberté était une mesure ayant pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné. Cette doctrine a été très rapidement abandonnée et aujourd’hui, on doit noter que les règles en prison sont d’abord orientées vers la garde des détenus et le maintien de l’ordre, et relativement peu vers la réinsertion qui est pourtant la seconde fonction officielle de la prison. C’est dans ce cadre qu’Antoinette Chauvenet indique très justement que « c’est le détenu qui crée l’événement, qui en a l’initiative » et le surveillant, qui est supposé être le maître du jeu, se trouve dans la pratique en position de réaction19. Aussi, cela produit chez les surveillants une inquiétude, voire une véritable crainte sur ce que les détenus peuvent initier. Presque tous nos surveillants considèrent que la prison est un lieu dangereux (88 %) et on voit bien là la crainte, voire la peur non avouée, des détenus qui sont alors clairement l’adversaire. Comme l’écrivaient en 1833 Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont évoquant Sing Sing dans Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France :
La sûreté des gardiens est incessamment menacée. En présence de pareils dangers, si habilement mais si difficilement évités, il nous est impossible de ne pas redouter quelque catastrophe dans l’avenir20.
La prison est un lieu où, après vingt-cinq ans de service, les règles sont difficiles à appliquer (68 %) et dans lequel pourtant les surveillants jugent avoir suffisamment d’autonomie professionnelle (77 %). Pour des raisons de sécurité, face aux détenus les règles sont impératives car on ne sait jamais ce qui peut arriver et, par exemple, pour 62 % des surveillants, en cas de problème avec un détenu, il faut appliquer la règle plutôt que d’agir en tête-à-tête. Cela n’empêche pas que, pour assurer la sécurité, il est souhaitable de connaître les délits des détenus tout en limitant les contacts avec eux. Le règlement intérieur de la prison est considéré comme une aide dans le travail par 82 % des surveillants (pour les autres 18 % de surveillants le règlement est une gêne ou ne sert à rien). De façon très étonnante, près d’un cinquième des surveillants répondent que ce règlement intérieur « existe, on me l’a dit, mais je ne l’ai pas vu » ou « n’existe pas », alors même que la notion de règlement intérieur est inscrite dans le Code de procédure pénale. Que le règlement intérieur soit massivement perçu comme une aide s’explique par le fait que généralement dans une organisation (par opposition à une institution, ici la Justice si on suit Philip Selznick21) les règles sont en fait un mode d’organisation. Cependant l’application des textes reste jugée difficile pour encore sept surveillants sur dix en 2018, ce qui semble significatif et assez surprenant chez des surveillants tous anciens après 25 ans de carrière. On constate que 73 % des surveillants sont favorables à un code de déontologie de l’administration pénitentiaire (qui a été créé, en cours d’enquête, par un décret de décembre 2010). Ces réponses massivement positives sont particulièrement intéressantes car elles contredisent ce qu‘énonçaient les plus grands syndicats de surveillants au début des années 2000. Ainsi en avril 2003, en réponse à un sénateur, Dominique Perben, alors ministre de la Justice, déclarait :
Alors que ce projet de code avait été présenté au Conseil supérieur de l’administration pénitentiaire et à la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ces syndicats considéraient ce code comme inutile puisque des dispositions d’ordre déontologique existaient notamment dans le Code de procédure pénale et stigmatisant car faisant peser sur les surveillants le soupçon d’être peu soucieux des principes qu’il réaffirme.
À titre de comparaison, il faut savoir que l’American Correctional Association a adopté un code d’éthique dès 1994.
Toujours sur le sujet de la sécurité et de la méfiance envers les détenus, une question portait sur les fouilles à corps qui sont des fouilles intégrales avec parfois une mise à nu allant jusqu’à l’adoption de positions embarrassantes, dégradantes et humiliantes pour rendre visible l’entre jambe et rendre possible une inspection visuelle anale. Les répondants devaient choisir l’un des items suivants :
- Les fouilles à corps doivent être limitées car elles sont contraires à la dignité et à l’objectif de réinsertion.
- Les fouilles à corps ne doivent pas être limitées car elles sont indispensables à la sécurité.
Alors même qu’il était question de dignité et de réinsertion, une très large majorité (95 %), pratiquement presque tous nos surveillants, juge que les fouilles à corps ne doivent pas être limitées parce qu’elles sont indispensables à la sécurité, toujours l’obsession de la sécurité face aux détenus. Ils défendent cette position alors même que la loi pénitentiaire de 2009 modifiée en 2019 dans son article 57 détaille assez longuement les précautions à prendre à ce sujet. Il est notamment précisé dans cet article : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. » Il faut ici savoir que les deux principaux syndicats pénitentiaires, FO et Unsa (qui regroupent en général autour de 70 % des suffrages lors des élections professionnelles) ont toujours soutenu l’usage de ces fouilles très spéciales dont le docteur Lazarus, ancien médecin des prisons, expliquait qu’elles étaient comme un pouvoir que les surveillants avaient sur le corps des détenus. De fait dans la pratique quotidienne actuelle les choses semblent ressembler souvent aux pratiques anciennes. Ce chiffre de 95 % est le plus fort de ceux obtenus sur l’ensemble des questions ! De plus dans leurs relations avec les détenus les surveillants, pour 60 % d’entre eux, pensent qu’ils doivent plutôt limiter les contacts et 62 % d’entre eux estiment que dans ces relations il vaut mieux appliquer le règlement plutôt que de fonctionner au donnant-donnant.
On ne peut être plus clair : il y a là un sentiment particulièrement net de crainte et d’opposition face aux détenus. Alors même que les surveillants ont une certaine marge d’autonomie on pourrait imaginer qu’ils soient moins rigoureux en matière de règles de sécurité. Certes cela arrive parfois, mais la sécurité occupe une place énorme dans les préoccupations des surveillants, ce qui indique bien que les détenus sont l’adversaire. La sécurité semble être une sorte d’obsession. Tout cela indique encore une fois très clairement que les détenus sont l’adversaire face à qui il faut faire preuve de solidarité entre surveillants. Or cet adversaire est perçu aussi comme privilégié puisque les surveillants sont très largement d’accord avec l’idée selon laquelle on en fait trop pour les détenus et pas assez pour les surveillants (79 %).
Cela étant, que les détenus soient clairement perçus comme un groupe adverse que l’on craint, dont on peut parfois avoir peur, n’empêche pas que dans la vie courante, dans la vie pratique, il y a différentes sortes d’échange entre surveillants et détenus. Comme le disent fréquemment les surveillants, le travail de surveillant est relationnel. Aussi la plupart des surveillants de prison n’aiment-ils pas être appelés « gardien de prison ». Pour exprimer le caractère relationnel de leur travail ils disent par exemple souvent « on garde les animaux, on surveille les hommes ». Ceci peut paraître superficiel et faire sourire mais en réalité ce qu’ils disent par là c’est qu’on ne peut réduire leur travail sur l’autre à une simple garde alors que cet autre possède une véritable capacité à agir, des stratégies et des tactiques. On retrouve aussi ce refus de se faire appeler gardien par exemple chez Kelsey Kauffman.
La logique de la prison est d’une part une logique bureaucratique de règles et d’autre part une logique du maintien de l’ordre ou plutôt du non-désordre. La logique bureaucratique fait que la prison est un monde saturé de règles (du Code de procédure pénale jusqu’aux cahiers de consignes en passant par les circulaires ministérielles, le règlement intérieur et les notes de service). Autant dire que personne ne connaît l’ensemble des règles officielles et cela peut aboutir à un point tel que le résultat est contraire de celui recherché ! C’est ainsi qu’il m’est arrivé de voir une note de service affichée dans un bureau de gradés avec une mention manuscrite au crayon « cette note doit être appliquée » ! En réalité, dans le quotidien, les surveillants jouent avec les règles. Tant et si bien que, par exemple, les surveillants de la 130e promotion mettent relativement peu de rapports d’incidents, (c’est-à-dire des rapports d’infraction à la règle) contre les détenus (entre 0 et 5 par an). Il faut dire que rédiger un rapport d’incident à propos d’un détenu ne signifie pas qu’une sanction sera automatiquement prise contre ce détenu. De plus, demander très souvent des sanctions par le moyen des rapports d’incident c’est s’exposer au risque d’apparaître comme un surveillant qui n’a pas « d’ascendant sur la population pénale » comme le dit une des rubriques de la grille de notation des surveillants. Par ailleurs il existe des échanges permanents qui relèvent du service rendu mutuellement, par exemple, pour un détenu, de prévenir un surveillant de l’arrivée d’un gradé ou, pour un surveillant, d’apporter très rapidement à un détenu l’adresse d’un centre de Sécurité sociale, adresse qui aurait mis un certain temps à arriver au détenu si ce dernier avait demandé cette adresse à un éducateur, comme il aurait dû le faire normalement. Selon pratiquement tous les surveillants (93 %) on peut laisser passer un paquet de cigarettes d’une cellule à une autre pour obtenir le calme, alors même qu’il est strictement interdit de laisser passer quoi que ce soit d’une cellule à une autre, c’est une véritable désobéissance. Certes il ne s’agissait ici que de cigarettes mais Erving Goffman expliquait dans son célèbre livre Asiles que l’échange de cigarettes pouvait être perçu comme un geste de camaraderie, de convivialité22. Bien sûr, il ne s’agit ici pas de fumer avec des détenus mais on peut pourtant se demander si dans l’acceptation du passage de cigarettes d’une cellule à une autre en dépit de l’interdiction, il n’entre pas une part de camaraderie si redoutée par la hiérarchie. Sykes allait jusqu’à dire que souvent l’ordre est consolidé par une sorte de « corruption » tandis que Richard Sparks et ses collègues parlaient « d’arrangements23 ». À un niveau supérieur, si l’on peut dire, il existe aussi parfois des échanges en termes de don et contre-don comme j’ai tenté de le décrire en 1997. Tout ceci tend à montrer que le travail des surveillants est d’une part un travail technique et d’autre part un travail relationnel, si on s’appuie sur cette distinction que proposait en 1939 Maurice Halbwachs à propos des employés24.
La coupure avec la hiérarchie et l’administration pénitentiaire
Dans le même temps, 78 % de nos surveillants attendent un soutien sur le terrain de la part de la hiérarchie plutôt qu’un dialogue. Cette attente devient de plus en plus forte avec le temps, alors qu’ils disent qu’ils voient bien peu leurs supérieurs qui s’occupent très peu d’eux. Nos surveillants ne sont que 39 % à considérer que la hiérarchie intervient comme il faut. Il faut ajouter que s’ils ont un problème, seuls 11 % d’entre eux font appel à la hiérarchie. On a là une véritable coupure avec la hiérarchie et on retrouve un élément classique de la littérature mondiale sur les surveillants. L’appréciation portée sur l’administration pénitentiaire montre là aussi une véritable rupture : alors qu’en septembre 1993, à la sortie de l’ENAP, 16 % des surveillants seulement déclaraient que l’image qu’ils se faisaient de l’administration pénitentiaire avait évolué négativement en 2018 ce chiffre a grimpé à 61 % et ils ne sont plus que 17 % à dire que l’idée qu’ils se font de l’administration pénitentiaire a évolué de façon positive. Si on demande aux surveillants quelle est leur principale mission selon l’administration pénitentiaire et selon eux-mêmes, on constate de sérieux décalages : aux yeux des surveillants l’administration pénitentiaire place « le maintien du calme » en tête de leur principale fonction, avec 56 % des répondants de notre promotion tandis que « faire respecter la discipline » n’est pensé que par 5,5 % nos surveillants. Ceci alors qu’aux yeux d’un tiers des surveillants « maintenir le calme » ou « faire respecter la discipline » sont cités même niveau. Le tableau suivant reflète l’ensemble des réponses sur ces sujets.
| Mission principale des surveillants | D’après l’AP aux yeux des surveillants | D’après les surveillants à leurs propres yeux |
|
Maintenir le calme |
56 % | 33 % |
| Faire respecter la discipline | 5,5 % | 34 % |
| Les détenus (réinsertion, etc.) | 29 % | 18 % |
| Empêcher les évasions | 9,5 % | 15 % |
On voit bien que, selon plus de la moitié des surveillants, l’administration pénitentiaire est préoccupée d’abord par le calme selon l’idée fréquente parmi les cadres de l’administration pénitentiaire qu’une bonne prison est une prison dont on ne parle pas, d’où l’importance du calme. D’ailleurs le plus souvent on estime que l’ordre en prison, c’est l’absence de désordre et cela ne passe pas forcément par la discipline. Dans le même temps les surveillants pensent que faire respecter la discipline n’est pas une préoccupation majeure de l’administration pénitentiaire, c’est le moins qu’on puisse dire ! On peut interpréter ces deux réponses comme complémentaires. On a là clairement un nouveau signe de coupure avec leur hiérarchie, leurs cadres dirigeants.
On doit ajouter ici le très remarquable taux de syndicalisation parmi nos surveillants : 60 % ! Ce taux est absolument extraordinaire car il faut savoir que le taux de syndicalisation dans la fonction publique en France est généralement estimé autour de 20 %. C’est là tout à la fois un signe de forte solidarité et encore une fois un signe de très forte rupture avec l’administration pénitentiaire et même plus généralement avec le gouvernement. Il faut noter que depuis les années 1950 on observe à ce sujet un nombre particulièrement étonnant de mouvements sociaux des surveillants soit au niveau local, soit au niveau national, depuis le blocage des entrées des établissements jusqu’à, exceptionnellement, la grève qui leur est pourtant formellement interdite par la loi comme pour les membres de la Police Nationale. On assiste alors parfois à des charges de policiers contre les surveillants ! Parfois même la police et la gendarmerie ont dû remplacer les surveillants ici ou là pour tenir les miradors ou simplement distribuer les repas. Du point de vue de cette rupture avec l’administration pénitentiaire, nous n’avons malheureusement pas pensé à inclure dans notre questionnaire des questions concernant ces très nombreux mouvements sociaux, parfois très violents.
La solidarité entre surveillants
Bien que travaillant dans une organisation collective fortement structurée et contraignante, les surveillants travaillent très souvent seuls à leur étage qui peut parfois héberger jusqu’à plus de 100 détenus. Ils sont relativement isolés dans ces cas-là. Pourtant les relations avec les collègues semblent très importantes dès le départ dans la mesure où, pour trois surveillants sur quatre, ce qui est le plus important dans le métier, c’est de pouvoir compter sur les collègues ou de travailler dans une bonne ambiance professionnelle. D’ailleurs au sein de l’article D 219 du Code de procédure pénale on peut lire : « Les personnels de surveillance sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent ». Il en va de même pour le Code de déontologie de l’administration pénitentiaire promulgué en décembre 2010 qui, dans son article 11, précise : « Les personnels de l’administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l’exercice de leurs missions ». Il faut ajouter que tous les surveillants possèdent un sifflet pour faire appel aux collègues en cas de danger. Il y a là une véritable solidarité. Si un collègue s’y prend mal avec un détenu, 75 % des surveillants préfèrent le lui dire en tête-à-tête. Parler dans ce cas en tête-à-tête et non en public montre encore une fois cette véritable solidarité. Les relations entre collègues sont donc très importantes. Pendant le service à 60 % les surveillants pensent pouvoir faire confiance aux autres surveillants et aux syndicats. Cependant les jugements portés sur le métier et son groupe professionnel ne sont pas dénués de critiques puisque 70 % des surveillants estiment que leurs collègues manquent de motivation dans leur travail (« manque de zèle pour assurer une tâche ») et 72 % considèrent que la formation des surveillants « laisse à désirer » (opinion en très forte progression entre le début et la fin de carrière), ce qui peut aussi s’interpréter très probablement comme un jugement négatif porté sur la pratique du métier des plus jeunes surveillants. Avec cet ensemble des relations avec les collègues, au regard des éléments caractéristiques de la culture professionnelle mises au jour dans la littérature anglo-américaine, on peut considérer l’attention forte portée à la bonne ambiance dans le travail, à l’importance de faire confiance à ses collègues ainsi que l’attitude consistant à parler directement et discrètement à un collègue qui s’y prendrait mal avec un détenu, comme des éléments d’une évidente forte solidarité professionnelle.
Conclusion
Dans notre très longue et très lourde recherche, certains thèmes sont manquants. Par exemple, nous n’avons posé aucune question sur les conflits sociaux engagés par les surveillants alors même que ces conflits sont extraordinairement fréquents face à l’administration pénitentiaire et face au ministère de la Justice lui-même dont les surveillants représentent, et de très loin, la majorité de l’ensemble des effectifs. Dans la même direction, une seule question a été posée quant à l’adhésion à un syndicat alors même que les syndicats pénitentiaires sont nombreux et toujours dans une compétition d’une rare violence. On aurait pu notamment se poser la question du sens à donner à ces adhésions. D’autre part nous n’avons inclus aucune question précise sur les relations avec les directeurs d’établissement.
Cela étant, notre hypothèse centrale d’homogénéisation des réponses de nos surveillants avec le temps, que j’avais formulée avec Françoise Orlic au tout début de notre recherche en 1993, s’est révélée tout à fait exacte avec le temps. La question qui se posait était alors de savoir si cette homogénéisation correspondait à une véritable culture professionnelle. En s’appuyant sur la très importante littérature sur les surveillants aussi bien aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, il a été possible de se faire une idée précise sur ce à quoi pouvait ressembler cette culture. Les réponses obtenues de la part des membres de la 130e promotion, au bord de la retraite après vingt-cinq ans de service, nous ont permis de dessiner les contours de ce qui apparaît comme une véritable culture professionnelle des membres de cette promotion très proche de celle décrite par la littérature anglo-américaine. On retrouve en effet la question de la solidarité entre surveillants, la crainte et l’hostilité face au groupe adverse que sont les détenus et enfin un sentiment d’isolement et de coupure face à la hiérarchie, à l’administration pénitentiaire et à la société. On a conscience de faire un métier déprécié, pas comme un autre, qui ne satisfait pas beaucoup et dont on ne parle pas ou très peu.
On doit ajouter que bien que les surveillants cohabitent avec les détenus dans une très nette situation d’opposition, ils sont en même temps très souvent dans une situation de dialogue et d’échange qui leur permet d’assurer le calme. Le contrôle de la population pénale ne peut être assuré que s’il existe un minimum d’entente entre les surveillants et les détenus qui passe par un système d’échanges sociaux informels. Il y a là une sorte de paix armée car il y a, entre les surveillants et les détenus, une sorte de lutte plus ou moins importante en fonction des moments de la vie en prison. On peut ajouter enfin que de nouvelles études sur cette culture professionnelle des surveillants, s’inspirant plus de littérature anglo-américaine plus précises et beaucoup mieux centrées, seraient certainement les bienvenues. En effet ce corps a beaucoup changé ces dernières années, notamment avec une assez forte féminisation, (puisque les surveillantes femmes peuvent dorénavant garder les détenus hommes) et une très sérieuse augmentation du niveau culturel. Ces changements relativement récents doivent très probablement conduire à une évolution des rapports au sein des prisons françaises qu’il serait très intéressant de suivre précisément avec de nouvelles recherches.
Notes
1
Alfred L. Kroeber et Clyde Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, New York, Vintage Books, 1963 [1952].
2
Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Montréal, Éditions Hurtubise, 1992.
3
Antoinette Chauvenet, Françoise Orlic et Georges Benguigui, Le Monde des surveillants de prison, Paris, PUF, 1994. Voir aussi, la même année : « Les surveillants de prison et la règle », Déviance et Société, vol. 18, n° 3, 1994, p. 275-294.
4
Fabrice Guilbaud, La socialisation professionnelle des surveillants de prison (1993-2018), Rapport remis à la mission de recherche du GIP Droit et Justice, 2019.
5
Dominique Monjardet, « La culture professionnelle des policiers », Revue Française de Sociologie, vol. 35, n° 3, 1994, p. 393-411.
6
Voir Catherine Gorgeon, « La “cohorte de gardiens de la paix” : quels apports pour la connaissance de la culture professionnelle des policiers? », in Dominique Monjardet, Notes inédites sur les choses policières, 1999-2006, Paris, La Découverte, 2008, p. 229-243.
7
Robert Regoli, Eric Poole et Jeffery Schrink, « Occupational socialization and career development : A look at cynicism among correctional institution workers », Human Organization, vol. 38, n° 4, 1979, p. 183-187.
8
Donald Clemmer, The Prison Community, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1940.
9
Voir p. ex. David Duffee, « The Correction Officer Subculture and Organizational Change », Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 11, n° 2, 1974, p. 155-172.
10
Voir respectivement Gresham Sykes, The Society of Captives: a Study of a Maximum Security Prison, Princeton, Princeton University Press, 1958 (trad. fr. sous la dir. de D. Kaminski et P. Mary : La société des captifs, Bruxelles, Larcier, 2019) et Donald L. Wieder, Language and Social Reality: The Case of Telling the Convict Code, Berlin/Boston, De Gruyter/Mouton, 1974.
11
Voir p. ex. Lucien Lombardo, « Group Dynamics and the Prison Guard Subculture: Is the Subculture an Impediment to Helping Inmates? », International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 29, n° 1, 1985, p. 79-90.
12
Kelsey Kauffman, Prison officers and their world, Cambridge, Harvard University Press, 1988.
13
John R. Jones et Daniel P. Carlson, Reputable Conduct, Ethical Issues in Policing And Corrections, New Jersey, Prentice Hall, 2001.
14
Heather Schoefeld et Grant Everly, « The security mindset: Corrections officer workplace culture in late mass incarceration », Theoretical Criminology, vol. 27, n° 2, 2023, p. 224-244.
15
Voir p. ex. Helen Arnold, « The prison officer », in Yvones Jewkes, Ben Crewe et Jamie Bennett (dir.), Handbook on Prisons, Abington, Routledge, 2016.
16
Laurent Gras et Nicolas Boutin, Les démissions des élèves surveillants durant la formation et l’année de titularisation, Agen, ENAP, 2011.
17
Everett Hughes, Men and their work, Glencoe, Free Press, 1958.
18
Georges Benguigui, « Contrainte, don et négociation en prison », Sociologie du travail, vol. 39, n° 1, 1997, p. 1-17.
19
Antoinette Chauvenet, « Guerre et paix en prison », Les Cahiers de la sécurité intérieure, vol. 31, 1998, p. 91-109.
20
Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville, Du système pénitentiaire aux États-Unis…, Paris, Charles Gosselin, t. 2, 1836, p. 106.
21
Philip Selznick, Leadership in Administration, New York, Harper & Row, 1957.
22
Erving Goffman, Asiles, Paris, Minuit, 1968.
23
Richard Sparks, Anthony Bottoms et Will Hay, Prisons and the Problem of Order, Oxford, Oxford UP/Clarendon Press, 1996.
24
Maurice Halbwachs, « Les caractéristiques des classes moyennes », in Inventaire III, Paris, Alcan, 1939, p. 28-52.