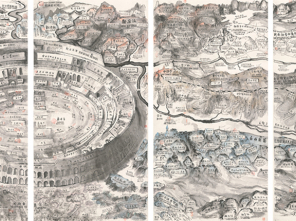(TAREA IIPC/UNSAM)
« .... l’histoire nationale devient problématique »

Statue de Chronos au cimetière de Staglieno, Gênes (sculpture réalisé par Santo Saccomano 1876 ; tombe d’Erasmo Piaggio)
François Hartog (1946) historien, était Directeur d’Études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et membre du Centre de recherches historiques. Ancien élève de l’École normale supérieure, il a occupé une chaire d’historiographie ancienne et moderne et a été président par intérim de l’EHESS en 2012. Il a dirigé le Centre Louis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes, fondé par Jean-Pierre Vernant, et a été l’un des membres fondateurs de l’Association des Historiens.
Son œuvre abondante combine un intérêt primordial pour l’histoire intellectuelle du monde antique classique (Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre ; Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne) avec l’étude de la pensée historique du XIXe siècle (Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges ; La Nation, la religion, l’avenir. Sur les traces d’Ernest Renan), des réflexions historiographiques plus générales (Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens ; Croire en l’histoire) et des recherches sur les rapports que les sociétés entretiennent avec le temps, la manière dont elles articulent passé, présent et futur (Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps ainsi que son dernier livre Chronos. L’Occident aux prises avec le temps). Son concept de « régime d’historicité » est un instrument heuristique de grande valeur pour la réflexion sur les différentes expériences sociales du temps, notamment celle des sociétés actuelles, immergées dans un temps « présentiste », évanescent et contraignant dans lequel le présent devient la catégorie dominante.
En juin 2019, François Hartog s’est rendu à Buenos Aires à l’invitation de l’ambassade de France et du Centre Franco-Argentin pour participer à la Nuit de la Philosophie et donner des conférences à l’Institut de recherche sur le patrimoine culturel de l’Université Nationale de San Martin. C’est dans ce contexte que plusieurs membres argentins du comité de rédaction du revue – Omar Acha, Fernando Devoto, Martha Rodriguez, Daniel Sazbon et Carolina Vanegas – se sont entretenus avec lui.
Passés Futurs – Comment en êtes-vous venu à travailler sur les rapports au temps ? Quel rôle votre propre expérience du temps joue-t-elle dans votre proposition sur le « présentisme », et à quel point cette hypothèse est-elle marquée par la situation européenne ?
François Hartog – Je crois qu’il y a deux éléments : l’un d’ordre intellectuel, et un autre touchant à l’expérience de ma propre vie. L’élément intellectuel, c’est une réflexion menée à partir de l’anthropologie, plus précisément à partir de la lecture d’anthropologue que j’ai souvent cité : Marshall Sahlins. Son livre Islands of History1, sur les îles du Pacifique, pose la question de l’histoire en Polynésie, pour dire non seulement que les Maoris ont une histoire, bien sûr, mais qu’ils ont une façon de faire de l’histoire. C’est au fond cette lecture qui m’a conduit vers la notion de régime d’historicité. Lui-même ne va pas si loin, si je puis dire. Il était partie prenante du débat qui avait encore cours dans les années 1950-1960 sur les peuples avec histoire, les peuples sans histoire, etc. Cela paraît tout à fait extraordinaire aujourd’hui que ces questions se posaient encore dans ces termes là, mais c’était bel et bien le cas, en particulier sous l’effet du marxisme et sa théorie des stades. Sahlins intervenait dans ces débats pour dire : ils ont une histoire, ils font de l’histoire, simplement ils ont une façon particulière de faire de l’histoire.
J’ai essayé de prolonger cette interrogation, en m’intéressant à la question du temps lui-même, des rapports au temps, des modes d’expériences du temps. Celui qui, du point de vue intellectuel toujours, m’a permis d’avancer davantage, est Reinhardt Koselleck. Il ne parle pas non plus de régime d’historicité mais des transformations de l’expérience du temps, en mettant en œuvre ces deux catégories qu’il appelle « méta-historiques » : le « champ d’expérience » et l’« horizon d’attente ». On peut bien sûr discuter sur la manière dont ces deux catégories ont été formulées par Koselleck, mais il n’en demeure pas moins qu’elles permettent de comprendre l’enclenchement du temps historique moderne, comme un écart qui va en s’élargissant entre le champ d’expérience et l’horizon d’attente. Le temps moderne, le concept moderne d’histoire s’installent dans cet écart : le temps devient un acteur à part entière et on entre dans l’histoire processus, une histoire portée par le progrès.
Marshall Sahlins d’un côté, Reinhardt Koselleck de l’autre, qui me ramène vers l’Europe. Intervient une troisième expérience, qui est cette fois une expérience de vie. J’ai séjourné pendant un an à Berlin au début des années 1990. Ce n’est plus vrai aujourd’hui, mais Berlin était alors une ville où à chaque pas pratiquement vous saisissiez le temps, les ruptures, les brèches, les trous. Vous aviez d’une part, du côté de l’Est, encore complètement en ruine, la trace de ces grands immeubles wilhelmiens qui n’avaient pas été entretenus et qui étaient encore pour certains marqués par les combats de la prise de Berlin. Et puis vous aviez de l’autre côté, le Berlin de l’Ouest, reconstruit, qui jouait à fond la carte du régime moderne d’historicité, soit une marche accélérée vers le futur. On rencontrait aussi beaucoup d’espaces encore vides, marques d’immeubles abattus, de destructions au moment de la prise de Berlin par les Russes – le bunker d’Hitler était encore presque là, affleurant à la surface du sol, on reconnaissait l’endroit. Au cours de mes marches dans Berlin, la ville m’est apparue comme un espace où l’on pouvait faire une expérience directe de ces brisures dans le temps.
Ce qui m’a donné l’idée que la notion de régime d’historicité, que j’avais formulée pour la première fois en lisant Sahlins, pouvait s’appliquer à l’histoire contemporaine occidentale. On dit parfois que c’est une notion purement européocentriste, ce que je ne crois pas. En tout cas, pour moi, dans la manière dont les choses se sont passées, c’est l’inverse : c’est au travers d’une réflexion sur des sociétés non européennes, menée par l’intermédiaire de Sahlins, qui voyait chez les Polynésiens une forme d’histoire héroïque – un peu sur le mode de l’histoire telle qu’on peut la trouver chez Homère –, que j’ai été amené à introduire cette réflexion sur les transformations des rapports au temps, sur les différents modes de faire de l’histoire « chez nous ».
Je me suis efforcé de mettre ce parcours en forme pour saisir ce qui se passait, en France, en Europe et dans le monde. L’hypothèse du présentisme revient à dire que nous sommes dans un moment où le présent est devenu, ou en train de devenir, la catégorie dominante. Le présent s’imposant d’abord de façon négative : parce que le futur n’était plus là, parce que le futur était mis en question, parce que dans les sociétés européennes, au cours des années 1970, s’est diffusée tout d’un coup l’idée que le futur se fermait – c’est alors qu’on a commencé à parler de « crise du futur ». Les catégories du passé, du présent et du futur fonctionnent un peu comme un système de vases communicants. Si le passé domine, ce sont les autres catégories qui se trouvent réduites, alors qu’avec le régime moderne, c’est le futur qui devient la catégorie dominante, celle qui éclaire les autres. Mais quand cette lumière faiblit, quand la croyance dans le futur se trouve mise en question, mise en doute, pour tout un ensemble de raisons, le choix du passé – celui de l’ancien régime d’historicité – n’étant plus possible, le présent est venu prendre la place, d’abord de manière négative, faute de mieux. Comme la nature, le temps semble avoir horreur du vide !
Le mouvement s’observe d’abord dans les sociétés européennes, mais je pense que les transformations de l’économie mondiale vers un capitalisme de plus en plus financier et moins industriel poussaient dans le sens du présent. Ce capitalisme a une nette dimension présentiste : il veut des rendements, des profits tout de suite, des retours sur investissement de plus en plus rapides. Dans le même moment, interviennent la révolution de l’information, la diffusion de l’informatique, bientôt Internet, qui sont des instruments fondamentalement présentistes puisqu’ils reposent sur l’instantanéité et la simultanéité. Ce sont là des éléments forts qui vont dans le sens d’une expérience du temps où la catégorie du présent prédomine de plus en plus.
Est-ce que cette approche est complètement européenne ? Est-ce qu’une nouvelle fois l’Europe se regarde le nombril et prétend que le monde se règle sur elle ? Elle n’en a plus les moyens depuis longtemps déjà et le présentisme la dépasse largement. Ce capitalisme financier n’est pas d’abord européen, mais américain. Sur cette voie, la Chine a rapidement cheminé, après les folies sanglantes de Mao, le grand bond en avant, les aciéries dans les campagnes, etc. La révolution de l’information n’est, à coup sûr, pas européenne. Il y a donc de puissants facteurs poussant vers le présentisme qui vont bien au-delà de la petite Europe, laquelle, de toute manière, ne se considérait plus du tout comme le centre du monde. Déjà après la Guerre de 14, vous avez un nombre considérable de témoignages, comme celui de Lucien Febvre, relevant que c’en est fini de cette position de l’Europe : c’est tout le drame des années 1920 et 1930, et après 1945 il n’en est plus du tout du tout question.
Passés Futurs – La dimension nationale se trouve-t-elle elle aussi mise en question par ce nouveau régime d’historicité ? Pensez-vous qu’il y a une remise en cause du lien entre histoire et construction nationale ?
François Hartog – Oui, l’histoire nationale telle qu’on l’a entendue au XIXe siècle et une partie du XXe siècle, en particulier en Amérique du sud, est une histoire futuriste, c’est une histoire où la nation est le but : elle est là mais il faut la construire. On écrit une histoire en partant du futur pour regarder vers le passé, et c’est cela qui vous donne les débuts de la nation : on sait que les origines doivent être trouvées à tel ou tel endroit, et chacun propose ses origines, selon ses positions politiques, idéologiques, etc. Ce sont des histoires futuristes. En retour, à partir du moment où le futur se trouve mis en question, on ne sait plus très bien comment écrire une histoire nationale. Cela ne veut pas dire qu’on n’en écrit plus, bien sûr. Et puis vous avez le cas des histoires proprement réactionnaires ou contre-révolutionnaires, qui, tout en prenant l’exact contrepied des histoires futuristes, n’en étaient pas moins marquées par ce contre quoi elles voulaient lutter : elles étaient aussi partie prenante de ce mouvement. La contre-révolution n’existe pas sans la Révolution ; les histoires nationales contre-révolutionnaires ou réactionnaires n’existeraient pas sans les histoires nationales racontant l’avancée vers l’accomplissement de la nation – qui n’est pas nécessairement un chemin rectiligne.
Dès lors que le futur perd cette force d’entraînement, l’histoire nationale devient problématique : c’est bien ce qui s’est produit. Les chronologies doivent varier selon les pays. Je ne sais pas si en Argentine on s’est posé ce type de questions dans les années 1970-1980 ? En France, en tout cas, ont été publiées dans les années 1980 nombre d’Histoires de France, mais on voulait des Histoires qui ne soient plus téléologiques, qui ne postulent pas l’identité de la France ou la France comme personne, pour reprendre la formule de Michelet. D’où, par exemple, l’histoire dirigée par André Burguière et Jacques Revel qui s’appelait non pas Histoire de France mais Histoire de la France2. En passant d’histoire de France, qui était le genre, avec France comme personne, à histoire de la France, vous passez à une histoire qui examine la France comme un objet, avec par conséquent toutes les interrogations, tous les questionnements autour de cet objet : comment est-il fabriqué ? quel est son histoire, l’historiographie donc, etc. ? Avec en toile de fond, des doutes grandissants sur la France et son histoire.
Ce questionnement a rencontré un mouvement très fort, et qui le demeure aujourd’hui, autour de la thématique de l’identité. Celui qui, d’une certaine manière à son corps défendant, y a contribué, est Fernand Braudel, dont le dernier livre (inachevé) s’appelle justement L’Identité de la France (1986)3. On a dit ça y est, Braudel apporte de l’eau au moulin de l’extrême droite, la défense de l’identité française étant toujours un des thèmes favoris de l’extrême droite. Ce n’est pas le point intéressant – même s’il est vrai que Braudel n’a jamais été un grand progressiste. Ce qui peut retenir l’attention, c’est plutôt le malentendu : si vous reprenez les premières pages de son livre, quand il parle d’identité de la France, il ne s’agit pas d’une identité substantielle, car elle ne se trouve que dans la longue durée. Vous ne la saisissez jamais en disant : « c’est cela ». C’est un mouvement continu depuis la préhistoire. Le quiproquo autour de ce titre est assez révélateur des interrogations sur l’histoire de la France. Et le fait que chaque grand éditeur ait voulu publier son Histoire de la France – le plus souvent d’ailleurs, ce sont des ouvrages collectifs. Braudel, parce que c’était lui, l’a entrepris seul, il ne l’a pas fini. Il s’y est engagé comme Michelet (mais plus tard que lui), son vrai interlocuteur : c’était à lui qu’il pensait. Mais les autres sont des histoires collectives : celle de Revel et Burguière, celle de Furet, Le Roy Ladurie, Duby et Agulhon4 et d’autres encore. Le projet est autre : on découpe l’objet. La dernière tentative qui n’est pas une histoire de la France, celle des Lieux de mémoire de Nora, est une forme d’histoire de la France à travers le prisme de la mémoire, ayant pour point de focalisation le « lieu de mémoire »5.
Passés Futurs – Dans votre article sur Clio comme un lieu de mémoire européen6 vous proposez l’idée que nous assistons à un remplacement du concept moderne d’histoire par un autre, encore en formation, mais dans lequel le moteur, l’usine de conformation, ne serait plus l’Europe. Dans ce remaniement, quel serait la place pour l’histoire comme discipline, et celle des historiens dans la cité ?
François Hartog – C’est, je crois, encore une question. Ce qu’on a observé au cours au cours de quarante dernières années, c’est que la mémoire est devenue la référence première. La montée de la mémoire – je le dis entre parenthèses – est aussi à mettre en rapport avec la mise en question du futur : c’est une façon d’y répondre ; cela n’explique pas le tout de la mémoire, mais dans le phénomène de la mémoire il y a cette aspect-là. La mémoire venant prendre une place croissante, l’histoire professionnelle s’est trouvée mise en question de différentes façons. Naturellement, les médias ont aussitôt dit « les historiens n’ont jamais parlé de toutes les choses sinistres qui se sont produites, ils n’ont jamais été capables de parler au plus près de l’occupation, de la collaboration avec les nazis », etc. En réalité, les historiens, certains du moins, n’ont pas été pris au dépourvu par ce déplacement, puisqu’il y avait eu le développement de l’histoire orale, qui était une façon de sortir du cadre très délimité de l’histoire traditionnelle ou positiviste. L’histoire orale avait déjà fait une percée, et elle fait bien évidemment appel à la mémoire. Une autre réponse des historiens a été de dire : la mémoire, admettons, mais ce qu’il faut prendre en compte, c’est qu’il y a une histoire de la mémoire – et, du coup, l’histoire retrouve toute sa légitimité. D’une certaine façon, Les Lieux de mémoire de Nora sont une traduction de cette position : écrire à travers le prisme de la mémoire une nouvelle forme d’histoire, une histoire « au second degré ». L’historien se trouve remis en selle, sinon maître du jeu.
Et puis il y a une troisième attitude, plus explicite que les deux précédentes, qui est de dire au fond : cette mémoire dont on parle beaucoup est, en réalité, une nouvelle mémoire ou une nouvelle acception de la mémoire. Il ne s’agit plus du tout de la mémoire qu’on avait, celle qui, dans le modèle traditionnel, se transmettait des grands-parents aux petits-enfants, une transmission qui se faisait sans même qu’on ait à s’en préoccuper. La mémoire dont nous parlons aujourd’hui est une mémoire qu’on n’a pas, parce qu’on n’a pas pu l’avoir. C’est celle que les descendants de disparus, d’exterminés, n’ont pas pu avoir puisque ceux qui auraient pu la leur transmettre n’ont pu le faire. Cette mémoire-là, il faut non pas la retrouver, mais pratiquement la refaire, la reconstruire – ce qui ne veut pas dire l’inventer. Il s’agit d’une mémoire volontaire. Elle procède par enquêtes : on recherche les archives, on lit les correspondances, on visite les lieux, bref, on rassemble toutes les traces. Cette mémoire est, en réalité, très historienne dans ses procédures. Et l’historien peut aisément travailler dans cette perspective-là. La littérature est aussi intervenue : beaucoup de livres, de romans en particulier, ont mis en récit des enquêtes mémorielles. Je cite souvent Les Disparus de Daniel Mendelsohn7, qui n’est pas historien, mais philologue. C’est un juif né à New York de troisième génération (ses parents eux-mêmes étaient nés aux États-Unis) et, tout d’un coup, il prend conscience que des parents, son grand-oncle et sa famille, ont disparu dans une petite ville de Biélorussie, et qu’il ne sait rien de plus – sinon qu’ils ont été assassinés par les nazis. Son grand père, le frère de l’oncle en question, n’a, en effet, jamais rien dit. Alors il se lance dans une enquête, qui va lui prendre des années et qu’il raconte dans ce livre, enquête à la fois policière et historienne. Pour retrouver et suivre les traces, il est amené à voyager en divers pays, à rencontrer des gens, des survivants, des témoins, des proches pour finalement arriver à savoir ce qui s’est passé. Et quand il a établi ce qui s’est réellement passé – comment ils ont été assassinés et où –, le deuil peut se faire et le livre s’achever. C’est une œuvre littéraire, forte, qui relève aussi des études sur la mémoire et de cette forme d’histoire, fréquente aujourd’hui, où le « je » du narrateur est constamment présent.
Dans l’article « Clio », je m’intéresse à l’échange de place qui est intervenu entre l’histoire et la mémoire : la mémoire est première, tandis qu’à l’histoire revient une position seconde, voire ancillaire. Deux exemples (parmi d’autres) illustrent ce déplacement. Le Mémorial aux juifs assassinés à Berlin, de Peter Einsenman, ce lieu de mémoire qui est un lieu construit, fabriqué, où l’architecte n’avait rien prévu en termes d’histoire. C’est seulement dans les discussions soulevées par le projet – car tout ce qu’on fait à Berlin suscite des débats très longs – qu’on a exigé qu’il y ait un lieu d’histoire ou pour l’histoire, situé au sous-sol. Le visiteur du Mémorial, qui évoque un cimetière abandonné (il est fait de stèles de béton), ne reçoit aucune indication sur la manière de pratiquer le lieu (pas de sens de visite, pas d’information). Aussi est-il frappant de voir à quel point les gens souvent ne savent trop quoi faire, ils déambulent au milieu de ce labyrinthe ; les enfants, eux, jouent à cache-cache, mais les parents ou les adultes ne savent pas trop quelle attitude adopter. L’idée est que vous vous laissez saisir, émouvoir par le lieu : le rapport qui s’instaure passe par l’affect et non par le registre du discursif. Et si vous voulez avoir des informations sur l’extermination, ses lieux, sa chronologie, vous descendez au sous-sol, où vous trouvez les explications utiles. À travers cet exemple, c’est cette position subalterne de l’histoire que je voulais faire apparaître. Cela ne règle pas toute la question de savoir ce que font les historiens dans cette conjoncture, mais cela donne une indication du rôle qui leur est proposé.
Reste la question de savoir si l’histoire globale peut jouer le rôle d’un nouveau concept d’histoire, clairement et définitivement non téléologique. En a-t-elle la prétention ? Je me limiterai à une remarque sur le temps. Quelle est la place du présent, du passé, du futur là-dedans ? La question d’un sens de l’histoire ne se pose pas non plus : on ne va pas au-delà du fait de montrer qu’il y a de la symétrie. Prenons le livre important de Romain Bertrand, qui a connu une forte audience, sur l’histoire « à parts égales » : les Hollandais d’un côté et les Indonésiens d’un autre côté ; et il montre que ce qui était présenté comme une espèce d’épopée du côté hollandais arrivant dans les Indes n’apparaissait pratiquement pas dans les chroniques du côté javanais, à peine plus qu’une note en bas de page8 ! Le traitement symétrique fait ressortir la dissymétrie, c’est extrêmement intéressant. Mais qu’en est-il de leurs rapports au temps respectifs ? Des discordances entre les temporalités des uns et des autres et des quiproquos qui en résultent ? Ce à quoi Marshall Sahlins avait été attentif dans les rencontres entre les Anglais et les Maoris.
Est venu s’ajouter, enfin, le phénomène tout à fait inattendu de l’anthropocène. Le mot s’est répandu à grande vitesse dans les sciences sociales et dans les grands médias. Or avec l’anthropocène s’introduit un temps autre. Tout d’un coup – cela commence à peine au début des années 2000 –, certains commencent à prendre conscience, à travers le réchauffement climatique, qui devient le principal sujet, que le temps qui était celui de l’histoire du monde, de l’histoire des hommes, le temps moderne, ce temps bref, se voit confronté à un temps qui lui se compte en millions, voire en milliards d’années. Avec la difficulté supplémentaire qu’il nous faut tenir compte des phénomènes de l’irréversibilité et des rétroactions : ce que nous faisons aujourd’hui, ce que nous avons fait il y a cinquante ans ou plus, aura encore des effets dans un futur même éloigné, et c’est irréversible. Comment penser, en effet, un futur qui n’est pas encore advenu mais qui est déjà en partie joué ? C’est un problème d’ordre cognitif que l’espèce humaine n’a jamais rencontré. Comment se débrouiller ? Avec passé, présent, futur, les humains ont su fabriquer tout un tas de combinaisons. Mais là, avec un futur non advenu et déjà joué, c’est beaucoup plus difficile. Et c’est beaucoup plus difficile de savoir comment on peut articuler ou, à tout le moins, penser l’écart entre les temporalités longues de l’anthropocène, entre l’immense coulée qui est celle du temps de la Terre, et le temps minuscule de l’histoire humaine ou, pire encore, celui du monde moderne entre le XVIIIe et la fin du XXe siècle.
Passés Futurs – Je voudrais retourner à la question du lieu de l’historien. Dans un climat qu’on peut percevoir comme une « recherche d’engagements », se publie de l’histoire qu’on peut qualifier de militante, on pense en France – ce qui peut-être n’est pas juste ? – à Patrick Boucheron et à son succès auprès des jeunes générations. Autrement dit, trouve-ton des signes de ce qu’on pourrait appeler un retour ou une reprise de l’historia magistra ? En Italie, il y a un journal intitulé Historia Magistra ; on voit aussi quelques signes aux États-Unis de ce que je juge être une ancienne conception de l’histoire, celle qu’on appelait « l’histoire pragmatique ». À cette première question sur le lieu de l’historien s’en ajoute une seconde qui est celle des usages du passé par les historiens. Avec en particulier, le difficile problème du jugement historique. On peut repartir de votre introduction au texte de Charles Péguy, où vous proposez cette idée du « jugement historique » comme différent du « jugement judiciaire ». Qu’est-ce qui aujourd’hui jouerait le rôle qui a été celui de l’Affaire Dreyfus pour Péguy ou du procès Eichmann pour Hannah Arendt ?
Pour résumer : voit-on aujourd’hui un retour instrumental à l’historia magistra ? Que dire du « jugement historique » et peut-il être posé aujourd’hui dans les mêmes termes qu’au début du XXe siècle ?
François Hartog – Cette question de l’historia magistra resurgit, en effet, de plusieurs façons. Commençons par admettre que le régime moderne d’historicité, l’histoire moderne, a évacué l’historia magistra, du moins l’ancien modèle de l’historia magistra. On voit réapparaître une forme d’historia magistra qui ne dit pas vraiment son nom à travers les commémorations. C’est le thème central des grandes commémorations nationales, menées par les pouvoirs politiques, quels qu’ils soient : celui des leçons. En France, les Président de la République jouent cette carte depuis longtemps. Ils sont les dépositaires de cette fonction. Mais les leçons sont souvent négatives : elles relèvent plutôt du nunca más. Je pense que cette posture, presque inévitable de la part d’un responsable politique qui vient commémorer, par exemple, l’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, n’a pratiquement aucune portée. Certes je n’ai pas fait d’enquête, mais parce que c’est justement se tromper de temps. La thématique des leçons de l’histoire, au sens où on l’entendait autrefois, ne marche que si le passé est bien investi de cette force de leçon, de cette capacité à susciter l’imitation, même sur le mode négatif (ne pas imiter). Je ne pense pas qu’on puisse remettre en marche ce type de rapport au temps qui relève de l’ancien régime d’historicité.
Une autre manière d’introduire le thème des leçons, c’est d’avoir une position éthique – et on arrive à la question du jugement. Position éthique, qui est adoptée, revendiquée même par un certain nombre d’historiens, et en particulier de jeunes historiens : juger l’histoire, forcément à partir du présent, et donc avec des critères d’évaluation qui sont ceux d’aujourd’hui. Un des cheminements de cette position éthique vient, je pense, de la temporalité inédite du crime contre l’humanité : dès lors qu’il y a crime contre l’humanité, il y a imprescriptibilité et, par conséquent, un temps qui ne passe pas. Le criminel est toujours contemporain de son crime, jusqu’à sa mort ; et moi aussi je suis forcé d’être contemporain de son crime. Par conséquent, le jugement de type judiciaire peut s’exercer, de même que le jugement de type historique, et l’on a probablement tendance à superposer ou à confondre les deux. Cette position est à la fois parfaitement compréhensible, aisée à soutenir et facile à faire partager. De plus, vous êtes du bon côté : celui des victimes. Cet usage du jugement va de pair avec la judiciarisation croissante de la vie de nos sociétés. Tout pratiquement relève du juge, tout litige relève du juge, l’histoire elle-même peut être présentée devant le tribunal, et la question est alors de savoir s’il revient au juge de dire ou non l’histoire, ou de dire qu’il ne la dit. Ce sont tous les débats qui ont eu lieu sur le juge et l’historien, notamment autour du négationnisme et des procès pour crimes ou complicité de crimes contre l’humanité.
C’est par ces deux voies, me semble-t-il, que qu’une certaine forme d’historia magistra réapparaît au moins dans l’espace public, mais sans que soit envisagée la question du type de temporalité auquel ce recours fait appel ou nous installe.
Passés Futurs – Mon intérêt porte spécifiquement sur la temporalité de la mémoire. En écoutant ce que vous disiez à l’instant sur la manière dont les visiteurs du Mémorial des juifs assassinés sont incités à se rapporter à ce passé, je me demande si c’est la bonne ou désormais la seule manière de retrouver ce passé. Alors même que les témoins disparaissent et qu’il y a toujours des négateurs. La place de l’historien est-elle seulement au sous-sol dans le centre de documentation ?
François Hartog – La question n’est pas facile et je n’en prendrai qu’un aspect. La manière dont le visiteur du Mémorial est invité à « retrouver » tous ces morts est, si je puis dire, entièrement à sa charge : le lieu est muet. C’est à lui, en quelque façon, de les « ressusciter » pour les accompagner dans la mort. En somme, le visiteur est placé dans la même position que Michelet qui définissait son rôle d’historien comme celui d’administrateur du bien des décédés. Résurrection, évocation, justice sont les mots qui sont employés par Michelet. Cette manière de faire surgir une présence de l’absence même s’éclaire si on la met en rapport avec une pratique courante aujourd’hui, aux États-Unis en particulier, qui est celle du reenactment. Commémorer en faisant revivre, répétant, mimant, mettant en scène un événement (tragique souvent) qui a eu lieu. Dans ces commémorations rituelles les spectateurs sont aussi acteurs : ils sont partie prenante. On est en pleine politique mémorielle, avec pour but de maintenir le souvenir vivant. Le reenactment et le Mémorial mobilisent, je crois, la même logique : du côté du Mémorial, il n’y a que le vide et le silence de l’absence, de l’autre, il y a la scène qui est rejouée et des images. Mais dans les deux cas, il s’agit de re-présenter ce qui a eu lieu. Ces façons de commémorer, qui sont en phase avec le régime présentiste, ne passent pas par la médiation de l’historien.
Passés Futurs – Que pensez-vous des questions posées par des travaux récents comme celui de Armitage et Guldi, The History Manifesto, ou du manifeste publié par Joan Scott, Gary Wilder et Ethan Kleinberg, Theses on Theory and History9 ? Tous deux ont l’intention d’interpeller les historiens pour ouvrir la possibilité de se poser des questions allant au-delà de l’empirisme.
François Hartog – Oui, bien sûr, c’est toujours bienvenu. Dans le second manifeste contre l’histoire seulement empirique, les auteurs ont dans leur viseur, autant que je me souvienne, l’American Historical Review, qui fait trop peu de place à ceci ou cela, aux femmes entre autres. Soit. Ils disent aussi qu’il faudrait faire une place à la philosophie de l’histoire. Philosophie de l’histoire : non pas pour relancer celles du XIXe siècle qui s’inscrivaient dans un contexte bien différent, celui du régime moderne d’historicité, mais pour poser la question d’un sens aujourd’hui, alors que le régime moderne n’est plus. Comment l’histoire peut-elle « habiter » le monde tel qu’il est réellement ? À cet égard, plaider pour l’histoire globale n’est peut-être pas suffisant. Quant au manifeste d’Armitage et de Guldi, je ne l’ai pas étudié de près, mais il ne m’a pas paru porteur de grandes révélations. Se faire l’avocat de la longue durée, on ne peut qu’être d’accord, et peut-être que dans le contexte américain des luttes autour de l’identité, c’est particulièrement utile ? Quoi qu’il en soit, tout ce qui favorise une approche réflexive, plaide pour l’ouverture vers d’autres disciplines, y compris la philosophie, mérite d’être encouragé.
Passés Futurs – Vous publiez, en cet automne 2020, un nouvel ouvrage : Chronos. L’Occident aux prises avec le temps. Aboutissement d’un vaste chantier, il place cette fois au cœur de l’interrogation ce que vous appelez le « régime chrétien d’historicité ». Quelle est sa spécificité par rapport aux différentes formes de rapports au temps marqués par une prépondérance du passé ?
François Hartog – Comme vous le suggérez, Chronos est l’aboutissement de mon travail sur le temps, les temps plutôt. Il m’a paru indispensable de m’arrêter sur le temps chrétien auquel j’avais touché trop rapidement dans Régimes d’historicité. Avec cette première question : peut-on cerner un régime chrétien d’historicité ? Une lecture des premiers textes du christianisme permet de répondre sans équivoque, oui. Je le définis comme un présentisme apocalyptique. Présentisme, car entre les deux bornes de l’Incarnation et de la Parousie il n’y a en fait qu’un temps sans consistance propre qui est du présent. Apocalyptique, car l’horizon est celui d’une apocalypse précédant le retour glorieux du Christ et le Jugement dernier. Ce régime chrétien va peu à peu s’imposer, coloniser tous les autres temps et demeurer le cadre de référence jusqu’au XVIIIe siècle.
Avec le régime chrétien s’opère un renversement dans le rapport passé/présent. Dans l’ancien régime d’historicité, la prime va au passé qui est modèle, avec le régime chrétien, le nouveau l’emporte sur l’ancien : le Nouveau testament « vieillit » l’autre testament qui devient l’Ancien testament. Le présent de l’Incarnation devient le point de vue indépassable sur le passé.
Passés Futurs – Quelles sont les incidences de cette exploration du régime chrétien dans votre manière de voir et de comprendre le régime moderne d’abord, puis le présentisme ? Le parcours que vous engagez fait-il ressortir plus nettement certains traits caractéristiques – ou certains héritages ?
François Hartog – En suivant les avatars des trois concepts de Chronos, Kairos et Krisis depuis la traduction de la Bible par les Septante jusqu’à aujourd’hui, je montre comment le temps moderne est sorti, à tous les sens du mot, du temps chrétien : il en vient et il l’a quitté. Chronos, qui a été tout un temps enserré dans le filet du régime chrétien, pris entre le Kairos de l’Incarnation et Krisis (le Jugement), s’échappe et étend son empire entre le XVIIIe et le XXe siècle. Mais, et c’est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes, Kairos et Krisis ne disparaissent pas pour autant, ils se trouvent repris, recyclés par le temps moderne.
Enfin, le présentisme surgit quand le régime moderne d’historicité se trouve mise en question, quand le futur est perçu comme se fermant et, bientôt, comme porteur de catastrophes. Mais entre le présentisme chrétien et le présentisme contemporain la différence majeure est celle de l’horizon : le présentisme contemporain voudrait n’avoir d’autre horizon que lui-même, la bulle présentiste, alors que le présentisme chrétien, comme je viens de le dire, ouvrait sur l’apocalypse et l’advenue d’un temps tout autre. Aujourd’hui, toutefois, le présentisme se trouve bousculé par le temps inédit de l’anthropocène qui, en réintroduisant la perspective d’une fin possible, voire prochaine, permet la réactivation de schémas apocalyptiques. Mais il ne s’agit en règle générale que d’apocalypses négatives.
Notes
1
Marshall Sahlins, Islands of History, Chicago, Chicago University Press, 1985 (trad. fr. : Des îles dans l’histoire, Paris, Éditions de l’EHESS-Gallimard-Le Seuil, 1989).
2
Jacques Revel, André Burguières (dir.), Histoire de la France, Paris, Le Seuil, 1989-1990, 3 tomes.
3
Fernand Braudel, L’Identité de la France, Paris, Arthaud-Flammarion, 1986, 2 tomes.
4
Emmanuel Le Roy Ladurie, Georges Duby, François Furet, Maurice Agulhon, Histoire de France, Paris, Hachette, 1987-1991, 5 tomes.
5
Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992, 3 tomes.
6
François Hartog, « Clío: ¿La historia en occidente se convirtió en un lugar de memoria? », Estudios Sociales, 58 (1), 2020, p. 103-117.
7
Daniel Mendelsohn, The Lost. A search for six of six millions, New York, Harper Collins, 2006 (trad. fr. : Les Disparus, Paris, Flammarion, 2007).
8
Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Le Seuil, 2011.
9
Jo Guldi, David Armitage, The History Manifesto, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 ; Ethan Kleinberg, Joan Wallach Scott, Gary Wilder, Theses on Theory and History, 2018 [en ligne].