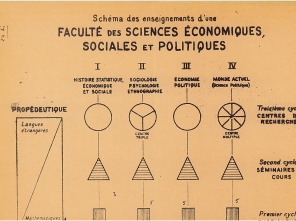Active à l’École pendant de longues années, Dominique Schnapper ne l’a pas été qu’à l’École, et loin de là. Elle a aussi été, selon son propre sentiment, dans une marginalité qui était de sa fidélité filiale à Raymond Aron dans une institution qui ne lui donnait pas la première place. Et c’est depuis cette position particulière qu’elle a mis en œuvre une distance féconde qui a fait d’elle pour nous une interlocutrice privilégiée.
Entretien avec Dominique Schnapper, conduit par Pierre Antoine Fabre et Patrick Fridenson le 4 juin 2025.
Patrick Fridenson : Lors de différentes rencontres au fil du temps, nous avons évoqué vos débuts à la VIe section de l’École pratique des hautes études, vos relations avec Clemens Heller à la Maison des sciences de l’homme et nous nous étions d’ailleurs retrouvés lors du second hommage qui lui a été rendu en 2017. Nous avions évoqué aussi la structuration du milieu des sociologues, avec le Centre de sociologie européenne, avec Alain Touraine de son côté. Ce qui nous intéresse, à l’occasion de cette nouvelle rencontre, pour les 50 ans de la création de l’École en 1975, c’est ce que devient à vos yeux la sociologie et pour une part la sociologie politique depuis la présidence de François Furet.
Dominique Schnapper : À la suite de Mai 68, les années 1970 ont été très politisées, ce qui n’était pas vraiment le cas avant. L’École était de gauche, en gros, mais jusque-là cela intervenait assez peu, en tous cas dans les relations à l’intérieur du Centre de sociologie européenne dirigé par Raymond Aron et animé par Pierre Bourdieu1. Sans doute des positions extrêmes auraient posé problème, mais la politisation n’atteignait pas le niveau qui a été nourri par 1968 et ses suites. Pour moi, les années 1970 ont été difficiles à l’École parce que mon père était devenu le symbole de la réaction et, dans cette atmosphère extrêmement tendue, le fait de ne pas avoir pris officiellement parti contre ses positions apparaissait hautement condamnable. Mes relations avec mes collègues ont donc été éprouvantes. Je me souviens en particulier d’un séminaire dont le sujet m’intéressait ; l’atmosphère était telle qu’au bout d’une ou de deux séances, j’ai cessé de venir parce que ce n’était pas supportable. Il ne se passait rien, je n’ai pas été envoyée dans un camp soviétique ! mais l’hostilité était palpable. Je vous surprendrais en vous citant les noms de certains des collègues qui refusaient de me serrer la main. Donc, pendant ces années-là, j’ai continué les travaux que j’avais commencés dans les projets du « Centre Bourdieu ». J’étais responsable, avec Alain Darbel2, d’une grosse enquête sur la haute administration en France. J’ai continué, je ne saurais pas dire pendant combien de temps, mais en tous cas jusqu’à la publication en 1972. Je continuais à être membre du Centre de sociologie européenne, mais je n’avais plus aucun contact avec Bourdieu, ni avec les autres membres du Centre. On a achevé l’enquête, qui a été publiée dans une collection du Centre de sociologie européenne3.
C’est à ce moment-là qu’est venue la proposition de constituer des archives orales sur l’histoire de la Sécurité sociale, projet que vous connaissez bien, Patrick4. Elle était liée au hasard des relations de Guy Thuillier, membre de la Cour des comptes et historien de l’administration et du quotidien dont le frère, Jacques, était historien de l’art, et qu’Antoine [Schnapper] connaissait bien. Le Centre de sociologie européenne s’était alors divisé entre le « Centre Aron » et le « Centre Bourdieu ». Je ne voulais pas venir au Centre Aron, d’abord parce qu’Aron était mon père, mais aussi parce que je ne m’y sentais pas tout à fait bien, il y avait là un type d’études politiques qui n’était pas le mien. Ma spécificité, s’il y en a une, c’est d’avoir traité des problèmes politiques en sociologue. Les chercheurs qui se sont retrouvés autour d’Aron dans les années 1970, dans cette atmosphère, je le répète, très politisée, étaient eux-mêmes très orientés sur la politique et pas sociologues. Deux raisons fortes de rester à l’écart de ce Centre. Le projet sur la Sécurité sociale est passé par l’École, puisque j’étais membre de l’École, mais ce n’était pas un projet de l’École. J’ai eu comme collaboratrices - j’étais maître de conférences à Sciences Po en même temps - deux de mes meilleures étudiantes. L’une d’entre elles a fait une très belle carrière de sociologue ensuite, Dominique Pasquier. La Sécurité sociale donc. Qu’a-t-on fait ? La question des archives orales était un des grands débats à l’époque, vous vous en souvenez sûrement … Je m’opposais à l’idée d’appeler « histoire orale » un projet d’histoire qui retenait des documents oraux plutôt que des documents écrits. Il me semblait que les historiens étaient un peu grisés par l’« entretien », le rapport avec les interviewés, les « vrais gens », si je puis dire, qui pour nous, sociologues, était une procédure banale et très documentée. Les historiens, disais-je à mes collègues, puisque désormais j’étais désormais membre du Centre de recherches historiques, vous êtes en train de découvrir le B A BA de la pratique sociologique. Je caricature à peine. Ce débat me remettait en relations avec l’École, un numéro des Annales a été consacré au sujet. Par ailleurs, la protection sociale m’apparaissait comme un grand sujet politique. Je ne peux pas revenir ici sur le détail de l’enquête sur la Sécurité sociale, sauf pour dire qu’il fallait, pour faire de bons entretiens, avoir une bonne connaissance du sujet et que cette enquête a joué un rôle important dans mon travail, par l’articulation entre le sociologique et le politique.
Voilà pour les années 1970… Là-dessus, François Furet arrive à la Présidence de l’École. On est en 1977. Furet avait l’idée de donner à l’École, dominée par l’histoire et l’anthropologie, une dimension politique ou, plus précisément, la dimension de la réflexion politique. C’était six ans avant la mort de mon père. Furet avait rompu avec le communisme et la lecture de L’Opium des intellectuels, publié par Raymond Aron en 1955, avait joué un rôle important, m’a-t-il confié. Il avait établi une relation amicale avec mon père. Mais il n’y a pas eu, jusqu’à sa mort, de projet commun. Dans le séminaire Aron se retrouvaient des chercheurs qui avaient les mêmes intérêts et prenaient plaisir à se retrouver. Mais il n’y avait pas ce qu’on appellerait dans le jargon moderne un « laboratoire » de sciences sociales. Kostas Papaïoannou, Annie Kriegel, Alain Besançon, Jean Baechler ou Pierre Manent écrivaient chez eux. Jean-Claude Casanova et Pierre Hassner étaient administrativement reliés à Sciences Po. C’était une réunion d’intellectuels qui s’intéressaient à la politique, heureux de se retrouver au séminaire d’Aron toutes les semaines. La seule membre du Centre Aron qui faisait une sociologie pas du tout politique, c’était Raymonde Moulin5et les chercheurs proches d’elle. Les deux groupes avaient de bonnes relations personnelles, mais peu d’échanges intellectuels, pas non plus de compétition ou de rivalité. L’atmosphère était sympathique. Les intentions de Furet se dont développées de son côté indépendamment du « Centre Aron ». Avant même de cesser d’être président de l’École, et de rompre avec la bureaucratisation de la recherche, les contrats, les rapports, les conflits entre chercheurs, il a voulu créer un nouveau Centre qui, en 1984, à la suite de la mort de Raymond Aron a pris le nom d’Institut Raymond Aron. De fait, il reprenait le modèle du Centre Aron précédent, son centre était formé de spécialistes de l’histoire politique ou de la philosophie politique, qui se retrouvaient pour discuter de leurs projets et intérêts communs.
Patrick Fridenson : Je reviens sur deux points. Le premier, c’est la recherche sur l’État avec Darbel, qui avait un côté extrêmement novateur pour la période, que Florence Descamps, que vous connaissez bien, a essayé d’éclaircir lorsqu’elle a travaillé sur la manière de faire l’étude de l’État dans cette période6. Mais Alain Darbel, lui, venait du quantitatif.
Dominique Schnapper : Tout à fait. C’était un administrateur de l’Inséé.
Patrick Fridenson : Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s’est faite votre collaboration ? Parce qu’elle éclaire aussi un élément qui est constant dans l’enquête que nous menons sur l’histoire de l’École : l’ombre portée des origines de la VIe section où il y avait une forte dimension quantitative.
Dominique Schnapper : Le directeur du Budget, comme vous le savez, est un des hommes les plus importants de France. Le directeur du Budget, donc, s’était adressé à l’Inséé pour mener une enquête sociologique sur la haute administration. À l’Inséé, elle avait été transmise à Alain Darbel, qui, pour nous, était avant tout un administrateur de l’Inséé, mais qui, à l’Inséé, parce qu’il avait travaillé avec Bourdieu en Algérie, était considéré comme un intermédiaire entre les statisticiens et les sociologues, et tout particulièrement avec l’équipe Bourdieu, ce qui était vrai. Darbel a transmis le projet, financièrement lourd et important à tous points de vue, à Bourdieu qui, à l’époque, œuvrait avec ses différents collaborateurs sur de multiples projets. Etant donné que j’étais sans doute celle qui s’intéressait le plus à la politique, et que j’avais fait Sciences Po, il m’a proposé de mener cette enquête avec Darbel. J’avais appris le métier pour l’enquête sur les musées7, qui était terminée, et il s’agissait de préciser le projet suivant. Il m’a proposé celui-là, qui m’a semblé une très belle enquête et qui répondait pour moi tout à la fois à une certaine connaissance du milieu et, sans doute, bien que je n’en aie pas eu conscience à l’époque, à des intérêts qui se sont révélés plus clairement par la suite. Comme Darbel, par ailleurs, était occupé par son métier d’administrateur de l’Insée, il ne s’est pas consacré seulement à cette enquête. Et c’est moi qui ai pris toute la responsabilité du déroulement de l’enquête, des entretiens, de leur préparation, de l’exploitation des questionnaires, etc. Jusqu’en 1968, quand j’avais un problème ou quand lui-même le souhaitait, j’en discutais avec Bourdieu ; après 1968, il n’a plus voulu en parler avec moi et j’ai continué seule. Je transmettais mes textes à Alain [Darbel], qui a beaucoup travaillé sur le premier volume. C’était une collaboration très agréable, complémentaire dans ce premier volume, parce qu’il y avait eu une enquête statistique de l’Inséé, que l’on a « reprise » sociologiquement, dans un dialogue sociologue-statisticien. Le premier volume, le plus abouti pour cette raison, est sorti en 1969. Bourdieu y a certainement jeté un œil, puisque le livre sortait dans une collection qu’il dirigeait chez Mouton, il a même dû donner quelques conseils, mais, en tout cas, la publication était en plein accord avec lui. Pour moi, j’ai beaucoup appris dans cette collaboration. On avait déjà collaboré pour l’enquête sur les musées, puisque Darbel nous avait fait le plan de sondage (dans quels musées faire l’enquête ?) ainsi que la correction des résultats statistiques. Darbel avait travaillé avec Bourdieu qu’il connaissait depuis l’Algérie, et nous avions travaillé tous les trois dans l’enquête sur les musées. Dans le second volume sur la haute administration, il y a la première partie, celle écrite par Darbel, très mathématique, je ne suis pas sûre de l’avoir comprise… Je ne suis pas sûre non plus qu’il y ait eu la même véritable collaboration sociologue-statisticien que pour le premier volume. Il me semble que le reste du volume que j’ai écrit avec l’accord de Darbel pourrait exister sans cette démonstration mathématique. Mais c’est peut-être simplement parce que je ne connais pas assez de mathématiques pour pouvoir apprécier le lien entre le premier chapitre et les autres. Le livre n’a par ailleurs eu aucun écho parce que c’était un terrain très solidement tenu par Crozier, qui connaissait tout le monde et qui était assez irritable, et que de son côté, Bourdieu s’était retiré du projet, en sorte que le livre est paru sans l’appui ni du Centre ni du prestige de Bourdieu.
Patrick Fridenson : Second point, à propos de l’enquête sur la Sécurité sociale, vous avez évoqué le Centre de recherches historiques.
Dominique Schnapper : Oui, j’y ai été rattachée après la division du Centre Aron-Bourdieu en un Centre Bourdieu et un Centre Aron… J’ai été voir Clemens Heller, avec lequel j’avais travaillé8. Je lui ai dit que je ne voulais pas intégrer le Centre Aron pour les deux raisons que je vous ai indiquées. « Qu’est-ce que vous me conseillez ? » lui ai-je demandé. Alors il m’a dit : « Vous pouvez aller voir Touraine, mais je vous conseillerais plutôt le Centre de recherches historiques ». Alors j’ai été voir Touraine, qui a été charmant, mais nous n’étions vraiment pas faits pour nous comprendre intellectuellement. C’était quelqu’un de loyal, de direct. Mais nous n’accrochions pas. Je dois dire aussi, si je peux me permettre, qu’il était quelque peu macho … Et que j’étais très timide à l’époque, et très intimidée. Bref, je n’étais pas à ma place. En revanche, le Centre de recherches historiques… Qui le dirigeait à l’époque ?
Patrick Fridenson : C’est François Furet, avec, le cas échéant, l’appui de Joseph Goy, qui devient secrétaire de la présidence de Jacques Le Goff.
Dominique Schnapper : Mais oui, Joseph Goy, que je connaissais depuis toujours, parce qu’il avait préparé l’agrégation en même temps qu’Antoine [Schnapper]. Goy m’a accueillie chaleureusement et il m’a dit : « Tu fais ce que tu veux ». Le Centre de recherches historiques (ou CRH) était un lieu très libéral, avec des gens de toutes espèces qui faisaient des choses très, très différentes. Mais là-dessus, il y a eu l’enquête sur la Sécurité sociale qui m’a rapprochée plus profondément du CRH, sur la base des débats sur les archives orales, comme je l’ai rappelé plus haut. Il y a eu un numéro des Annales9, il y a eu plusieurs colloques… Je suis restée là jusqu’en 2001, jusqu’à ma retraite. C’est à ce moment-là que je me suis rattachée au Centre Aron, qui était devenu très différent de celui qu’avait créé Furet.
On revient à ce que vous aviez évoqué, c’est-à-dire Furet, qui crée un séminaire sur le modèle du séminaire Aron. Comme je vous l’ai dit, je n’avais pas rejoint le Centre au moment de sa création après la mort de mon père. Furet me l’avait proposé, il prenait tout : il prenait les archives, il prenait Aron, il me prenait !
Patrick Fridenson : Mais donc, depuis votre rocher au Centre de recherches historiques, vous avez vu se développer les recherches politiques telles qu’elles étaient dans le Centre Aron de cette époque, avec autour de lui des gens comme Luc Ferry, Pierre Rosanvallon. François Azouvi, aussi. Par rapport à ce que vous faisiez à ce moment, en particulier l’enquête sur la Sécurité sociale dont vous avez rappelé la dimension politique, comment regardiez-vous ce qui se faisait dans ce Centre ? Aviez-vous des rapports amicaux, intellectuels, indirects, de lecture ?
Dominique Schnapper : Pas beaucoup de rapports. Des rapports personnels tout à fait détendus. Avec Alain Renaut, Philippe Raynaud, par exemple. Je venais souvent par ailleurs dans les locaux puisque toutes les archives de mon père étaient là. Il y avait aussi Mona Ozouf, si mes souvenirs sont bons.
Pierre-Antoine Fabre : J’ai retrouvé une liste de 1984, l’année de la fondation du Centre10. Et moi, ce qui m’a surpris, c’est, dans cette liste, le petit nombre de collègues de l’École...
Patrick Fridenson : En 1984, après déjà sept années de présidence de François Furet, et une initiative à l’extérieur qui a déjà fait du bruit...
Dominique Schnapper : Vous pensez à la Fondation Saint-Simon, [créée par Furet en 1982, avec Roger Fauroux], à laquelle nous avons déjà fait allusion ? Oui, c’était tout-à-fait en dehors de l’École. Quand il y a fait une séance sur le judaïsme contemporain, je venais de faire paraître mon livre11, mais il s’est adressé à Finkielkraut…
Patrick Fridenson : Ce Centre est donc en quelque sorte la fusion entre un groupe informel de lecture créé en 1977 et le Centre Aron. Il y a ainsi un moment où le cercle informel est devenu son cercle...
Dominique Schnapper : Oui, mais les deux sont liés. L’élection de Rosanvallon [comme maître de conférences en 1983] a été un maillon important. Mais à ce moment-là, Furet était président de l’École, avant son retour au travail intellectuel libre. On pourrait dire que c’est pendant sa présidence, et avec les recrutements qu’il y a portés, que la mutation s’est faite entre les deux cercles… ainsi qu'après la présidence, c’est-à-dire aussi après la mort de mon père en 1983. J’ai donc été très peu associée, au début, à l’activité du Centre sous la direction de Furet. Il faut bien ajouter qu’ensuite les évolutions de Pierre Manent (ami cher par ailleurs) ou de Luc Ferry n’étaient pas exactement les miennes…
Patrick Fridenson : Du côté de votre évolution scientifique personnelle, qu’est-ce qui vous oriente successivement à partir de cette période ? Vous avez évoqué le livre sur les Juifs...
Dominique Schnapper : Oui, un livre publié en 1980. Que je viens de rééditer12. Je me rends compte maintenant que je l’écrirais aujourd’hui autrement.
Pierre-Antoine Fabre : En quel sens ?
Dominique Schnapper : C’est un livre très sociologique, interne aux débats de ce moment-là, si vous vous en souvenez, entre les « intégrationnistes » et les « multiculturalistes ».
Patrick Fridenson : Et vous avez pris l’exemple des Juifs comme exemple de ce que pouvait être, et devait être, dans la logique républicaine, l’identité juive, en termes d’identité, de multiculturalisme et d’interrogation sur ce multiculturalisme.
Dominique Schnapper : Maintenant, je le dis dans la Préface de la réédition, je prendrais le problème beaucoup plus directement, par la citoyenneté républicaine, comme un exemple et comme une limite.
Patrick Fridenson : Donc, il y a eu l’État, la Sécurité sociale, le livre sur les Juifs et tous ces débats des années 1980, entre multiculturalisme et intégrationnisme…
Dominique Schnapper : Puis il y a eu la Commission sur la réforme du code de la nationalité [1987], qui a été pour moi un tournant parce que ça a été le premier dialogue avec les juristes. J’ai beaucoup appris parce que jusque-là, j’avais été trop « sciences sociales » et je pensais que le droit, c’était la superstructure. Le travail dans la Commission m’a fait entrer dans une perspective sociale ouverte sur le politique.
Patrick Fridenson : Je vous écoute beaucoup et d’autant plus que, comme vous pouvez l’imaginer, pour moi ou pour ma famille, ce sont des questions tout à fait vitales.
Dominique Schnapper : J’imagine, oui. Vous avez été l’intime de Pierre Hassner et j’ai toujours trouvé que vous lui ressembliez. À un point extrême, y compris dans par vos bureaux respectifs ! Pierre Hassner a fait partie de la réunion de novembre 1984 que nous évoquions tout à l’heure pour la création du Centre Furet et de la Société des amis de Raymond Aron. De cette réunion informelle, car Hassner n’a jamais quitté Sciences Po. Au moment de la création du Centre Aron la question s’est posée, en vain. Mais Furet est resté avec lui dans une relation amicale, comme avec Jean-Claude Casanova, qui était lui aussi à Sciences Po.
Patrick Fridenson : Revenons aux juristes. Vous nous avez expliqué que les travaux de la Commission sur la nationalité avaient été orientés par les juristes.
Dominique Schnapper : En partie seulement. Parce qu’il y avait aussi les hauts fonctionnaires, qui sur toutes ces questions avaient et ont toujours une expérience et une pratique précieuses.
Patrick Fridenson : Puis-je vous demander, tout à trac, comment vous voyez, en tant que sociologue, et, si j’ose dire, en tant que vous-même, cette pratique des hauts fonctionnaires évoluer dans la période ?
Dominique Schnapper : Pour ceux qui étaient là, dont une partie sont morts maintenant, ils apportaient, je le répète, essentiellement une expérience pratique. Ils étaient réellement ouverts. Je me souviens d’Isabelle Renouard, qui était une descendante de Lucien Herr. Ses exposés étaient d’une qualité intellectuelle et d’une clarté que j’ai vraiment admirées. Et je trouvais que par rapport à beaucoup de gens des sciences sociales dont la rigueur et la clarté ne sont pas la caractéristique première… Ils avaient les limites de leur connaissance, mais la discussion les a fait avancer. Ce qui a été remarquable dans cette commission, c’est que non seulement Chaunu et Touraine, qui avaient des avis au départ très différents, se sont réunis pour faire des propositions mais que les hauts fonctionnaires ont accepté de prendre en compte le point de vue des historiens et des sociologues. La base commune de la relation entre les deux groupes, c’était : que faut-il faire ? C’est pour cela que j’en suis restée avec un livre « rentré », l’analyse manquait, et d’une certaine façon ce manque m’a conduite à m’intéresser à ce que c’était que la France de l’intégration, ce qui n’était pas l’objet de la commission, et à publier l’ouvrage La France de l'intégration.
Patrick Fridenson : C’est donc bien, en effet, cette Commission qui vous a fait avancer ensuite.
Dominique Schnapper : Oui, oui, ça a été vraiment un tournant. Le problème politique était déjà là avec le multiculturalisme, l’interrogation sur le multiculturalisme, les identités particulières, mais je l’ai formulé ensuite dans des termes beaucoup plus politiques, au lieu d’en rester à des termes culturels, sur le mode anthropologique des emprunts et des effets des cultures. J’avais fait cela dans mes premiers travaux sur la culture italienne13, puis sur la culture des Juifs, tandis qu’à partir de ce moment, j’ai essayé de formuler une interrogation de fond sur la notion de nation républicaine14. C’est à ce moment-là que s’est développé le débat sur le multiculturalisme. J’étais en désaccord avec Touraine, qui « faisait » du multiculturalisme. Un débat sociologique et politique qui, curieusement, a cessé aujourd’hui alors que le problème reste entier. Mais ce n’est plus d’actualité.
Patrick Fridenson : Ce débat-là était-il présent à l’intérieur du Centre Aron, justement ?
Dominique Schnapper : Non, pas beaucoup, me semble-t-il. C’est surtout autour du groupe Touraine que le débat sur ce sujet se déroulait à l’École. Je me souviens aussi d’une conversation avec Christophe Prochasson hostile à la loi de 200415. L’École dans son ensemble, spécialisée ou non, était de sensibilité multiculturaliste. C’était dans l’atmosphère générale des sciences sociales… La laïcité, elle, était à l’EPHE avec Jean Baubérot. Ce n’était pas un sujet qui intéressait l’École. Or c’était un sujet politique. Là, on était vraiment dans le politique.
Patrick Fridenson : Oui, c’est pour ça que je posais la question de la résonance de ce débat au Centre Aron.
Dominique Schnapper : Je n’ai pas le souvenir que les gens du Centre Aron aient participé à ce débat, qui animait la sociologie et les sciences politiques. Eux, ce qu’ils voulaient faire, c’était, enfin, faire et faire reconnaître la philosophie politique. Ils disaient : « il n’y a pas de philosophie politique à Sciences Po, donc… ». Et donc moi, avec mon côté sociologue, un peu lourd, je ne les intéressais pas.
Patrick Fridenson : Avez-vous eu des relations avec un collègue, mort récemment, pour qui, personnellement, j’avais beaucoup de sympathie, Bernard Manin16?
Dominique Schnapper : Très peu. Je ne l’ai quasiment pas connu. Je cite toujours son livre sur le régime représentatif, parce que je trouve qu’il a établi un point que l’on peut considérer comme un acquis, sur la double dimension démocratique et aristocratique du système représentatif. Son travail est définitif là-dessus. Mais à l’époque, il était à Sciences Po.
Patrick Fridenson : Il était à Sciences Po, mais il est venu ensuite à l’École.
Dominique Schnapper : Oui, mais plus tardivement.
Pierre-Antoine Fabre : À l’École où, sous la présidence de Danièle Hervieu-Léger, il était le théoricien de nos pratiques électorales…
Dominique Schnapper : Il venait de la science politique, mais une science politique plus intellectuelle et plus profonde que ce que l’on faisait en général à Sciences Po. Mais enfin, il en venait. Ce qui n’était pas du tout le cas des gens du Centre Aron. Non, l’idée de Furet, c’était vraiment la philosophie politique : Alain Renaut, Luc Ferry, Philippe Raynaud, que nous avons déjà cités, tous agrégés de philosophie. C’était ce qui animait Furet – il faut y ajouter un versant immédiatement politique : le rapport centre gauche-centre droit, la démocratie du milieu, qui était inscrit dans le projet.
Il n’en reste pas moins deux choses à préciser. La première, c’est que son livre sur le communisme17, qui est encore aujourd’hui un très grand livre, a été relativement tardif. C’est un livre qui s’inscrit dans l’histoire, et pas qu’un peu, mais qui est complètement imprégné moins par la science politique que par la politique. Parce que finalement, ce qu’on fait le plus souvent dans la science politique, les partis, le vote, etc. ne l’intéressait pas tellement. Ce qui l’intéressait, c’étaient les grands choix politiques. Donc la politique plutôt que la science politique. Et puis il y avait une autre dimension de sa carrière intellectuelle, c’était la croisade contre le totalitarisme sous toutes ses formes. C’était l’essentiel de ce Centre. Ni celui de la science politique ni les sciences sociales, mais la philosophie politique et le grand choix politique de l’antitotalitarisme.
Patrick Fridenson : Mais quand Rosanvallon devient directeur de ce Centre, l’orientation change. Et là, avez-vous des relations avec cette orientation de Rosanvallon ou pas du tout ?
Dominique Schnapper : Pas du tout. Ni avec Rosanvallon, ni avec Pierre Manent (sauf très personnelles). Pierre n’est pas vraiment un républicain de mon style.
Patrick Fridenson : À ce moment-là, est-ce que vous avez encore une relation avec Sciences Po, soit par les personnes, soit par l’enseignement ?
Dominique Schnapper : Non. La famille a toujours été dans de très mauvaises relations avec Sciences Po.
Pierre-Antoine Fabre : Vous avez dit tout à l’heure que...
Dominique Schnapper : Oui, j’y ai été maître de conférences pendant 5 ou 6 ans, tout le monde était maître de conférences à Sciences Po. Là-dessus, le directeur a voulu créer un cours de sociologie... Il y avait Jacques Lautman et moi. Il l’a confié à Lautman. Mais ça a été un échec et il n’y a plus eu de cours de sociologie. Il n’y a plus eu que les cours spécialisés de Crozier. C’est curieux, de génération en génération, on aurait tous pu se retrouver dans cette maison. Et on s’y est toujours trouvé très mal. Alfred Grosser m’avait proposé de venir lui servir de petite main à Sciences Po quand j’avais 23 ans. J’avais refusé parce que je n’avais pas pour lui l’admiration nécessaire pour vouloir, même à 23 ans, lui servir de petite main.
Patrick Fridenson : Je voudrais revenir maintenant sur un autre point : la République. C’est de côté-là que vous vous orientez par les diverses voies que vous venez d’évoquer. Depuis ma vie d’historien, je pense inévitablement à André Siegfried, mais pas seulement. Comment voyez-vous ce que vous avez fait sur la République ?
Dominique Schnapper : Je dirai, rétrospectivement, que j’ai essayé de fonder sociologiquement la défense de la République ; de dire ce que c’était qu’une République qui, avec sa vocation universelle, permet le maintien des spécificités dans son sein. Donc non seulement ces spécificités existent, mais c’est la vocation universelle de la citoyenneté que d’en permettre le maintien. La République est toujours critiquable, et elle est critiquée, à juste titre, mais il y a un dévoiement de toutes les sciences sociales, et en particulier des sociologues, qui consiste à dénoncer à juste titre les dévoiements de la République sans pour autant défendre son principe. C’est ce que j’ai essayé de faire : la critique des dévoiements, la défense du principe. Vous évoquez Siegfried, qui était plutôt antisémite, défendait la République, la Troisième République contre l’aristocratie, contre l’Ancien Régime. Dans ma génération, ce qui importait, c’était la défense de la République contre les... totalitarismes. Du multiculturalisme, de la critique des inégalités, du monde ambiant de la critique dans sciences sociales, je ne nie ni la réalité ni la légitimité de la critique, mais je pense que tout cela laisse échapper l’essentiel, ce qui me marginalise.
Pierre-Antoine Fabre : Ce que j’aimerais beaucoup savoir, pour ce qui me concerne, c’est comment vous percevez l’École, en général, du point de vue des « aires culturelles ».
Dominique Schnapper : L’un des apports de Clemens Heller, et il y en a eu beaucoup, a été ce sujet des aires culturelles et plus largement de l’internationalité ; ce qui a été aussi le fait du rôle des anthropologues dans la création de l’École, ou plus précisément de l’alliance entre anthropologues et historiens qui est au fondement de l’École, et qui conduisait à la dimension internationale de l’École. Ainsi l’École a été « multiculturaliste » par les disciplines. De ce point de vue-là, d’ailleurs, ce qui est notable dans le Centre Aron, puis Furet, avant ou avec Furet, c’est qu’il y a des spécialistes d’espaces non européens, Gilles Bataillon par exemple, mais que les questions politiques qu’on traite sont des questions générales et qu’il y a eu le souci partagé de ne pas localiser les aires culturelles comme de simples terrains d’enquête, mais au contraire d’en faire le lieu d’une interrogation politique plus fondamentale.
Pierre-Antoine Fabre : Oui c’est exactement dans ces termes que Joachim Nettelbeck, dans un chapitre de ce même Atelier18, résume la conception « hellerienne » des aires culturelles.
Dominique Schnapper : Clemens Heller, qui était un grand bonhomme, a bien posé la question. Et Louis Dumont est ici « idéaltypique ». Il est parti de l’anthropologie de l’Inde et il a construit autre chose. Mais en dehors de Louis Dumont... ? Louis Dumont n’est-il pas plutôt l’exception que la règle ? Cela reste en tout cas un grand projet. Les anthropologues font tous des travaux utiles en nous racontant ce qui se passe dans le monde et les meilleurs d’entre eux développent un grand projet intellectuel à partir de cette connaissance. Françoise Héritier, notamment dans ses travaux sur les femmes et la violence, Philippe Descola, ont eu cette ambition. Le laboratoire de Lévi-Strauss s’était d’ailleurs construit autour de cette idée. Dumont se référait à Lévi-Strauss. Mais, comme lui, il s’intéressait assez peu au monde contemporain. Mon matériau à moi, c’est le monde contemporain. Mon point de vue n’est ni historique ni anthropologique. Bien que je sois plus historienne que la majorité des sociologues…
Patrick Fridenson : Marc Augé sur le second versant de sa présidence, entre 1992 et 1995, s’est intéressé à ce qu’il appelait l’anthropologie du contemporain.
Dominique Schnapper : Oui. Des anthropologues sont venus sur le terrain du contemporain. Je vais être franche, je ne trouve pas que ce soit très intéressant.
Patrick Fridenson : C’était un pari...
Dominique Schnapper : Autant un anthropologue, même modeste, qui vous raconte ce qui se passe dans les lointains est très utile parce qu’il nous apporte de l’information, autant sur le contemporain, sur notre propre expérience, il n’apporte guère d’information. L’exigence est donc décuplée. Cela dit, le problème des anthropologues, c’est que leur terrain exotique s’évanouit.
Patrick Fridenson : Vous avez évoqué Clemens Heller. Ce qui reste une des forces de l’École, c’est-à-dire ce grand réseau d’invitations, de relations internationales, avant que ce soit institutionnalisé, c’était son inspiration. Mais même après, il reste le fait que l’École a 120 mois d’invitations par an, ce qui n’est le cas d’aucune autre institution… Qu’avez-vous retiré de cette capacité internationale de l’École ?
Dominique Schnapper : Personnellement, pas grand-chose, mais c’est de ma faute. Parce que je déteste voyager ! Je ne suis allée nulle part, j’ai refusé toutes les invitations. Il y a d’ailleurs très longtemps qu’on ne m’en fait plus, d’une part à cause de mon âge, d’autre part parce que tout le monde sait que je ne me voyage pas. Je n’en ai pas tiré profit, mais c’est uniquement de ma faute. Il y a quand même une exception : en 1991. Je venais de sortir La France de l’intégration. Il y a eu une demande des anthropologues israéliens demandant que quelqu’un de l’École vienne à leur rencontre annuelle (ou biannuelle). Et comme l’École était déjà assez propalestinienne, tout le monde avait refusé. C’était sous la présidence de Marc Augé. Finalement, on m’a sollicitée. Et là, j’ai accepté parce que ce n’était pas possible que l’École n’envoie personne aux anthropologues israéliens. Et ça a été absolument formidable pour moi. Avec l’aide de Nancy [Green]19, c’était en anglais évidemment, je leur ai raconté qu’ils étaient tous multiculturalistes puisque la plupart d’entre eux travaillaient dans des universités américaines qui étaient unanimement multiculturalistes à l’époque. Je leur ai dit que je ne pouvais pas leur parler de leurs problèmes, mais que j’allais leur dire comment la nation française s’était faite, et qu’ils en tireraient les conséquences qu’ils voudraient. Et donc je leur ai résumé en trois quarts d’heure La France de l’intégration. Comme j’ai été élevée en Angleterre, le président de l’Association invitante est venu me dire : « Votre anglais est merveilleux, parce que c’est de l’anglais et pas de l’américain. Et votre exposé était passionnant. Je suis à 95 % en désaccord avec vous et avec votre théorie ». Je lui ai répondu : « Pourquoi à 95 % seulement ? ». Et je me suis dit : mais finalement, dans La France de l’intégration, il y avait une théorie implicite que je n’ai pas fait apparaître. C’est pourquoi j’ai décidé de formuler cette théorie, ce qui m’a fait écrire La Communauté des citoyens20, qui est, je crois, le livre qui a marqué ma carrière. La vertu avait été récompensée… Heureusement, parce que ce voyage avait été pour moi horrible, je n’ai pas dormi pendant deux nuits, un vrai cauchemar. C’est donc grâce au président de l’Association des anthropologues israéliens que ce livre est né, et aussi parce que tous les collègues de l’École avaient refusé d’aller parler aux Israéliens.
Pierre-Antoine Fabre : C’est un débat qui a déchiré l’Assemblée des enseignants de l’École encore toute la saison dernière…
Dominique Schnapper : Je dois ajouter au sujet des voyages que je suis aussi allée une fois aux États-Unis21, mais ce n’était pas une invitation de l’École. Encore qu’elle ait eu des conséquences pour l’École… J’y ai en effet rencontré Mary Douglas. J’avais lu ses livres, que j’admirais beaucoup. Je l’ai invitée… Elle est arrivée à Paris et elle m’a dit : « Où voulez-vous être invitée ? » Elle était très surprise que je ne veuille aller nulle part !
Patrick Fridenson : Je vous écoute parler de Mary Douglas...
Dominique Schnapper : Oui, c’est bien moi qui l’ai fait venir. C’est ma seule gloire de ce côté-là !
Patrick Fridenson :… avec pas mal de surprise parce que moi, Mary Douglas, c’est Maurice Godelier qui un jour m’a pris par l’épaule dans un couloir et m’a dit : « Tu devrais lire Mary Douglas ».
Dominique Schnapper : Et vous l’avez fait. Et vous êtes de cet avis.
Patrick Fridenson : Je suis de cet avis, qui n’a qu’un intérêt très modeste, mais j’en ai ensuite nourri des générations de doctorants et d’habilitants. Mais je suis aussi frappé de que vous dites parce que sur le fond, c’était quelque chose dont le contenu manquait profondément à l’École.
Pierre-Antoine Fabre : et qui est peut-être même l’un des enjeux du livre qui s’écrit à plusieurs voix dans cet Atelier…
Patrick Fridenson : Oui ! Ainsi pensent les institutions (son premier titre). Un livre tout à fait vital.
Pierre-Antoine Fabre : Un livre extraordinaire qui avait été traduit en 1989 dans une collection qui était codirigée par Louis Marin et Marc Grinsztajn, chez un éditeur qui a ensuite péri assez rapidement, qui s’appelait d’un nom qui lui a porté malheur : Usher. C’est un livre qui pour moi a été un livre décisif pour tout mon travail sur l’institution religieuse.
Patrick Fridenson : Le livre est reparu dix ans après, heureusement, et dans une version remaniée, de même que le titre22. Tout cela est très intéressant aussi du point de vue de l’évolution de la culture des historiens de l’École. Il y a eu dans les années 1980 le tournant passionnant de la microhistoire, avec tout ce que les Français ont emprunté aux Italiens. Et dans ce courant de la microhistoire, les institutions étaient devenues très ténues. C’étaient Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Carlo Poni, Franco Ramella, Alessandro Portelli. Des institutions on approchait seulement par une microanalyse.
Dominique Schnapper : Et on était près de ce que je rappelais plus haut du droit comme superstructure. De ce point de vue-là, Mary Douglas nous a un peu tous remis sur pied.
Pierre-Antoine Fabre : Je voudrais revenir sur un point sur lequel vous êtes passée très rapidement et qui pour nous, pour cet Atelier, est important, parce que c’est un projet dans lequel aussi on voudrait aider à faire connaître les archives de l’École, ou en tout cas à en faire vraiment un lieu de travail. Vous êtes passée rapidement sur le fait qu’en 1984 vous aviez donné les archives de votre père au Centre Aron, c’était alors une démarche pas ordinaire du tout, et que bien des années plus tard, aujourd’hui encore, quand s’est créé le Centre d’archives en sciences sociales du campus Condorcet, attaché à la bibliothèque du Campus ou Humathèque, c’était précisément la manière de finalement concentrer les archives des collègues de l’École ou rattachés à l’École d’une manière ou d’une autre. Votre décision n’était donc pas banale du tout, puisqu’aujourd’hui encore, on court après les archives d’un certain nombre de nos collègues. Louis Marin est à l’IMEC. Il y a un éparpillement extraordinaire. Une partie du fonds d’Émile Poulat est à Nantes. Je cite Poulat parce qu’il y a des discussions en cours pour le faire revenir et réunir l’ensemble du fonds… Cependant le fonds Pierre Bourdieu a été donné en dépôt à l’Humathèque en 2020 et est ouvert à la communication, sous conditions, depuis 2022.
Dominique Schnapper : Il y a eu un premier dépôt et je vais donner le reste. Je me suis retrouvée à un moment devant une sorte d’Himalaya, l’héritage intellectuel de mon père. Ses mémoires venaient de paraître23. Le livre était sorti en septembre et il est mort le 17 octobre. Il avait un bureau au 54 [bd Raspail] rempli de papiers, un monstre. Furet, qui a eu beaucoup de délicatesse, avait attendu mon retour au mois de janvier (je séjournais à Princeton, non pas, je le précise, de mon fait mais parce que j’accompagnais Antoine [Schnapper] : je ne me contredis donc pas !). Il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas jeter cela. C’était intéressant. D’autant plus qu’il avait justement remué tous ces documents pour rédiger ses mémoires. Il s’est formé tout de suite un petit groupe d’amis fidèles. Bernard de Fallois, Pierre Hassner, Jean-Claude Casanova, Stanley Hoffmann, Antoine et moi. Je n’étais pas seule. C’est dans ce groupe que la décision a été prise. Il fallait un classement d’urgence de ces archives. C’est un document historique. Elles sont désormais déposées à la Bibliothèque nationale de France (BNF). Je dois donner une autorisation que je donne à tous les chercheurs, quels qu’ils soient. Ce que je ne voulais pas, c’était un usage journalistique incontrôlé. L’inventaire a donc été fait à l’École par Elisabeth Dutartre24, qui est, je tiens à le dire ici, une personne très exceptionnelle. C’est grâce à son intelligence et à son travail que le fonds est ce qu’il est. Au début, avec les financements qu’on a pu trouver : un petit peu de la MSH, d’une fondation américaine, un petit fonds allemand par Heinz Wissmann. J’avais recruté Elisabeth par Maud Espérou qui dirigeait alors la bibliothèque de la MSH. Je lui avais demandé quelqu’un qui puisse s’occuper des archives de mon père. Et elle m’a envoyé Elisabeth, nous sommes restées très liées depuis lors…
Pierre-Antoine Fabre : Et le choix de la BNF ?
Dominique Schnapper : Antoine trouvait alors que les Archives nationales fonctionnaient très mal. À la BNF il y avait déjà Sartre, Jouvenel. Les « petits camarades » se retrouvent pour les chercheurs…
Pierre-Antoine Fabre : Je voulais revenir aussi à la question du religieux, par laquelle on est passé via Mary Douglas, mais sur quelque chose qui nous occupe beaucoup en ce moment. Je dis « nous », membres du Centre d’études en sciences sociales du religieux, puisqu’on opère un rapprochement progressif avec l’actuel CESPRA, et j’aimerais savoir comment vous percevez le fait que cet ancien Centre Furet, donc dominé par la philosophie politique, comme vous nous l’avez rappelé, et par la politique tout court, a été à ce point habité par des spécialistes du religieux, qui ont tout de même joué un grand rôle, que ce soit Gauchet, Manent, Catherine Maire à sa manière, enfin c’est un centre dans lequel le religieux est très présent. Est-ce que, si on fait de la philosophie politique, on touche forcément au religieux ? Il me semble que cette question est liée à la réflexion philosophique sur le politique et à sa spécificité, que vous avez mis beaucoup de soin à préciser, même à distance.
Dominique Schnapper : Oui, tout à fait. Cela s’impose intellectuellement. L’humanité contemporaine – en Europe tout au moins – se caractérise par la volonté de séparation du politique et du religieux, mais c’est exceptionnel dans l’histoire humaine, et, sans même se placer dans une position anthropologique, les deux sont, il me semble, très étroitement liés. Sur le religieux, beaucoup de travaux sont passés par l’analyse sociologique des pratiques, avant d’entrer dans le vrai problème du religieux. Et quand on y entre, on tombe dans la philosophie politique. De la même manière que le travail sur le politique a été très marqué par le vote, dans la lignée de Siegfried que nous avons évoqué plus haut, le religieux a longtemps été marqué par la mesure de la fréquentation de la messe. Mais quand le problème du « religieux » soulève les grands problèmes de la vie sociale, c’est nécessairement du politique. Et c’est intéressant que cela fasse totalement partie de ce Centre, mais finalement d’une façon explicite. Cela ne l’était pas à l’origine, parce que ce n’était pas le problème de Furet. Le religieux est arrivé, je dirais négativement avec Gauchet et positivement avec Manent.
Pierre-Antoine Fabre : Oui, mais le totalitarisme comme religion civile n’était-il pas d’une certaine façon travaillé par la question du religieux ? Oui, comme religion séculière, comme dévoiement du religieux : négativement, là encore ; tout à fait négativement. Alain Besançon, qui était catholique et a fait partie aussi du Centre à son début, avait des relations personnelles avec Furet, mais il me semble que le religieux était alors perçu du côté d’une sociologie des pratiques. Ce qui reste très intéressant, c’est cette trajectoire à partir du communisme (pour Furet, pour Le Roy Ladurie et d’autres), qui passe par une approche négative des religions séculières, et finalement une approche positive à partir de la philosophie politique. Il y a vraiment une ligne qui traverse toute l’histoire de ce Centre.
Dominique Schnapper : Oui, c’est tout à fait étrange, très loin maintenant du projet Furet, ce qui est la vie normale des Centres de recherche. Ils se créent autour de quelques personnalités et d’un projet. Quand le projet change, les personnalités ne sont plus les mêmes, et le projet se transforme progressivement…
Pierre-Antoine Fabre : C’est vrai, mais je pense, en même temps, que l’une des raisons de l’intérêt des responsables actuels de l’ancien Centre Furet pour des relations renforcées avec le Centre d’études en sciences sociales du religieux (CeSor), c’est qu’ils savent bien que cela fait partie de leur héritage.
Dominique Schnapper : J’espère, oui, parce que c’est vrai.
Pierre-Antoine Fabre : Mais c’est vrai aussi que la plupart des gens qui, dans le Centre Furet, se sont intéressés au « religieux » sont pratiquement maintenant tous retirés, même s’ils restent très actifs… : Marcel Gauchet, Catherine Maire, Vincent Descombes, Pierre Manent…La génération d’après est elle-même sur le départ : Audoin-Rouzeau, Duclert… Audoin-Rouzeau était peut-être celui qui touchait le plus encore à la question du religieux à partir de son approche de la Grande Guerre.
Dominique Schnapper : Oui, mais c’est le problème qui est au cœur dans son affaire, c’est l’anthropologie la guerre, l’anthropologie de la guerre, ce qui est vrai aussi, d’une certaine manière, pour le Rwanda…
Pierre-Antoine Fabre : C’est, me semble-t-il, dans l’approche de la vie ordinaire des soldats pendant la Première Guerre que le religieux surgit, dans les objets, souvent, ou dans les lettres…
Dominique Schnapper : Oui, c’est vrai.
Patrick Fridenson : Je n’ai plus de questions immédiates, et je trouve que vous nous avez beaucoup apporté…
Dominique Schnapper : J’espère. Merci à vous deux !
Notes
1
Dominique Schnapper a été membre du Centre de sociologie européenne (CSE) jusqu’en 1972 mais n’a pas été membre du Centre Aron, devenu le CESPRA, avant 2003.
2
Alain Darbel (1932-1975), statisticien, sociologue, membre du CSE, publie avec Pierre Bourdieu et Dominique Schnapper L’Amour de l’art : les musées d'art européens et leur public en 1966, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Éditions de Minuit, 1969.
3
Alain Darbel et Dominique Schnapper, Morphologie de la haute administration française, t. I : Les Agents du système administratif, Paris-La Haye, Mouton, 1969, t. II : Le Système administratif, 1972.
4
Le Comité d’histoire de la Sécurité sociale est fondé en 1973. Il est présidé par Pierre Laroque. Il soutient l’idée d’une campagne d’archives orales formulée par le cofondateur du Comité, Guy Thuillier. Cf. Florence Descamps, Archiver la mémoire. De l’histoire orale au patrimoine immatériel, Paris, Éditions de l’EHESS, 2019, p. 63-66.
5
Raymonde Moulin (1924-2019), directrice d’études à l’EHESS. Le Marché de la peinture en France, son doctorat dirigé par Raymond Aron, a été publié aux Éditions de Minuit en 1967.
6
Florence Descamps, « Réformer l’administration par les sciences sociales. Les tentatives pionnières du ministère des Finances (1965-1972) », Le Mouvement social, n° 273, 2020, p.35-56.
7
Enquête préparatoire à L’Amour de l’art : les musées d'art européens et leur public en 1966, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Éditions de Minuit, 1969.
8
Voir l’intervention de Dominique Schnapper dans l’Hommage à Clemens Heller (1917-2002) tenu le 27 novembre 2002 à la MSH, p. 30.
9
« Archives orales : une autre histoire », Annales ESC, vol. 35, n° 1, 1980, p. 124-199. Dominique Schnapper y publie, avec Danièle Hanet, « D'Hérodote au magnétophone : sources orales et archives orales », p. 183-199.
10
Le Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA), le plus souvent appelé ici Centre Aron, deviendra en 2024 le Centre des Savoirs sur le Politique - Recherches et Analyses, tout en conservant le même acronyme, phénomène peu fréquent et qui rend compte des continuités et discontinuités entre les deux centres.
11
Dominique Schnapper, Juifs et israélites, Paris, Gallimard, 1980.
12
Dominique Schnapper, Juifs et israélites : fidélité au judaïsme et citoyenneté, Paris, Gallimard, 2025, avec une préface inédite.
13
Dominique Schnapper, L’Italie Rouge et Noire, Paris, Gallimard, 1971 ; Sociologie de l'Italie, Paris, PUF, 1974.
14
Dominique Schnapper, La France de l’intégration, sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Sciences Humaines », 1991.
15
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
16
Bernard Manin (1951-2024), spécialiste de la social-démocratie et de la démocratie représentative. Voir l’atelier qui lui est consacré coordonné par Luc Foisneau et Philippe Urfalino, « Penser la politique avec Bernard Manin », Politika, 2025.
17
François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, Paris, Éditions Robert Laffont et Éditions Calmann-Lévy, 1995.
18
Voir Joachim Nettelbeck, Patrick Fridenson, Pierre-Antoine Fabre, « L’EHESS et la Maison des sciences de l’homme : perspectives institutionnelles et contextes internationaux », dans l’atelier « Une histoire : l’École des hautes études en sciences sociales », Politika, 2025.
19
Nancy Green, directrice d’études à l’École, spécialiste de l’histoire des migrations américaines et en particulier des migrations juives
20
La Communauté des citoyens, sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 1994.
21
À Princeton. Voir plus loin.
22
Comment pensent les institutions, édition remaniée, Paris, La Découverte, 1999, rééd. 2004.
23
Raymond Aron, Mémoires. 50 ans de réflexion politique, Paris, Éditions Julliard, 1983.
24
Elisabeth Dutartre-Michaut, ingénieure de recherche, responsable de ressources documentaires du Centre Aron puis du CESPRA, a ensuite joué un rôle déterminant dans la gestation de l’Humathèque du Campus Condorcet et singulièrement de la conception de cette Humathèque entre bibliothèque et archive. Elle avait l’expérience de l’une et de l’autre.