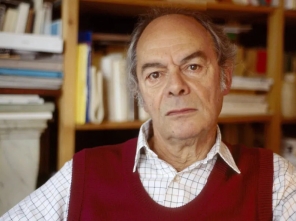(EHESS - Centre d'études sociologiques et politiques Raymond-Aron - CESPRA)
Un penseur « aux aguets »
Pour ses lecteurs, des plus laudateurs au plus critiques, Claude Lefort est perçu sous les traits non seulement d’un penseur du politique, mais comme une des figures centrales dans le mouvement de remise à l’honneur du Politique qui travailla le monde intellectuel français dans les années 1970. Si beaucoup de ses commentateurs se sont attachés à scruter au plus près sa conception du Politique et à débattre des évolutions de sa pensée sur le totalitarisme, l’idée de révolution, ou la démocratie, très rares sont ceux qui, comme Pierre Pachet ont su capter combien Claude Lefort fut un penseur « aux aguets » des événements politiques et combien cette attention aux événements fut une expérience au fondement de son œuvre de pensée.
Dans un remarquable essai de 2012 consacré au texte sans doute le plus connu de Claude Lefort, « Droits de l’homme et politique1 », Pierre Pachet pose une question simple et centrale sur sa façon de penser le Politique : « Lefort a-t-il créés des “concepts” ?2 ». Et il y répond fort subtilement, si subtilement qu’il me faut le citer un peu longuement :
« En y repensant, avec scepticisme, ou hésitation, je me disais que sans doute des formules qu’il a souvent employées (“le lieu vide du pouvoir” par exemple) qu’il a reprises lui-même et qui ont été reprises par d’autres, en sont venues à symboliser ou représenter sa pensée. Je n’y vois pas des concepts, plutôt des moments auxquels il est arrivé dans l’élaboration de sa réflexion, laquelle me semble mue pour l’essentiel par des réactions à des situations, des expériences et finalement des innovations qui ne se sont pas seulement affirmées dans le domaine des écrits, mais qui ont aussi surgi de la vie sociale, en particulier des pays de l’Est, avec des formes nouvelles de résistance au pouvoir, de communication entre les hommes ainsi que des objectifs nouveaux inattendus (…). »
Il met ensuite en valeur un autre trait de la pensée de Claude Lefort qui n’est pas moins important :
« S’il y a une productivité, une vitalité de la pensée de Lefort dans ces années-là (les années 1980), elle tient à sa sensibilité à ce qui peut surgir constamment de nouveau dans l’Histoire et dans la vie sociale ».
On retrouve dans le propos de Pierre Pachet une attention extrême à une forme de pensée que Claude Lefort avait mise à l’honneur dans un texte incisif et intriguant, « Philosophe ?3 », où il s’efforçait de s’interroger sur sa propre « œuvre de pensée » et sur la façon dont celle-ci s’était construite au fil de ses écrits comme de son activité de professeur. Claude Lefort commençait par noter que la question qui lui était posé sur son statut de philosophe « l’avait mis dans l’embarras ». La réponse impliquerait, précisait-il « qu’elle tenait pour acquis quelques chose qui n’allait pas de soi ». Et il faisait immédiatement deux précisions importantes. La première était qu’« il ne goûtait guère que l’on parle de lui comme d’un sociologue ou d’un politologue, sous prétexte que ma réflexion s’est largement exercée sur des faits sociaux et politiques. (…) ». La seconde était qu’il lui avait « toujours importé de préciser que (ses) démarches ne relevaient pas de ce que l’on appelle les sciences humaine4 ». Mieux que « se déclarer philosophe » consistait « à revendiquer la possibilité d’une interrogation qui s’émancipe, non plus de l’autorité de la religion, mais de celle des sciences, notamment des sciences humaines5 ».
S’interrogeant ensuite, en référence à ses réflexions sur Les Deux corps du roi de Kantorowicz, son va-et-vient entre l’en dessous de lui, qu’était son statut de professeur, et cet au-dessus de lui, qu’était la figure du philosophe-roi, qu’il récusait, il évoquait des œuvres dont il s’était senti proche et qui n’était pas des œuvres de philosophie, mais des « œuvres hybrides », notamment celle de Quinet. Il faisait à ce propos une remarque qu’il convient de garder en tête : l’appel de ce dernier à « l’héroïsme de l’esprit » était une formule qui « lui parlait ». « Elle était faite pour célébrer le risque d’une recherche sans modèle, affranchie de l’autorité du savoir établi ; pour revendiquer la démesure d’un désir de penser, par-delà la séparation des disciplines de connaissance, en quête de vérité6 ». Ces propos de Quinet dans son drame épique Les Esclaves, poursuivait-il, le ramenaient à la Boétie, et « témoignaient d’un lien entre l’exigence philosophique et l’exigence politique ; entre une exigence de pensée, qui prend en charge une interrogation sur l’essence même du penser, et une exigence d’intervenir sur la scène publique, par la parole ou par l’action, peu importe, qui prenne en charge notre rapport à ce que l’on appelait autrefois la cité – lien qui m’a toujours paru intranchable7».
Il convient de noter que ces historiens philosophes qu’affectionnait Claude Lefort – Michelet (1798-1874) et Quinet (1803-1875), Tocqueville (1805-1859) et Ballanche (1776-1847) – et bien sûr Marx qu’il ne cessa jamais d’interroger, étaient des écrivains politiques pour lesquels la Révolution française était une question qui les interpellaient et les amenaient à s’interroger pas seulement sur le sens de l’Histoire et les événements qui la tissaient, mais d’une façon inextricablement liée à leur propos d’historiens, sur la façon dont se construisait un ordre politique libre ou, au contraire, sous couvert d’émancipation, se construisaient de nouvelles formes de servitudes. Le rapport noué par Merleau-Ponty à la question du marxisme ou à celle de la nature du communisme et de l’expérience soviétique fut du même ordre. Et on peut faire la même remarque avec cet autre écrivain politique qui fut sans doute celui que Lefort fréquenta le plus durablement, Machiavel. Il fut l’observateur passionné des principautés de son temps, pas seulement de Florence, et un lecteur de Tite Live scrutant l’histoire romaine chez qui le souci de penser ne sépara jamais de celui d’agir.
L’indétermination de l’action et de l’œuvre.
Une autre particularité de travail intellectuel de Claude Lefort fut son souci constant d’intervenir dans le débat public en tant qu’intellectuel. Une vision convenue de son histoire politique consiste à opposer ses années « militantes », les années où il fut membre du Parti communiste internationaliste (PCI) puis du groupe Socialisme ou Barbarie (1943-1958), et enfin de ce groupuscule que fut Informations et liaison ouvrières (1958-1960) aux années postérieures où il se serait détaché de tout action militante pour n’être qu’un universitaire, certes attentif au débat public, mais en retrait de toute action militante. Une telle affirmation doit être nuancée. Si à partir des années 1960, Claude Lefort n’eut plus d’activités militantes, au sens où il ne fut plus membre d’une organisation politique, il n’en fut pas moins un intellectuel engagé. Il fut, avec son ami René Collet, un membre actif du Cercle Saint-Just pendant la guerre d’Algérie et au début des années 19608. Il participa à la même époque à des réunions du Centre d’études socialistes. Il fut très présent à la faculté des lettres de l’université de Caen en mai 1968. Les années 1970 et les années 1980 le virent dialoguer avec la revue Esprit et la CFDT pour appuyer les dissidents du bloc soviétique, tout comme avec des intellectuels brésiliens parties prenantes de la fondation du Parti des travailleurs. Il fut de la même façon le président du Comité pour la défense de Salman Rushdie (1995-1996)9ou proche du comité Kosovo à la fin des années 1990.
Par-delà ces oublis d’expériences qui ne furent point anodines pour Claude Lefort, un tel point de vue me semble passer à côté de ce que fut pour Claude Lefort, l’action militante et l’engagement politique. Comme il l’expliqua lui-même en 1975 dans un long entretien avec la revue L’Anti-Mythes10, il fut dès sa sortie du PCI, à la différence de Castoriadis, peu soucieux de construire une « organisation », et fut d’emblée « réticent à l’égard de ce tout ce qui pouvait apparaître comme un nouveau Manifeste, une conception programmatique », même si, comme il le reconnut dans cet entretien, il peinait à l’époque à tirer toutes les conclusions qui pouvaient découler de ces premiers constats où il reprenait à son compte la critique, formulée par Merleau-Ponty, à l’encontre « de toute prétention à occuper le lieu du savoir absolu ou à tenir un discours sur la totalité 11». Il précisait néanmoins en des termes très clairs tous refus d’avant-gardisme en évoquant les rapports entre l’organisation qu’était Socialisme ou Barbarie et les organes de luttes créés par les ouvriers que ce groupe appelait de ses vœux :
« J’allais jusqu’à soutenir, contre la majorité de Socialisme ou Barbarie, que même si nous disposions d’une véritable organisation avec un programme conforme à nos idées, celles-ci ne sauraient prétendre à se subordonner l’action de ces organes autonomes, que c’était leur affaire de définir leur action, leurs objectifs et de chercher auprès de l’organisation supposée des moyens (clarification théorique, informations, liaisons) pour se développer12».
Lui importait au premier chef le projet de la revue Socialisme ou Barbarie dont le sous-titre « “Organe de critique et d’orientation révolutionnaire” reflé(tait) son point de vue13 ». On peut avancer que cette revue, comme par la suite Informations et liaisons ouvrières (ILO), qu’il fonda en 1958 avec d’autre membres de SB rétifs à l’idée de constituer une nouvelle « avant-garde révolutionnaire », étaient des revues militantes et, qu’à l’inverse, les lieux où il publia à partir du milieu des années 1960, qu’il s’agisse d’organe de presse, de maisons d’éditions, ou de revues auxquelles il collabora ou qu’il fonda Libre, Le temps de la réflexion, Passé-Présent, la collection « Littérature et politique » chez Belin, ne furent en rien des lieux militants. Pour autant, l’idée d’une opposition entre un monde de publications militantes et un monde de publications intellectuelles ou académiques, ou d’une accumulation de « capitaux militants » reconvertis par la suite en « capitaux académiques14», quand il devint chercheur au CNRS et universitaire, fait manquer un paradoxe que Claude Lefort soulignait très bien dans ce même entretien. Le fait que l’acte de penser conduit à une prise de distance avec autrui, geste qui suppose inévitablement l’épreuve de la division. Il avançait que l’idée que « la politique est l’affaire de tous », conduisait à faire une épreuve paradoxale : le « discours suit nécessairement une voie qui vous éloigne du plus grand nombre », car le travail intellectuel, « implique la ségrégation d’un espace de la culture », et de conclure que l’on ne saurait se « masquer cette contradiction15 ». Évoquant ensuite ses débats avec les autres membres d’ILO, notamment sur la question du contenu du contenu de leur bulletin, Claude Lefort remarquait que pesait une « suspicion » sur la « parole savante » et que, quelque puisse être le bien fondé de celle-ci, notamment au regard des « ravages que fait l’éloquence du théoricien auprès de ceux qui se laissent subjuguer sans comprendre », on ne pouvait pour autant « refuser toute relation qui témoigne d’une relation d’asymétrie entre les positions des interlocuteurs » et de donner une dernière précision, « la communication personne n’en peut fournir la juste formule 16». Il précisait sa pensée sur ce sujet en évoquant avec la rédaction de l’Anti-Mythes leur propre travail. Il réitérait l’impossibilité d’une quelconque position de surplomb, en appelant ses interlocuteurs à assumer l’ambiguïté de toute action : « Je crois que les conséquences de nos actions nous échappent. Ce n’est peut-être pas exaltant : mais vous publiez l’Anti-Mythes, vous savez peut-être si ça se vend, ou si ça ne se vend pas, mais que savez-vous de ce qu’on en lit, de ce qui chemine dans la tête des autres ? 17». Il précisait enfin, évoquant son propre travail, qu’il fallait accepter « de ne pas savoir où l’on est, pour que de la division entre l’œuvre et le lecteur, la pensée s’engendre » et que l’on ne pouvait se soustraire à « l’indétermination qui est l’épreuve de la lecture18 ».
C’est à l’aune de ces propos qu’il nous faut apprécier une dernière remarque de Lefort sur ses rapports avec ses camarades d’ILO (Informations et liaisons ouvrières) qui énonce d’une certaine façon son projet d’écrivain politique qui marque toute son œuvre, ce de ses premiers écrits aux derniers. « Je sais qu’à ILO même et en d’autres occasions, j’ai établi un dialogue véritable, durable, avec des camarades qui ne parlaient pas le même langage que moi, mais qui s’abandonnaient, comme je le faisais moi-même, à l’inconnu, à l’indéterminé de la relation19 ».
Ce souci de l’indéterminé de la pensée et d’interpeller autrui, là encore en faisant l’épreuve de l’indétermination de la pensée, marque toute l’œuvre de Claude Lefort et interdit, me semble-t-il, de tracer des frontières étanches entre différents moments de son activité intellectuelle, un moment plus militant et un autre avant tout universitaire.
Les cheminements d’une œuvre
Scrutons l’œuvre de Claude Lefort à l’aune de ce qu’il invitait très tôt à faire dans ses premières réflexions sur la façon de lire Machiavel.
« C’est seulement en suivant pas à pas l’écrivain, en confrontant constamment ses intentions déclarées, son plan manifeste avec le développement effectif de sa pensée, en scrutant dans l’œuvre à la fois la structure, les symboles directeurs, le sens des propositions et les changements qui les affectent dans la durée du discours, que nous pouvons parvenir à mettre en évidence la genèse de la pensée de l’écrivain, suspendre les questions qu’il se pose à lui-même et nous initier à l’indétermination que font surgir ses idées au moment même où elles instituent une nouvelle indétermination du réel20 ».
Pour qui survole son œuvre21 qui court sur un bonne soixantaine d’année, c’est-à-dire à la fois les volumes qu’il publia, qu’il s’agisse de recueil d’articles et de livres conçus comme tels, mais aussi les articles et les notes de lecture jamais repris en volume, comme les textes inédits ou certains entretiens, une chose est d’emblée très frappante, l’entrelacement de textes qui portent sur l’actualité politique et culturelle du moment, comme sur des expériences socio-historiques extrêmement diverses et enfin d’autres qui portent sur ce qu’il désigna très tôt comme des « œuvres de pensée », ou de façon plus ponctuelle des ouvrages d’anthropologues, de sociologues et d’historiens.
À suivre année après année les publications de Claude Lefort, son souci permanent de penser la politique au jour le jour apparaît très nettement. Ce fut au premier chef la question du sens de la construction d’une organisation révolutionnaire et les débats sur ce sujet au sein de Socialisme ou Barbarie et de Informations et liaisons ouvrières. La politique française mobilisa bien évidemment de façon constante son attention : la fin de la IVe République et la guerre d’Algérie, les débuts du gaullisme et la fondation de la Ve République, le poujadisme, les positions politiques des intellectuels progressistes au premier chef de la rédaction des Temps Modernes, Mai 1968, la question universitaire et la crise des savoirs, la formation de l’Union de la gauche, le pompidolisme et le giscardisme, le refus de Jacques Delors d’être candidat à l’élection présidentielle de 1995, la montée en force du Front national et les grèves de 1995. Il n’eut pas moins à cœur d’analyser le cours des événements internationaux, bien sûr dans les pays totalitaires l’URSS, ses satellites et la Chine. Pensons à ses premiers textes de Socialisme ou Barbarie, parmi ceux-ci, « Le totalitarisme sans Staline », les études sur les mouvements de contestation du totalitarisme en Hongrie et en Pologne en 1956, sur Solidarnosc, sur les dissidents soviétiques et la mise à l’honneur des droits de l’homme, ou sur les lendemains des pays socialistes après la chute du communisme, les guerres dans l’ex-Yougoslavie. Il suivit avec le même intérêt passionné la situation des pays coloniaux, un de ses premiers articles dans les Temps Modernes en atteste, puis la guerre d’Algérie et ses lendemains, le coup de force du FLN pour interdire au FIS d’accéder au pouvoir, la politique brésilienne, l’affaire Salman Rushdie et la montée en force de l’islamisme et enfin la question d’Israël et de la Palestine.
Parallèlement Claude Lefort publia des études qui portent sur des faits sociaux et politiques très largement à distance de l’actualité. Ses publications des années 1945 au début des années 1970 témoignent de son dialogue avec les anthropologues sur la question de l’historicité, de l’aliénation, comme avec les historiens et les sociologues de la Réforme et des débuts du capitalisme. Il consacra de la même façon différentes études à Machiavel comme à Marx ou à Merleau-Ponty dont il fut l’éditeur posthume. Nul doute que son grand livre sur Machiavel, une thèse de doctorat d’État, peut faire figure de bloc à part dans son œuvre en raison de la complexité et de l’érudition de ce livre qui suit pas à pas le Prince et les Discorsi. Pour autant les années consacrées à la rédaction de cet ouvrage, commencé au milieu des années 1950 et publié en 1972, furent aussi celle d’autres publications marquantes dans son œuvre, son premier article sur la démocratie, d’autres sur les « œuvres de pensée » et le problème de l’interprétation, d’autres encore sur l’humanisme civique et la question de l’idéologie et, bien évidemment, son essai sur Mai 1968. Les articles et les études, comme les livres publiés après son Machiavel furent le moment d’approches nouvelles de la question du totalitarisme et de celle de la démocratie moderne.
Ce premier survol met le lecteur en porte-à-faux, comment distinguer entre tous ces textes ? Nul doute que certains textes, notamment quant à partir de 1960 Claude Lefort commença à publier dans des quotidiens ou des hebdomadaires, furent étroitement liés aux circonstances et marquèrent son souci de participer « à chaud » au débat public. Pensons à sa première tribune qui porta sur le « Manifeste des 121 », comme à la seconde consacrée à la guerre des six-jours, ou encore à la troisième intitulée « la résurrection de Trotsky » en 1969. D’autres, plus tardives, portèrent sur les vingt ans de la révolution hongroise, le mouvement des dissidents soviétique, le coup de force de Jaruzelski en Pologne, l’affaire Salman Rushdie.
Il n’est pas moins évident que certaines de ses études, celle sur le concept d’aliénation où il analysa longuement l’œuvre de Evans Pritchard sur les Nuers, ou celles sur l’œuvre de Abraham Kardiner où il montra la fécondité puis les limites de l’idée de « personnalité de base », et plus encore son Machiavel, certaines études sur Merleau-Ponty, ou enfin, ses essais sur l’écriture de Henri Michaux ou sur la peinture d’Albert Bitran, participent d’un autre registre de l’expression. Elles furent au contraire incontestablement écrites sans liens apparents avec l’actualité politique et sociale. Pour autant dans d’autres essais, notamment l’un, un peu oublié, sur Merleau-Ponty, « La politique et la pensée de la politique22», mais aussi Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag23et son étude la plus citée « Droits de l’homme et politique »24, Claude Lefort part de l’analyse de faits sociaux et politiques, de débats politiques très contemporains et mobilise aussi des réflexions nées de ses lectures d’œuvres de pensées, celles de Merleau-Ponty, comme celle de Marx ou de La Boétie, qu’il discute pas à pas.
Les entretiens qu’il donna sont porteurs de la même ambiguïté. Ils offrent non seulement de précieux renseignements sur la façon dont Claude Lefort conçut son œuvre, mais ils en font incontestablement partie au même titre que les textes qu’il écrivit. Notons d’ailleurs qu’il réécrivit ligne à ligne son long entretien avec L’Anti-Mythes. Plaide pour ce point de vue le fait qu’il jugea avec l’éditrice de son dernier recueil d’essais, Le Temps présent, Geneviève Bouffartigue, et son préfacier, Claude Mouchard, que certains de ses entretiens méritaient d’y figurer, tandis que d’autres, non moins intéressants, étaient étrangement délaissés, sans doute parce qu’ils n’étaient pas retranscrits, ou encore, que certains étaient jugés d’une longueur excessive. Pour autant ces derniers, dont on n’a pas une liste exhaustive25 méritent d’être lus ou écoutés et devraient être inclus dans une publication de ses inédits. Je pense tout particulièrement aux suivants : un débat de 1983 avec des psychanalystes, conduit par François Roustang, « Le Mythe de l’Un dans le fantasme et la réalité politique26» ; un entretien de 1992 avec Antoine Spire « Claude Lefort à voix nue27 » ; un autre en 1994 avec Pascale Werner, « Claude Lefort et la vie politique 28» ; en 1999 un échange avec Pierre Hassner dans l’émission « Répliques » d’Alain Finkielkraut sur son essai sur le communisme, La Complication 29; ou encore en novembre 2007 une conférence sur le totalitarisme à Cité Philo30 ; et bien sur ses longs entretiens avec Esteban Molina dont un sur Machiavel, publié en annexe à la traduction en espagnol de son Machiavel31. L’échange avec les psychanalystes est fort éclairant sur les rapports de Lefort à Freud et Lacan. Les deux entretiens diffusés sur France Culture sont pleins d’enseignements. Le premier parce que Lefort y évoque, sans doute pour la première fois publiquement, ses premiers intérêts pour les questions politiques. Il dit combien il fut adolescent frappé par les questions qui surgissaient à la lecture du roman de Roger Martin du Gard Les Thibaud. Il relate sa découverte de l’actualité dans les quotidiens, notamment lors des journées de juin 1934, ses réactions face au Front populaire et à l’enthousiasme du moment de son frère aîné Bernard, jeune militant socialiste, ou enfin les dires du père d’un compagnon de lycée, qui avait fui l’URSS, et le fit très tôt mettre en doute les mensonges de la propagande du Parti communiste sur la « Patrie du socialisme ». Dans le second entretien, il se livre à une réflexion très ferme sur le souci de penser qui lui semble consubstantiel à toute expérience et qui souligne-t-il ne disparaît pas même dans les circonstances politiques les plus effroyables. Et il évoque à ce propos la volonté de tous ceux qui, en butte aux cruautés et à la déshumanisation propre aux systèmes concentrationnaires des régimes totalitaires, voulurent penser leurs expériences pour retrouver ce Claude Lefort nomma dans un autre essai « le sens de l’orientation ». L’échange avec Pierre Hassner, comme sa dernière conférence sur le totalitarisme précisent les vues de Lefort sur le communisme comme « fait social total », ce en rupture avec les visions de François Furet et Martin Malia. Enfin l’échange sur Machiavel avec Esteban Molina reformule de façon ramassée la vision qu’eut Lefort de la dialectique des humeurs chez le penseur florentin.
C’est dire que beaucoup de ces entretiens participent incontestablement de l’élaboration de son œuvre de pensée, bien évidemment le premier qu’il donna à la revue l’Anti-Mythes (1975), mais aussi celui avec Esprit (1979) « la communication démocratique », comme ces entretiens avec des journalistes de France Culture jamais repris dans son dernier volume d’essais. D’autres peuvent être lus comme autant de mises au point autour de son œuvre, tels ceux avec Faire (1978) « Aperçu d’un itinéraire », avec Le Monde « repenser le politique » (1978) et « Le peuple et le pouvoir » (1982), la revue Autrement « La pensée du politique » (1988). D’autres encore, souvent parfois extrêmement brefs, semblent étroitement liés aux circonstances et ont valeur de tribune : « les libertés ne peuvent être octroyée un jour et abolies le lendemain » Le Monde (1989), « Peut-être » Globe (1990), et de façon exemplaire « Il fallait arrêter le FIS » Le Nouvel Observateur (1992). Enfin certains sont infiniment plus difficiles à classer et illustrent à l’oral ce Claude Lefort nommait une « pensée hybride », « La Pologne et le réalisme des socialistes » pour la revue belge, Pour écrire la liberté (1982), « Le relativisme déchaîne l’imbécillité » paru dans Le quotidien de Paris (1992) « Le politique est toujours en défaut, sinon en état de crise. Après le succès du Front national » publié par Le Monde (1992)32.
Ces entretiens témoignent aussi du va et vient d’une expression, qui si savante puisse-t-elle être, se veut toujours politique et oscille entre différentes formes d’expression : un langage descriptif au plus près des phénomènes et des formules plus savantes. Ils attestent aussi du cheminement d’une pensée qui prend en charge des thèmes dont la présence s’affirme tout au long de son œuvre. Certains sont évident, la question du marxisme et du rapport à l’œuvre de Marx, celle de la révolution, de la démocratie. Pourtant à prendre au sérieux son appel à suivre les « développements effectifs » d’une œuvre et d’un auteur, on fait des découvertes inattendues. Les lecteurs les plus âgés de Claude Lefort se souviendront du petit scandale déclenché par son très bref entretien de 1992 avec le Nouvel Observateur, « Il fallait arrêter le FIS » et des commentaires agacés de certains qui jugèrent qu’en pleine vague de démocratisation du tiers-monde, un tel point de vue était des plus mal venus. Ces critiques ajoutèrent que de plus Claude Lefort n’était pas un spécialiste du Maghreb et qu’il se comportait en donneur de leçon occupant cette position de « surplomb » qu’il récusait. S’il ne fait aucun doute que Claude Lefort ne fut jamais un sociologue spécialiste de Maghreb et du monde arabo-musulman, à suivre ses écrits et ses dits, on peut néanmoins faire une autre lecture de ces propos. On constate tout d’abord que son intérêt pour la situation coloniale est ancien, c’est le sujet d’une de ses premières publications dans Les Temps Modernes en 1947, « Les pays coloniaux : Analyse structurelle et stratégie révolutionnaire ». C’est ensuite le thème d’une étude, plus que substantielle, publiée dans Socialisme ou Barbarie en 1958, à la veille de la prise du pouvoir par De Gaulle, « Prolétariat français et nationalisme algérien ». Il y fit à la fois une critique implacable de la situation coloniale, employant à ce propos le terme de « totalitarisme », tout en soulignant les dangers de la prétention du FLN à incarner seul le sentiment national algérien et à éliminer par la violence ses concurrents. Il aborda à nouveau ces thématiques, notamment celui de la bureaucratisation du FLN, lors d’une table ronde sur l’Algérie indépendante organisée par le cercle Saint Just en 1961, table ronde qui fut publié sous forme de brochure33. Il revint quelques années plus tard sur le sujet dans le cadre d’un bref article, de l’Encyclopedia Universalis, sur Abbas Ferhat, le premier président de la république algérienne. De même expliqua-t-il longuement ses propos sur le coup de force du FLN à l’encontre du FIS, cette fois-ci dans le cadre d’un colloque – Tout dire tout écrire ? – organisée par Amnesty International en 1993 sous le titre de « Le déficit de la démocratie34 ». La situation algérienne, déclara-t-il, ne se caractérisait pas par un coup d’arrêt à un mouvement de démocratisation. Il s’agissait d’empêcher dans une situation où « il n’y avait pas de démocratie », la venue au pouvoir d’un parti islamique visant à établir « un régime qui abolit toute possibilité de démocratie ». Il précisa aussi à l’occasion de cette conférence des propos sur la nature des visées politiques du Front national qu’il avait formulé dans un autre entretien donné en 1992 au Monde, « Le politique est toujours en défaut, sinon en état de crise. Après le succès du Front national ». Il y remarquait comment le Front national avait indéniablement partie liée avec le fascisme par sa volonté d’apparaître « comme en dehors de l’ensemble du champ politique » et par son souci de rupture en appelant à « la création d’un ordre nouveau ». Sa conférence à Bruxelles lui donna en outre l’occasion de préciser sa pensée sur la conduite à tenir face à un parti prétendant mettre à bas le régime démocratique : « Je réponds, sans aucune hésitation, que dans ce cas-là, tous les moyens sont bons pour empêcher (un tel parti) de prendre le pouvoir, je dis bien tous les moyens, et que la volonté de la majorité en l’occurrence doit être considérée comme une aberration et que, bien que l’on croie aux principes de la démocratie, on ne laisse pas faire “l’expérience” par la majorité de ce que pourrait-être une aventure totalitaire35 ». De même faudrait-il rapprocher ce bref entretien sur le FIS, d’articles ou de tribune bien antérieures à celui-ci, tel « La méthode des intellectuels dits “progressistes” : échantillons » publié en 1958 dans Socialisme ou Barbarie36sur les rapports de intellectuels à la politique algérienne, ou sa première tribune au Monde « Le manifeste des 121, le réalisme des professeurs37 » et bien sûr l’article déjà cité des Lettres nouvelles de 1963 : « La politique et la pensée de la politique ». Dans tous ces cas, il analysait la cécité volontaire des intellectuels progressistes face aux faits qui mettent en question leurs certitudes et leur capacité à créer des acteurs sociopolitiques qui sont autant de substituts des images d’un prolétariat mythifié capable d’instituer un monde délivré de la contradiction qui, pour reprendre, un mot de Harold Rosemberg38 qu’il affectionnait, a tout des sorcières de Macbeth. On retrouve la même démarche dans ses articles sur la situation au Proche Orient, l’un écrit au lendemain de la guerre des six jours pour Combat39, l’autre après les opérations de l’armée israélienne dans la ville de Jénine en avril 2002. Dans le premier il condamnait une pétition d’intellectuels français qui, au lendemain de la victoire militaire d’Israël réduisait ce pays au rôle de complice « objectif » de visées impérialistes des États-Unis et qui en retour idéalisait les bureaucraties au pouvoir dans les pays arabes dit « progressistes » (l’Algérie et l’Égypte), tout en appelant à « une prudence nécessaire dans l’appréciation de la politique que suivra demain le vainqueur ». Il évoquait ainsi bien évidemment la question des territoires conquis lors de la guerre. Dans le second, il soulignait comment, en 2002, lors de l’offensive de l’armée israélienne dans le camp de Jénine, « le projet de démanteler des réseaux terroristes s'était transformé en une mise à sac de la ville, accompagnée de meurtres d'un nombre encore inévalué, mais important, de civils » et révélait, ce faisant, le projet de chasser les Palestiniens du territoire d’un futur État palestinien40. L’attention portée aux entretiens donnés à la presse brésilienne par Claude Lefort donne là encore des pistes pour apprécier son intérêt pour le Brésil et plus généralement pour les pays d’Amérique latine. Il y a certes dans ces entretiens la marque d’une manière de révérence des journalistes qui cherchent à interviewer une figure d’intellectuel français prestigieuse. C’est là un topos courant où la personne interviewée peut facilement se faire piéger en s’installant dans une stature mandarinale, en présentant à la va vite son œuvre, en prenant des positions de surplomb vis-à-vis d’événements de son pays d’origine, et plus encore en proférant des jugements abrupts, et pas assez informés, sur l’actualité du pays où il est en visite. Les entretiens de Claude Lefort avec des journalistes brésiliens n’échappent pas toujours à ces travers, mais en même temps ils révèlent une connaissance nullement superficielle du Brésil et un indéniable sens de la situation politique de ce pays. Ces entretiens portent aussi la trace de ses échanges avec des intellectuels brésiliens, échanges commencés lors de son séjour comme professeur à l’université de São Paulo (1953-1954), et poursuivis lors de séjours d’enseignements à la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 et 1990. Ils donnent un relief particulier aux textes où il aborde, de façon parfois presque latérale ou au contraire très directement, la question des formes politiques dans les pays du tiers-monde ou du sud. Son expérience brésilienne affleure dans ses réflexions sur les formes de la démocratie dans ces pays. On sent son poids dans la façon dont il apprécie la nouveauté qu’y constituait la mise à l’honneur des droits de l’homme dans une société longtemps organisée de façon hiérarchique, les limites d’une égalisation des conditions qui coexistent avec d’abyssales différences de richesse et une absence de sens de la similitude entre les hommes41.
L’entrelacs de la politique et du Politique
Ce va-et-vient entre différents registres de l’expression qui caractérise son œuvre n’est pas seulement perceptible à la juxtaposition des différents moments de celle-ci, mais au sein même des essais et des livres qui la compose. Si un ouvrage comme son Machiavel ou certaines études sur la Boétie, Abraham Kardiner ou l’idéologie sont incontestablement des œuvres « académiques » de la facture la plus classique, quelle que soit sa liberté de ton et son souci de l’écriture, d’autres sont en revanche des « œuvres hybrides » pour reprendre une expression qu’il appliqua aux œuvres dont la lecture avait nourri la sienne. Pensons à sa longue étude, « La politique et la pensée de la politique » parue en 1963 dans Les Lettres nouvelles de Maurice Nadeau, comme à deux textes, l’un peu délaissé Un homme en trop. Réflexions sur l’Archipel du Goulag (1976), et enfin à sa première grande étude sur les droits de l’homme « Droits de l’homme et politique » (1980). Ce qui frappe et peut déconcerter à la lecture de ces trois essais est sa façon très systématique et rigoureuse de se déplacer imperceptiblement entre différents plans de la réflexion : celui de l’actualité la plus immédiate, celui du souci de l’action politique, celui plus général du Politique, entendu comme mise en forme d’un principe organisateur du social, où ses propos s’étayent le plus souvent sur la lecture minutieuse d’« œuvres de pensée ». Ainsi dans « La politique et la pensée de la politique », prend-il comme point de départ l’actualité politique des lendemains de la guerre d’Algérie en France. Il évoque tour à tour la fin de la IVe République, la guerre d’Algérie, l’arrivée au pouvoir de de Gaulle, les espoirs mis par la gauche, dans le sillage de Jean-Paul Sartre, de Frantz Fanon et de Francis Jeanson, dans la révolution algérienne et les réalités beaucoup plus prosaïques de l’Algérie indépendante. Il met en exergue les limites d’un certain marxisme, les œillères de Sartre, puis invite à renouveler le regard sur la politique en prenant en charge, à la fois certaines interrogations marxiennes, celles du 18 brumaire et Louis Napoléon Bonaparte, comme celles de la phénoménologie en se livrant à une lecture très minutieuse de la préface de Signes de Maurice Merleau-Ponty. Il reprend à ce propos une formule pour une part empruntée à Heidegger citant Hölderlin, formule qu’il faut citer. Elle exprime en effet, très nettement, comment Claude Lefort a la volonté de penser conjointement la politique et la pensée politique.
« Ainsi pourrait-on dire de l’action politique et de la pensée politique ce que dit Heidegger, citant Hölderlin de la philosophie et de la poésie, “qu’entre elles règnent une parenté profonde” bien qu’elles “demeurent sur les monts les plus séparés”. À distance, et sans qu’il soit permis de jeter un pont qui assurerait entre l’une et l’autre une communication visible, elles s’inscrivent dans une même histoire42 ».
Il poursuivit ensuite cette étude par un commentaire détaillé de Signes comme des deux ouvrages consacrés par Maurice Merleau-Ponty au communisme, Humanisme et terreur (1947) et Les Aventures de la dialectique (1955). Il conclut en avançant que « le penser et le faire » ne peuvent trouver leur origine dans un groupe social constitué en totalité fermée au « “contenu” positif » mais doivent savoir « restituer (…) l’indétermination (…) en s’abandonnant à une libre interrogation43».
On retrouve la même démarche à l’œuvre dans Un homme en trop. Claude Lefort part de l’accueil fait à la traduction française du premier volume de L’Archipel du Goulag par la gauche française en 1974. Ce faisant, il rappelle non seulement l’interminable cécité volontaire de certains intellectuels face au totalitarisme et à ses monstruosités, mais les vivats qui en accueillirent l’instauration, notamment ceux de Louis Aragon : « J’appelle la terreur du fonds de mes poumons ». S’il faut parler à sa suite de cécité volontaire, c’est bien parce que, comme il le remarque, qui voulait savoir pouvait savoir et lire Trotski, Souvarine, Neuman, Daline, Kravtchenko et Ciliga, sans pour autant lire la presse dite « bourgeoise ». Il revient sur l’incroyable refus de s’interroger qui fut celui des Temps Modernes à l’exception de Merleau-Ponty. Il débat rudement avec ceux qui rabaissent Trotski, ou jugent, comme les rédacteurs de l’Humanité, ou Jean Daniel dans le Nouvel Observateur, qu’accueillir la parole de Soljenistyne revenait à faire le procès de Marx. Il insiste ensuite longuement sur la passion de témoigner et de penser le monde soviétique qui était celle de l’écrivain russe et combien celle-ci était à rebours d’un goût pour le refus de penser à l’honneur dans une grande partie de la gauche. Il met ensuite à l’honneur la perspective sociologique et ethnographique de Soljenistyne quand il décrivit non seulement le monde des zeks mais la place qu’occupait le système concentrationnaire dans le système politique soviétique. Il souligne aussi son langage anti-autoritaire et sa perspective nourrie du regard des « trimards » de « ceux d’en bas » et pointe le rôle de « contradicteur public » de l’écrivain et son attitude « libertaire ». Il raille pour finir les accusations de « spiritualisme » lancée pour dénigrer la parole de Soljenistyne en montrant que, n’en déplaise à ses détracteurs, si aptes plus tard à s’émerveiller de la rencontre d’un Fidel Castro avec les théologiens de la libération, son « christianisme “sauvage” » renaît face à un régime prétendant abolir toute transcendance.
Comme on peut le constater à relire ce long premier chapitre, conçu au départ comme un essai pour la revue Textures, Claude Lefort y oscille entre une extrême attention au langage de Soljenistyne dans le premier volume de L’Archipel44 qu’il lit page à page, et une attention non moins méticuleuse aux débats, bien plus à l’emporte-pièce, des thuriféraires du communisme soviétique ou des intellectuels progressistes soucieux de ne pas ruiner les enthousiasmes attachés à l’image de l’URSS, comme « tous comptes faits », l’incarnation du socialisme. Il conclut en appelant à entendre ce qui chez Soljenistyne pousse à s’interroger et ruine les catégories établies.
Les chapitres suivants – « II Le peuple devenu son propre ennemi », « III L’égocrate », « IV Le système constrictif », « V Une idéologie de granit », « VI Avec des fissures commencent à s’effondre les cavernes » – dont les titres viennent des mots employés par Soljenistyne, abandonnent pour l’ensemble les polémiques du moment et sont une lecture méticuleuse des mille cinq cent pages des trois volumes de L’Archipel. Si le commentaire qui épouse les sinuosités de la pensée de Soljenistyne n’est pas moins méticuleux que celui du Prince ou des Discorsi dans son Machiavel, le ton est plus libre, plus mordant, comme en écho à celui de l’écrivain russe. Il confronte les points de vue de ce dernier à ceux d’autres critiques du totalitarisme, et bien sûr à la perspective qui fut la sienne et celle de Castoriadis dans Socialisme ou Barbarie, il les appose aux différents moments de l’histoire de l’URSS, et ce faisant il déploie une lecture qui est bien sûr une interprétation du totalitarisme, mais aussi des débats autour de l’idée de révolution ou des rapports de Marx au marxisme, puis au marxisme-léninisme.
Relisons ses chapitres II et III. Le premier de ces chapitres aborde la question de la fermeture du régime sur lui-même, celle de l’Un et de sa figure complémentaire l’ennemi du Peuple. Le second interroge ensuite ce que Soljenistyne dénommait avec un remarquable sens de la formule « la figure de l’égocrate ». Là, Claude Lefort retrouve son sens politique et polémique. Il examine alors les thèses de Khrouchtchev, ou celle de Louis Althusser et montre comment, dans leur psychologisme ou leur appel à la « science marxiste-léniniste », elles visèrent sciemment la perpétuation de ce Soljenistyne nomma « une idéologie de granit », une idéologie destinée à voiler l’oppression totalitaire et à justifier les privilèges de la bureaucratie. Le ton se fait cinglant et sans concession quand Claude Lefort pointe que le rapport Khrouchtchev s’est voulu historique en prétendant procéder à des réformes, mais qu’Althusser fit en quelque sorte mieux. Il justifia le passé, dénonça les errements « humanistes » – l’attention à la question des droits –, mais non content de cette première prouesse, il se livra aussi à l’apologie de l’égocrate sans pareil, alors au pouvoir, qu’était Mao Zedong.
Les chapitres suivants, « IV Le “système constrictif” » et « V “Une idéologie de granit” » sont eux construits sur un minutieux commentaire des thèses développées par Soljenistyne, sur la nature et le rôle des camps, sur les procès et les rafles des supposés opposants qui atteignirent leur paroxysme quand Staline eut domestiqué le parti, et enfin, sur la nature de l’idéologie soviétique et les liens de celle-ci avec la pensée de Marx. Pour ce faire, Claude Lefort met en regard des thèses de l’écrivain, dont il souligne et loue le caractère parfois contradictoire dans sa volonté de suivre au plus l’expérience des zeks, celles de Hegel sur la Volonté dans la Phénoménologie de l’Esprit, celles de Marx sur l’exploitation qui affleurent dans les propos de Soljenistyne sur la fonction économique des camps, puis celles de Koestler et Merleau-Ponty dans leurs analyses des procès des années 1930, et enfin celle de Rosemberg sur le registre de la croyance et du savoir chez les communistes. Ce faisant il poursuit et affine ses premières analyses du totalitarisme et formule plusieurs de ses thématiques les plus novatrices sur l’expérience démocratique. Il met en exergue la façon dont le totalitarisme soviétique associe la violence au phantasme de l’organisation et ce, en allant bien au-delà de ce que Marx voyait à l’œuvre dans le capitalisme occidental : « obtenir des hommes abstraits45». En combinant « la coercition, l’extermination et la propagande socialiste » le régime totalitaire visait une tentative alors neuve « d’asservissement total » des zeks, projet qui, remarqua Lefort, fut repris et mis à l’œuvre dans la Chine maoïste. Le paradoxe fut que le système totalitaire prétendit à la fois retrancher symboliquement de la société ceux qui étaient désignés comme des parasites, mais en même temps les absorber. Les procès et les modalités de l’instruction judiciaire furent de ce point de vue exemplaires. Le jeu de l’auto-accusation en fut un dispositif clé en ce qu’il matérialisa non seulement la toute-puissance du parti-État pensé comme un grand « Organe » incarnant à la fois l’État et ses rouages, mais la société et ses mécanismes dans leur réalité et ce qu’ils symbolisaient. Claude Lefort remarqua que « d’une manière générale, l’histoire des camps est celle des effets immaîtrisables de ce déchaînement, celle de l’établissement du système constrictif – mais non moins celle de son impuissance à s’accomplir46 ».
Ses pages sur « l’idéologie de granit », sur la scélératesse de ceux qui en firent usage, sur le procès que devraient leur être fait, conduisent Claude Lefort à confronter les propos de Soljenistyne à ceux de Marx. « L’idéologie est de l’ordre du savoir, elle implique un certain mode d’interprétation du réel, un certain mode d’argumentation et d’affirmation qui non seulement requiert l’adhésion mais mobilise la pensée des hommes47 ». Et de préciser que Soljenistyne posa que l’idéologie est un « rapport au savoir comme rapport tout à la fois impersonnel et interpersonnel, comme rapport social 48». L’idéologie n’est nullement, comme l’expliquèrent certaines grandes voix de la gauche progressiste, au lendemain du rapport Khrouchtchev, « le règne des idées49 ». Ce chapitre donne aussi l’occasion à Claude Lefort de mettre à bas certaines interprétations paresseuses et fausses de Marx, du marxisme, du léninisme, largement popularisées, à l’époque où il écrivait, par les mal nommés « nouveaux philosophes » et parfois présentes dans le roman de Koestler, Le Zéro et l’infini. Marx fut étranger « au mythe scientiste de l’Histoire », « le marxisme n’autorise que des conjonctures plus ou moins probables (…) et n’élimine pas l’incertitude50 ». De même, pour apprécier le léninisme, faut-il non pas se contenter de citer des écrits largement contradictoires de Lénine – Que faire/ L’État et le révolution –, mais scruter sa pratique. De même faut-il se garder de déduire mécaniquement le totalitarisme de ses consignes pour construire le parti. Le régime totalitaire ne s’est édifié que quand les bolchéviques se sont rendus maîtres du nouvel État. Mettant en parallèles les expériences rapportées par Soljenistyne et les propos de Harold Rosemberg, Claude Lefort souligne cette caractéristique propre aux intellectuels gagnés à la cause du bolchévisme, le respect d’une règle intangible : « NE PAS PENSER. La connaissance de Marx s’annule sous l’effet de la transcendance de la “science marxiste”51 ».
Si Claude Lefort reprend Soljenistyne et montre l’inanité de ses thèses faisant de Marx le théoricien de la nécessité de créer, au lendemain de la destruction de l’État bourgeois, « une nouvelle machine coercitive », ou encore l’anticipateur de la future « science marxiste », il souligne en même temps, dans le cours de sa discussion, certaines limites de Marx. Il pointa ainsi la volonté de ce dernier « de réduire l’activité sociale en sa réalité, à l’activité productive, le rapport social en sa réalité au rapport noué dans l’activité productive (…) qui eut pour effet (…) de lui interdire de penser la distinction entre l’individuel et le collectif, le privé et le public ». Il remarqua aussi à cette occasion la cécité de Marx dans sa dénonciation du caractère formel de la démocratie bourgeoise qui lui interdit de saisir comment la démocratie « excédait les limites de ses institutions52» et comment elle instituait un nouveau rapport à la loi et un pouvoir qui « n’appartient à personne53 ».
Quelques mots sur l’étonnant chapitre final d’Un homme en trop : « Avec des fissures commencent à s’effondrer les cavernes ». On se souvient que dans l’accueil fait au premier volume de L’Archipel, tant à gauche qu’à droite, une bonne partie des commentaires fut prompte à souligner, pour louer ou au contraire disqualifier Soljenistyne, la dimension réactionnaire ou contre-révolutionnaire de ses propos ou encore son spiritualisme. Nul doute que L’Archipel ébranla le mythe soviétique comme aucun autre livre avant lui. Pour autant, Claude Lefort, lecteur scrupuleux du dernier volume traduit en français – il le lut sur épreuve alors qu’il mettait une dernière main à son essai – mit en pièce cette image par trop convenue. Reprenant la chronique des soulèvements survenus dans L’Archipel, il souligna comment Soljenistyne jugeait que, pour que son lecteur comprenne le désir de liberté, il fallait qu’il « ait d’abord senti se dérober le sol de la vie54». Claude Lefort saisit aussi comment « l’éloge des initiatives révolutionnaires est devenu possible (pour Soljenistyne) dès lors qu’il apparaît coupé de la foi en la Révolution55». En écrivant ces lignes, il invite le lecteur de Soljenistyne à accepter de le suivre dans sa découverte du mouvement où « s’affirme l’idée neuve de luttes contre l’oppression, qui dans des conjonctures favorables seraient à a fois justes, nécessaires et, même si elles ne peuvent aboutir, réalistes56». Ceci posé, Claude Lefort lit les chroniques des révoltes et des soulèvements de Ekibastouz en 1952, Gorlag, Norilsk, Retchlag, Sakhaline, Vorkouta en 1953 et Kenguir en 1954 en parallèle à ceux de Berlin en 1953 et de Hongrie et de Pologne en 1956. Soljenistyne, précisa-t-il, saisit pleinement le sens des événements. « Une communauté devient sensible à elle-même, s’ordonne en fonction d’un dessein de résistance ou d’offensive, se réempare spontanément de l’arme propre aux opprimés dans la société moderne : la grève, et secrète des instituions clandestines ou publiques, plus ou moins développées, selon les circonstances – comités de grève, organisme d’autogestion57 ».
Il conclut ce chapitre en montrant comment, à la différence d’intellectuels parisiens vantant dans les années 1970 la Chine, où le règne de « la liberté de masse (faisait qu’il n’était) nul besoin de libertés individuelles », Soljenistyne sut montrer comment les « libertés détruites (…) le peuple était exsangue ». Comment les « libertés individuelles (…) sont des libertés politiques, conquises à travers les luttes de travailleurs anonymes pour qui l’égalité devant la loi n’avait rien de formel et qui ont arraché à la bourgeoisie les libertés qu’elle se réservait58 »
Ces oscillations entre l’attention la plus minutieuses aux faits politiques et sociaux et des considérations plus générales tirés de ces faits, marquent aussi son étude la plus célèbre, « Droits de l’homme et politique59». Claude Lefort ouvrit son interrogation par un commentaire du premier chapitre de Droit naturel et Histoire de Leo Strauss60où il refusa l’alternative entre pragmatisme et vertige du doute philosophique. Il choisit au contraire de partir de l’idée que l’on ne saurait rien avancer sur la nature politique des droits de l’homme sans reconnaître qu’ils « mettent en jeu une idée de l’existence ou ce qui revient au même de la coexistence humaine ». Il examine ensuite pas à pas l’action des dissidents et souligne que rabattre leurs actions sur le plan de la morale revient à faire preuve de cécité devant ce qu’ils ont ébranlé, le mensonge totalitaire. Il poursuivit en analysant la façon dont différents groupes politiques, différents secteurs de la société ont fait face au totalitarisme. Ce faisant il ferraille rudement avec tout à la fois une certaine gauche progressiste, mais tout autant avec les « réalistes » partisans de l’ordre établi au nom de la stabilité de l’ordre international.
Ceci posé, il en vient à la question du rapport nouveau à la question du droit et à la loi formulé par les dissidents et appelle, pour saisir la nouveauté de ce rapport, à critiquer la problématique développée par Marx dans La Question juive et à s’en défaire. Examinant l’argument développé par Marx, il souligne comment, dans son analyse de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, celui-ci n’avait eu à l’esprit que certaines formulations du texte et s’était délibérément abstenu de saisir les formes sociales coextensives de cette proclamation de droits nouveaux. Du coup, il avait été incapable de prendre la mesure de la façon dont la proclamation même de la Déclaration des droits de l’homme avait ouvert un nouvel espace social. Scrutant les potentialités de ce nouvel espace, poursuivant les réflexions de Ernest Kantorowicz sur les « deux corps du roi », Claude Lefort formule sa thèse fameuse sur « le travail de la désincorporation entre les pôles du pouvoir, du savoir, du droit » que consacre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et comment désormais, en régime démocratique, le pouvoir apparaît comme « un lieu vide » inappropriable par une faction ou un groupe social. Au terme de cette longue discussion des thèses de Marx et de Kantorowicz, reprenant une formule de Hannah Arendt, Claude Lefort souligne comment ce sentiment « du droit à avoir des droits » remodèle l’espace public et insuffle un esprit nouveau à certaines revendications du droit à l’égalité ou à l’indétermination qui s’expriment dans les mouvements féministes, la mouvance écologique ou, bien sûr, dans le mouvement ouvrier.
La lecture de essais postérieurs à « Droits de l’homme et politique » qui approfondissent ces thématiques du « travail de la désincorporation » et du « lieu vide du pouvoir » – « Droits de l’homme et État-providence » (1985), « Démocratie et représentation » (1989), « Menace sur la démocratie » (1993), « Démocratie et globalisation » (1995), « Les droits de l’homme et la pensée politique de gauche au Brésil » (1996), « Brèves réflexions sur la conjoncture actuelle » (1998), « Droits international, droits de l’homme et politique » (2005), portent bien évidemment la marque de ce style d’interrogation, ce va-et-vient de la politique au Politique. Mais on pourrait dire la même chose de presque tous les textes qu’il écrivit tout au long des années 1990 et qui composent la fin de son dernier volume d’essais Le Temps présent. On y retrouve le même sens phénoménologique : partir des expériences socio-politiques pour saisir la façon dont les acteurs mettent en sens et en scène leurs actions et définissent ce faisant un régime politique ; appréhender ces expériences au travers d’œuvres de pensée, le plus souvent « hybrides », puis revenir à ces expériences même et cela, toujours dans le souci d’une parole publique, jamais enclose dans les cénacles universitaires, si complexe soit-elle.
Pour finir, prenons au sérieux certaines remarques critiques faites par certains de ces lecteurs intéressés et souvent admiratifs de son œuvre, philosophes ou sociologues. Ceux-ci lui reprochent ce style de pensée et, d’une certaine façon, de ne pas avoir créé un système conceptuel rigoureux. Nul doute qu’il n’eut jamais le souci de créer une théorie, mais pour autant, sa pensée fut rigoureuse. Et il faut la lire à l’aune de la constatation qu’il fit à l’examen du dessein de Soljenistyne dans L’Archipel du Goulag.
« Son investigation (…) est littéraire. Il ne procède pas à la manière du théoricien asservi à la règle de l’analyse. Tandis que ce dernier distinguerait des hypothèses, leur donnerait tour à tour un complet développement, les hiérarchiserait, Soljenistyne les juxtapose, les mêle ; elles se disjoignent, se rejoignent sans jamais tout à fait s’extraire de la relation d’une expérience qui se veut plus qu’éloquente que l’explication rabattue sur elle. Le cheminement de la pensée n’en a pas moins de rigueur61 ».
Notes
1
Cet article fut à l’origine publié dans la revue Libre, n°7, 1980, et repris par la suite dans Claude Lefort, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981.
2
Pierre Pachet, « Un lecteur aux aguets. Lefort et les droits de l’homme » Dans Gilles Bataillon (dir.), « Claude Lefort, une pensée pour le XXIe siècle ? », Politika, mis en ligne le 08/04/2025.
3
Po&sie, n°37, Paris, Belin, 1985, repris in Claude Lefort, Écrire. À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, 1985.
4
Claude Lefort, Écrire. À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, p. 337-338.
5
Claude Lefort, Écrire. À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, p.339.
6
Claude Lefort, Écrire. À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, p. 343-344.
7
Claude Lefort, Écrire. À l’épreuve du politique, Paris, Calmann-Lévy, p. 347
8
On verra sur ce point son témoignage dans L’Anti-Mythes n°14, 19 avril 1975, repris dans Le Temps présent, Belin, 2007, p. 223-260 et plus spécifiquement p. 250-251.
9
Beatriz Urias a fait une remarquable analyse du rôle de Lefort dans ce comité dans « Claude Lefort y el caso Rushdie », Cadernos de Ética e Filosofia Politica, vol. 32, 2018 https://www.revistas.usp.br/cefp/article/view/149431.
10
L’Anti-Mythes n°14, 19 avril 1975, repris dans Claude Lefort, Le Temps présent, Paris, Belin, 2007, p. 223-260.
11
Claude Lefort, Le Temps présent, Paris, Belin, 2007, p. 228-229.
12
Claude Lefort, Le Temps présent, Paris, Belin, 2007, p. 230.
13
Claude Lefort, Le Temps présent, Paris, Belin, 2007, p.228.
14
Cette interprétation a été avancée par Philippe Gottraux in Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997.
15
Philippe Gottraux, Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997, p. 235.
16
Philippe Gottraux, Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997, p. 244.
17
Philippe Gottraux, Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997, p. 255.
18
Philippe Gottraux, Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997, p. 256.
19
Philippe Gottraux, Socialisme ou Barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'après-guerre, Lausanne, Payot, 1997, p. 244.
20
Rapport d’activité pour le CNRS 1960, p.4-5, fonds Lefort Humathèque Campus Condorcet. On rapprochera ces premières formules de plusieurs passages de la première partie de son Machiavel, « La question de l’œuvre » notamment des pages 57 à 63 où il affermit et développe longuement ces mêmes arguments sur la lecture et la place du lecteur interprète.
21
On en aura une idée en consultant en annexe à cet article une bibliographie des œuvres de Claude Lefort constituée à partir de la recension effectuée par Jérome Couillerot dans sa thèse Un régime de la liberté - la démocratie dans l’œuvre de Claude Lefort, thèse de doctorat en droit public soutenue en décembre 2017 à l’université de Panthéon Assas sous la direction de Jérôme Beaud, complétée par des indications données par Martin Legros à l’occasion de ses propres recherches sur Claude Lefort et de mon dépouillement des archives Lefort.
22
Les Lettres nouvelles n°32, 1963, repris dans Claude Lefort, Sur une colonne absente. Écrits autour de Merleau-Ponty, Paris, Gallimard, 1978.
23
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Seuil, 1976, réédition Belin 2015.
24
Revue Libre, n°7, 1980, repris dans Claude Lefort, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981.
25
Notamment de ceux nombreux donnés au Brésil, mais pas seulement.
26
Revue Psychanalystes, n°9, 1983.
31
La ciudad dividida y el sentido del republicanismo. Conversacion con Claude Lefort, in Machiavelo. Lecturas de lo politico, Madrid, Editorial Trotta, 2010, p. 567-577.
32
Tous les entretiens que nous évoquons ont été republiés dans Claude Lefort, Le Temps présent, Paris, Belin, 2007.
33
On trouvera un facsimilé de cette brochure sur le blog de Claude Bataillon : https://alger-mexico-tunis.fr/?tag=cercle-saint-just.
34
Cette conférence a été publiée par la revue Po&sie n°190, 3° trimestre 2024, sous le titre de « Menaces sur la démocratie », p. 93-101.
35
« Menaces sur la démocratie », Po&sie n°190, 3° trimestre 2024.
36
Socialisme ou Barbarie, n° 23, p.126-153, repris dans Claude Lefort, Éléments d’une critique de la bureaucratie, Paris, Gallimard, 1979, p.126-153.
37
Le Monde, 3 octobre 1960.
38
Claude Lefort, La Tradition du nouveau, Paris, Éditions de Minuit, 1962.
39
« Grand savoir et piètres leçons. En marge de la crise au Moyen-Orient », Combat 8 juillet 1967, repris in Le Temps présent, op. cit., p.197-202.
40
Le Monde, 17 avril 2002, « Israel le moment décisif », https://www.lemonde.fr/archives/article/2002/04/17/israel-le-moment-decisif-par-claude-lefort_271728_1819218.html
41
Ces textes sont les suivants, « Démocratie et représentation » (1989), « Démocratie et globalisation » (1995), « Brèves réflexions sur la conjoncture actuelle » (1998), « Droits international, droits de l’homme et politique » (2005), tous republiés dans Le temps présent, op. cit., ainsi que la préface au livre de Luciano Gois de Oliveira, Imagens da democracia : os direitos humanos e o pensamiento politico de esquerda no Brazil, 1996, publié en français sous le titre « Les droits de l’homme et la pensée politique de gauche au Brésil » dans la revue Problèmes d’Amérique latine, n°98, 2015, explicitement consacré au Brésil.
42
Claude Lefort, Sur une colonne absente. Écrits autour de Merleau-Ponty, Paris, Gallimard, 1978, p. 71.
43
Claude Lefort, Sur une colonne absente. Écrits autour de Merleau-Ponty, Paris, Gallimard, 1978, p. 102-103.
44
Rappelons que lorsque Claude Lefort écrivit ce qui fut au départ une longue note pour Textures, seul le premier volume de L’Archipel avait été publié en français par le Seuil.
45
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Seuil 1976, réédition Paris, Belin, 2015, je renvoie dans mes citations aux pages de la réédition chez Belin, p. 127.
46
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, 2015.
47
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 162.
48
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 163.
49
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 182.
50
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 175-176.
51
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 208.
52
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 225.
53
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 229.
54
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 257.
55
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 259.
56
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 263.
57
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 269.
58
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 293.
59
Libre, n°7, 1980, repris dans Claude Lefort, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981.
60
Leo Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, Plon, 1955, réédition Flammarion 2008.
61
Claude Lefort, Un homme en trop. Réflexions sur L’Archipel Goulag, Paris, Belin, p. 164.