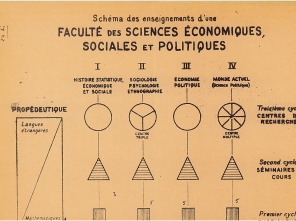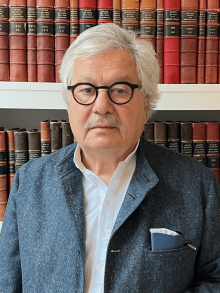
Antoine Lyon-Caen
Antoine Lyon-Caen, juriste, avocat puis professeur à l’université de Paris Nanterre et directeur d’études à l’EHESS, aborde ici les multiples manifestations du droit dans l’enseignement et la recherche à l’École, qu’il y soit considéré comme discipline, comme pratique, comme réalité socioprofessionnelle, et s’interroge sur l’exercice du droit dans l’institution qu’est l’EHESS. À la veille de l’entrée de Robert Badinter au Panthéon, il évoque aussi les liens de celui-ci avec l’École et le séminaire qu’il y tint sur la prison avec Michelle Perrot.
Pierre-Antoine Fabre : Merci, cher Antoine Lyon-Caen, de nous recevoir ce 15 août, dans la chaleur de l’été ! L’objectif de cet entretien, tel que nous l’avons imaginé avec Patrick Fridenson, c’est d’aborder le droit à l’École sous tous ses aspects, c’est-à-dire à la fois quel a été l’enseignement du droit à l’École, la présence du droit dans la pédagogie de l’École, quel a été le droit dans l’École aussi, dans l’institution, et c’est un aspect très important pour nous parce que nous essayons d’être toujours entre la science qui s’est faite à l’École et l’institution qui a été le lieu de la production de cette science. Et puis enfin, un troisième aspect, circonstanciel d’une certaine manière, mais pas tant que cela étant donné la longue histoire de ses rapports avec l’École, celui qui concerne Robert Badinter et son engagement dans l’École, dont vous avez été l’un des artisans. Voilà, à grands traits. Vous pouvez aborder comme vous le voulez et dans l’ordre que vous souhaitez ces différentes dimensions.
Antoine Lyon-Caen : J’hésite entre deux entrées en matière. La première serait d’essayer de faire resurgir ce qu’ont été les discussions autour du droit dans l’École entre 1985 et 1990. J’ai quelques souvenirs, j’ai essayé de retrouver d’ailleurs divers documents1, et je vais me réserver d’y revenir. L’autre entrée, ce serait une sorte de cartographie de la présence du droit dans l’École. Plutôt que de parler des personnes – il est toujours très difficile de parler des personnes, autant que de celui qui parle –, cette cartographie me paraît pouvoir offrir une trame de notre discussion.
Il me semble qu’il y a cinq façons, ou perspectives, selon lesquelles le droit est abordé dans les directions d’études, dans les discussions, dans les séminaires communs. Je vais peut-être essayer de les présenter. La première perspective, qui rappelle un mot que vous avez utilisé d’emblée, c’est le mot « institution ». Je pense que les historiens en particulier font une place inégale mais cependant importante à ce qu’ils appellent les institutions. En revanche, les juristes qui sont entrés à l’École ont pu contribuer à une réflexion sur la genèse des institutions et sur les institutions comme cadre d’action. C’est-à-dire l’amont des institutions et leur aval. Et cela est très présent. J’avais été sensible à beaucoup de travaux de l’École sur les institutions et les juristes qui y sont entrés à partir de 1988, je crois avoir été le premier2, juste avant Yan Thomas, ont pu contribuer à cette réflexion. Cette première perspective, spécifiquement institutionnelle donc, très présente dans les universités est peu présente dans les travaux de l’École, en tout cas chez les juristes. Par contre, la deuxième perspective a été extrêmement riche : le droit comme norme, comme énoncé normatif, ou plutôt comme ensemble de normes. Elle est peut-être même à l’origine de la présence des juristes à l’École, dans un dialogue très exigeant, soit dans des directions d’études, soit dans des rencontres internes, soit dans des rencontres avec des amis de l’École, soit des juristes, soit des économistes, notamment Robert Salais ou Olivier Favereau3, plutôt conventionnalistes ou régulationnistes. Peu importe le qualificatif qu’on leur donne, ce qui importe est la question : quelle est, si elle est, la spécificité des normes qu’on qualifie de juridiques ? Cela intéresse beaucoup les anthropologues et il y a eu dialogue, avec des économistes et avec certains sociologues, les sociologues du jugement en particulier. Ces échanges sur la normativité ont été à mon sens l’une des richesses des quarante dernières années à l’École ; la normativité qui fait apparaître non seulement une pratique sociale, mais un modèle auquel on se réfère pour évaluer ou justifier un comportement. La troisième perspective, très présente chez les juristes de l’École, pas de mon côté, mais du côté de Yan Thomas ou plus récemment d’Otto Pfersmann, même s’il n’y a pas eu de lien direct entre les travaux de l’un et de l’autre, c’est le droit comme discours, c’est-à-dire l’étude des formes mentales dans lesquelles se glisse la pensée juridique. Le discours, oui, c’est peut-être l’une des forces de la présence du droit à l’École, et que je vais lier à une quatrième forme d’installation du droit à l’École, le droit lié à la justice, le droit comme ressource ou comme élément de justification. Le dialogue a été là aussi à mon avis très présent depuis une vingtaine ou trentaine d’années à l’École entre certains juristes, certains économistes plutôt hétérodoxes, et les sociologues du jugement, certains venant de l’étude de l’argumentation ou de la rhétorique, d’autres plutôt de la justice dans l’action, ou encore des raisons d’agir, de l’observation possible des raisons d’agir et des catégorisations possibles des raisons d’agir. Enfin, cinquième et dernière perspective très diffusée parmi divers milieux historiens de l’École, chez certains sociologues, mais peu… chez les juristes de l’École, c’est l’étude des juristes, comme catégorie professionnelle, les rapports, éventuellement, entre le droit, les formes et les changements qu’il subit et la corporation, les formes d’organisation des juristes. C’est assez présent dans certains travaux sur les juristes de la Renaissance ou sur certains juristes du XXe siècle. C’était un peu le dialogue, par exemple, le très rare dialogue, mais très riche, que j’ai eu avec Pierre Bourdieu. Parce que Bourdieu ne voyait le droit qu’à travers le marché des juristes. Je lui disais : que dis-tu du droit lui-même ? Il me disait : le droit, ce n’est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c’est la production du droit par les producteurs. Il a du reste dirigé des thèses, à l’École, sur les juristes d’affaires notamment. Et c’était très intéressant, sur la configuration, aujourd’hui, des juristes d’affaires dans les grandes multinationales du conseil et de l’intervention, sur la mondialisation du droit à travers la mondialisation des structures professionnelles. À l’Ecole, les juristes eux-mêmes ne représentaient pas ou très peu cette sensibilité. En revanche, je l’ai dit, bon nombre d’historiens et certains sociologues en ont été proches. Il me semble que tout ce que je viens de dire peut constituer une première étape de la cartographie du droit à l’École.
Patrick Fridenson : Il va falloir passer en revue deux dimensions. Il y a le droit dans l’École et il y a les relations entre le droit dans l’École et ce qui se passe ailleurs. J’évoque sans tarder cette deuxième dimension parce que lorsque tu as mentionné des noms comme Robert Salais et Olivier Favereau, je pourrais ajouter sans doute celui du sociologue du travail Jean-Daniel Reynaud4 (au Cnam), qui dans les années 1990 a été coresponsable avec Olivier Favereau d’un séminaire mensuel de discussion interdisciplinaire sur « Le travail : marché et organisation ». C’était toute une floraison de réflexions sur la présence du droit dans la société. Pour prendre le titre d’une revue fondée en 1985 qui s’appelle Droit et société, c’est l’une des dimensions sur lesquelles je souhaiterais en savoir plus. L’autre étant, et tu l’as souligné à l’instant, qu’il pouvait y avoir dans l’École la volonté de croire au droit, comme ce qui lie les personnes, qui lie les groupes sociaux et qui est un producteur de valeurs.
Antoine Lyon-Caen : Ce sont deux choses assez différentes. Pour ce qui est du droit dans l’École, j’ai essayé dans cette très brève esquisse de montrer que le droit y était présent, mais finalement toujours en lien avec d’autres foyers intellectuels. L’École n’est pas autonome dans ce domaine. Le droit y est diffus, bien que sa place ait été plus marquée à partir de l’entrée de certains juristes, 1988 comme je l’ai rappelé, ce qui était un acte de foi du bureau à l’époque, sous la présidence de François Furet, puis de Marc Augé. Lorsque j’ai été sollicité, c’était François Furet, mais quand j’ai été élu, c’était Marc Augé, donc entre 1987 et 1988. L’École a en tout cas toujours été une pièce dans un réseau, où étaient actifs des économistes (toujours hétérodoxes), des sociologues, pas seulement français, mais aussi allemands, italiens, etc.
Quant à « croire au droit », il est difficile de donner une réponse univoque pour l’École. J’ai, comme toi, Patrick, participé à beaucoup de meetings, de réunions, qui n’étaient pas académiques, pas scientifiques non plus, des meetings dans lesquels nous étions plusieurs appartenant à l’École. Je prendrai un exemple, celui d’un meeting auquel Yan Thomas et moi avons participé, sur la loi Gayssot5, loi permettant d’incriminer ceux qui niaient des « crimes contre l’humanité », et le meeting a évidemment porté sur la liberté d’expression, sur la liberté de la recherche scientifique et il me semble que l’École était plus présente, sur ces sujets, que d’autres institutions. J’étais moi-même à l’université de Paris Nanterre où il y a des historiens, des juristes, etc. et le terrain était moins sensible, la discussion moins vive qu’à l’École. Il me semble, à travers cet exemple, que l’École a contribué à une réflexion sur le droit dans ses liens avec la démocratie, et que les juristes ont été au premier rang.
Patrick Fridenson : C’est un exemple très important parce qu’il y a eu alors une division au sein de l’École entre ceux et celles qui affirmaient une liberté pour l’histoire de faire ce qu’elle entendait et ceux et celles qui pensaient que la négation, la falsification devaient se situer par rapport à un devoir de recherche de la vérité ; et il y avait aussi, sous ce débat, la réaction des spécialistes des minorités opprimées. Je me souviens de Claire Mouradian, directrice de recherche au CNRS, membre du Centre de recherches historiques, évoquant le cas des Arméniens et le fait qu’il était hors de question en Turquie d’évoquer le génocide commis à l’égard des Arméniens. Claire Mouradian et notre autre collègue Gilles Veinstein, spécialiste de l’histoire ottomane, s’étaient d’ailleurs directement affrontés dans divers contextes.
Antoine Lyon-Caen : Oui, mais ce qu’il faut souligner, je crois, c’est que ce débat se jouait, en effet, dans des contradictions et dans des conflits internes, mais qu’il se jouait publiquement. Ceux qui souhaitaient parler ou prendre position acceptaient de discuter avec ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux. C’était exemplaire. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas aujourd’hui mais j’ai le souvenir tout à la fois de la vivacité des échanges et d’un débat réglé. Il faudrait mobiliser d’autres souvenirs… Patrick, sur les politiques de l’emploi, nous avons eu aussi ce genre de réunion, qui ne relevait pas des séminaires, mais de débats qui n’étaient pas limités aux étudiants de l’École, notamment sur les contrats précaires, le contrat premier embauche (CPE) en particulier6, des débats sur la place du droit dans l’organisation et le fonctionnement du marché du travail.
Pierre-Antoine Fabre : Je suis frappé de ce que vous dites sur le fait que ces débats n’aient peut-être plus eu lieu de la même manière. Nous allons évoquer dans un chapitre de ce même atelier avec Jérôme Dokic et Bruno Karsenti des débats qui avaient eu lieu à l’École au début du mandat de Danièle Hervieu-Léger, « Les débats de l’École »7, des débats structurés comme tels, sur la question du naturalisme et du constructivisme8, et on est arrivé au constat que ces « débats » ont été interrompus dans un moment où l’École est entrée dans une turbulence interne très forte sur le sujet de la préparation de l’installation de l’École sur le campus Condorcet où des clivages d’une autre nature ont fait que, de fait, et on peut sans doute le regretter aujourd’hui, l’École ne s’est plus réunie autour de ces échanges tout à la fois très conflictuels et très organisés, aménagés comme tels. Nous sommes sans doute là dans un moment très aigu de l’histoire que nous essayons d’écrire dans cet Atelier, entre la vie scientifique de l’École et son devenir institutionnel.
Antoine Lyon-Caen : Je peux apporter un autre témoignage sur la période, qui est justement celle où l’on voit apparaître Robert Badinter, pour répondre à une autre de vos questions. Ce moment est lié aux échanges qui avaient lieu à la Chancellerie entre Robert Badinter et Michel Foucault. Les deux hommes se voyaient régulièrement et partageaient de temps à autre des déjeuners très ascétiques. L’un comme l’autre mangeaient des haricots verts et de la viande grillée, c’est tout. L’idée était de faire naître une unité mixte entre le CNRS et l’École. Celui qui était un peu à la manœuvre, c’était Yves Duroux, qui avait des responsabilités importantes au CNRS9. Le projet était de faire prendre le droit au sérieux à l’École par la création de cette unité mixte. Parmi les sociologues du droit ou les juristes qui étaient sollicités il y avait François Ewald, bien sûr, ou encore Alain Supiot10. La découverte que les uns et les autres ont faite, après la proposition d’une « formation de recherche mixte » avec la Fondation nationale des sciences politiques, c’est qu’il n’existait pas à l’École de centre consacré au droit, et qu’il était donc impossible de penser à une unité mixte CNRS-EHESS. Progressivement, à partir de 1986, le projet a évolué et l’idée a été de faire naître un centre dédié à l’étude de la normativité. C’est là que j’ai retrouvé Robert Badinter, parce qu’il avait quitté la Chancellerie, qu’il était au Conseil constitutionnel et que certaines des réunions préparatoires ont eu lieu là, au Conseil constitutionnel, donc lui s’intéressait à cette initiative.
Pierre-Antoine Fabre : Est-ce ce qu’est devenu le Centre d’étude des normes juridiques ?
Antoine Lyon-Caen : Non, c’était avant, mais, vous avez raison, le Centre d’étude des normes juridiques a été le fruit indirect de ces initiatives. Il a fallu que Yan Thomas et moi-même nous soyons élus à l’École, moi en octobre 1988 et lui en septembre 1989, pour qu’un tel centre soit présenté au Conseil scientifique de l’École, en 1990. Le rapporteur en était [le sociologue] André Grelon. Entre- temps, Badinter poursuit les réflexions qu’il partageait en partie avec Michel Foucault et Michelle Perrot, un foyer de réflexion sur la prison et sur l’enfermement, et en particulier sur l’architecture pénitentiaire et les conditions de l’enfermement. Badinter avait consulté des historiens de l’architecture, il était très intéressé par cette dimension, et il implante à l’École, sous la présidence de Marc Augé, un séminaire co-animé par Michelle Perrot et lui-même, qui a duré cinq ans et dont Badinter a tiré un livre, La Prison républicaine, publié en 1995. C’est le premier séminaire régulier auquel Badinter ait participé.
Patrick Fridenson :Combien de personnes venaient à ce séminaire ? Quel type de génération ? Quel type de présence ? Quel type de curiosité ?
Antoine Lyon-Caen : Il y avait au moins trois publics différents : il y avait de jeunes chercheurs, nombreux, il y avait des magistrats, notamment ceux qui s’occupaient de la direction de l’Administration pénitentiaire et qui avaient suivi la politique de Badinter quand il était garde des Sceaux, c’était un groupe assez important, il y avait des chercheurs confirmés, du CNRS entre autres, des universitaires. Ce mélange faisait qu’il n’y avait pas les mêmes demandes. Je me souviens que les chercheurs avaient une sorte de curiosité qui pouvait irriter Robert Badinter. Michelle Perrot avait bâti un vrai programme de travail de dépouillement d’archives. Les chercheurs avaient des appétits qui ne pouvaient pas, au moment où les questions étaient posées, être satisfaits, qui le seraient l’année suivante, mais il n’y avait donc pas un débat très vif à l’intérieur parce que le choix avait été celui d’un exposé très structuré, très élaboré, et Badinter tirait un peu les leçons de la séance du séminaire…
Pierre-Antoine Fabre : Quelle a été la suite, du point de vue des relations entre Badinter et l’École, après ce séminaire de 5 ans ?
Antoine Lyon-Caen : Je n’ai pas souvenir d’une suite. Badinter est sorti du Conseil constitutionnel en 1995, au bout de neuf ans. Il hésite alors sur ce qu’il va faire. Il était à la retraite de la fonction publique depuis quelque temps déjà. Il a repris ses cours comme professeur émérite, il a créé un séminaire à Sciences Po sur les institutions judiciaires en France et en Europe mais pas à l’École. À vrai dire, la forme du séminaire ne répondait pas très bien à ce qu’il souhaitait faire. À Sciences Po, c’était plutôt un cours. Il ne s’était pas complètement coulé dans le moule du séminaire « École »… Il n’avait pas pour Sciences Po un élan du cœur, mais le directeur de Sciences Po d’alors savait attirer11 … En dépit de l’arrêt du séminaire, je voudrais rappeler ici son immense écho, avec le livre qui a suivi, au plan international en particulier. Pour l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre, les États-Unis, quelque chose de neuf était apparu alors, et c’est comme si une nouvelle phase de l’histoire de la prison, de l’enfermement, s’était ouverte et comme si elle était en même temps une question posée sur ce que pouvait signifier la République pour le système carcéral.
Quand Badinter était garde des Sceaux, il déplorait la timidité des hommes et femmes politiques devant l’histoire de la prison, devant toute réflexion sur ce que c’était qu’un enfermement dans un système démocratique. Michelle Perrot, qui, elle, connaissait bien le sujet déjà à l’époque, s’est avancée avec lui sur un chemin qui n’avait pratiquement pas été exploré. L’idée républicaine n’exclut pas certaines formes d’enfermement, ou certaines causes d’enfermement. Ils avaient le sentiment qu’au XIXe siècle cela avait été un débat, mais au XXe siècle plus rien. Plus rien dans le discours politique, mais le discours savant est lui-même très peu consistant au XXe siècle. Lui, en tant qu’intellectuel habité par une volonté d’action, se sentait très seul. Il a fait des conférences dans des universités parce qu’il y avait ici ou là des groupes de recherche qui s’intéressaient à ça, mais les échos ont surtout été à l’étranger. À vrai dire, le Foucault historien n’allait pas jusqu’au XXe siècle…
Pierre-Antoine Fabre : Oui, mais le Foucault militant ?
Antoine Lyon-Caen : Lui était en plein dans le XXe siècle. Et Badinter était en rapport avec les deux Foucault, d’une certaine façon. Il écoutait aussi le Foucault militant. Mais il n’y avait pas d’instance politico-institutionnelle dans laquelle on puisse discuter de ça. Il y a une direction de l’Administration pénitentiaire, mais si l’on regarde ce qu’est la direction de l’Administration pénitentiaire, qui est une des directions du ministère de la Justice, il n’y a pas de cellule d’études. Les études étaient faites, quand elles existaient (sur la santé dans les prisons par exemple), par le Cesdip (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales) que dirigeait un ancien magistrat devenu directeur de recherche au CNRS12. Ils étaient une quinzaine de chercheurs et parmi leurs programmes de travail il y avait éventuellement des études sur les prisons, mais à part cela, ni à l’Assemblée nationale, ni au Sénat, sauf missions parlementaires, de temps en temps seulement, il n’y avait de lieux qui soient d’abord des lieux d’accumulation de connaissances. La solitude de Badinter est à ce niveau-là. Et c’est pour ça que ce séminaire de l’École a été pour ceux qui en parlent une sorte de bouffée d’air pur ! Pour une fois on essayait de déplier les connaissances sur la prison… Mais on peut dire que malheureusement, pour finir de répondre à votre question sur les suites, Pierre-Antoine, cela n’a en effet pas eu de prolongement sous la forme de lieux de recherche. Quelques centres universitaires s’occupent de criminologie, mais la prison, ce n’est pas vraiment ça et cela reste une sorte de « non-sujet ».
Patrick Fridenson : Je souhaiterais aborder un autre volet qui me vient l’esprit en t’écoutant. Robert Badinter et toi vous étiez dans la fraction des juristes qui ont été universitaires et aussi avocats. Peux-tu évoquer cette dualité, ces interrelations parce que c’est quelque chose de singulier, pour une partie de l’École, pour une partie des milieux universitaires, sauf dans le cas des professeurs de médecine tout à la fois universitaires et praticiens ? Et cela vous a mené à des aventures communes, comme votre essai de simplification du Code du travail13. Mais je ne veux pas du tout centrer ma question là-dessus mais plutôt sur la réflexion rigoureuse dont vous avez l’un et l’autre fait preuve sur le sujet du travail, et j’évoque la mensuelle Revue de droit du travail créée en 2006 et que tu diriges. Quelles sont ces relations entre la pratique, l’enseignement et la recherche vues de ta fenêtre ou de sa fenêtre ?
Antoine Lyon-Caen : Curieusement, je dirai que le lien est moins prégnant que tu ne le laisses entendre. Je reviens sur les deux cas. Je suis resté quelques mois avocat et je me suis mis en congé ; je n’ai plus été avocat, notamment pendant mes plus de 25 ans de directeur d’études cumulant à l’École, et je le suis redevenu parce que je suis retraité de mes fonctions académiques. Je n’ai donc jamais vraiment conjugué. Robert Badinter, c’est un peu différent : il a été avocat et professeur entre 1965 et 1981, date à laquelle il est devenu ministre de la Justice, et il n’a alors plus jamais exercé la profession d’avocat. Et de plus, s’il a été seize ans avocat je ne suis pas sûr qu’il y ait un lien entre les observations liées à cette pratique et l’action qu’il a conduite comme ministre, ou comme président du Conseil constitutionnel puisqu’entre 1965 et 1981 il était spécialiste de propriété intellectuelle, de droit de la presse et éventuellement de droit du cinéma, droit des financements du cinéma. Or comme garde des Sceaux puis comme président du Conseil constitutionnel il ne s’est pas du tout intéressé à ces sujets… Je pense que dans un cas comme dans l’autre, c’est plutôt la connaissance du milieu qui nous a peut-être été utile, la connaissance du milieu des avocats, de la pratique judiciaire. Et là, Patrick, tu as raison, c’est vrai que, pour lui comme pour moi, ça a été très important parce qu’en réalité parmi les questions très abstraites que l’on peut se poser (comme par exemple : est-ce qu’une norme existe indépendamment de son effectuation ?), si tu ne connais pas la pratique des avocats c’est une question absconse. En revanche, si l’on regarde comment se pratique l’argumentation et ensuite l’énoncé de la sentence ou de l’arrêt, on est nourri dans ce genre de réflexion. Je ne peux pas parler à la place de Badinter mais je pense que pour lui comme pour moi la connaissance du milieu des avocats a déplacé les questions de recherche. J’ai participé à des gros travaux européens sur la rationalité procédurale, par exemple, avec les philosophes du droit de l’université de Louvain-la-Neuve. On a fait cinq ans de travaux là-dessus, d’enquêtes, etc., et je n’aurais rien compris à cette question si je n’avais pas observé ce qu’était la justice dans son fonctionnement, tout à la fois devant le tribunal et devant les hautes juridictions européennes ou la Cour européenne des droits de l’homme. Quand Badinter est arrivé à la Justice en 1981, il avait déjà une sorte de programme pour l’administration pénitentiaire, les auxiliaires de justice, les avocats, la saisine de la Cour européenne, l’abolition des tribunaux d’exception, il avait une telle connaissance du système pratique de la justice en France et même en Europe qu’il a été certainement le ministre le mieux armé pour exercer cette mission, portée par l’analyse des vices et des vertus des institutions de formation des magistrats, par exemple, et les grands sujets sur lesquels il a vraiment laissé des traces, y compris dans des livres, n’ont pas grand-chose à voir, j’y reviens, avec les sujets qu’il traitait comme avocat, mais avec une connaissance des pratiques, y compris des pratiques de l’argumentation, que l’on évoquait plus haut, cela, oui. D’ailleurs, Badinter a changé de « sujet », si je puis dire, entre 1965 et 1981. En 1971, il est sollicité pour devenir l’avocat d’un condamné à mort, ou de quelqu’un qui s’exposait à la condamnation à une peine de mort, et il s’est alors dédoublé : comme avocat il pratiquait toujours le droit de la presse, il était l’avocat du groupe Express, il écrivait des chroniques dans Le Nouvel Observateur, mais à partir de 1971 il devient aussi l’avocat de la cause de l’abolition et ceci presque par hasard : il avait certes déjà réfléchi au problème, mais il n’a pas cherché à devenir avocat pénaliste… Mais revenons à ta question et pour nous résumer, l’expérience du métier d’avocat a compté dans une compréhension de la pratique : comment produit-on un jugement ? Quels sont les éléments qui sont mobilisés ? Et puisque tu parles, Patrick, du droit du travail, mes liens avec les organisations syndicales m’ont nourri aussi de ce point de vue : sur quels éléments prennent-elles appui pour élaborer leur doctrine, leurs réactions, etc. Et là, à nouveau, nous ne sommes pas loin de certaines des perspectives du droit à l’École : le discours, l’argumentation.
Pierre-Antoine Fabre : Si on a encore le temps d’une question, et pour revenir là aussi à l’École, en passant par le droit du travail, j’aimerais beaucoup – nous avons évoqué cet aspect en préparant notre rencontre avec Patrick – que vous nous disiez quelle est votre réflexion sur la relation entre la présence – multiple – du droit dans l’École et le problème, dans cette même École, du droit du travail. Pour moi, qui habite cette École depuis plus de trente ans, une série de thèmes concernant la souffrance au travail sont apparus dans la toute dernière période. Comment faites-vous le lien entre une présence intellectuelle intense du droit dans l’École et le fait que l’École ne soit certes pas une zone de non-droit, mais une zone dans laquelle le droit du travail a été peu présent ?
Antoine Lyon-Caen : Sur ce sujet, c’est la même chose dans les universités. Il est difficile de réfléchir au droit du travail lorsqu’il n’y a pas d’employeur. Or, dans les universités comme à l’École, l’employeur c’est l’État et l’État…n’a pas de représentation. Il faut donc faire un pas extrêmement difficile pour dire la souffrance au travail. On peut passer par des collègues, par des élus auxquels nous aurons contribué à donner la légitimité de représentants mais cela a pris énormément de temps, et encore aujourd’hui, je pense qu’on n’identifie pas l’employeur dans les institutions académiques universitaires. C’est un peu différent pour les administrations dans lesquelles vous avez des directeurs d’administration centrale, ou un cabinet du ministre, donc finalement une hiérarchie. L’État s’incarne dans le directeur d’administration, etc. Au contraire, dans les institutions où ce directeur ou président est élu et quand on a peut-être même voté pour lui, on sait qu’il est précaire, qu’il ne dispose pas en réalité de tous les registres d’action nécessaire et donc ces divers facteurs expliquent que le droit du travail soit très peu mobilisable, et très peu mobilisé. Il l’est en réalité lorsqu’il y a une présence syndicale forte, mais elle ne l’est justement pas, dans l’École, par exemple, en raison de cette réalité de structure… C’est probablement la responsabilité de la vision que le droit du travail a donnée de lui-même, c’est-à-dire un rapport de domination entre un employeur et un salarié. Lorsqu’il y a maîtrise des moyens de production, le droit du travail ne s’applique pas. La réponse à la souffrance c’est : je n’y suis pour rien, et c’est en partie vrai : quand un directeur d’études voit souffrir un agent administratif ou un doctorant que peut-il faire ? C’est d’ailleurs pour cela qu’on invente des mécanismes de « téléphone vert » : même si ce n’est pas votre employeur, vous pouvez avoir une écoute. Cette écoute, c’est une forme de réponse
Patrick Fridenson : La seule chose que je voudrais évoquer sur ce point, c’est la naissance de la médiation au sein des universités qui n’est pas du tout exclusive du recours soit à la justice disciplinaire soit à la justice civile. Mais l’École – et les universités identiquement – a abouti à la nécessité d’une médiation, qui n’est pas seulement un lieu de transaction mais d’abord un lieu où la parole de ceux et celles qui sont en souffrance peut s’exprimer et cela rejoint d’une certaine manière ce que tu viens de dire à propos des pratiques d’écoute.
Antoine Lyon-Caen : Oui, tu as raison, et cela me permet une dernière réflexion. La complexité procédurale institutionnelle du droit disciplinaire dans la fonction publique n’est probablement pas la voie par laquelle passe la résolution de beaucoup de conflits ou de tensions. À la différence de ce qui existe dans l’entreprise privée où le droit disciplinaire est relativement simple, les garanties données dans le droit de la fonction publique soit à un enseignant soit à un agent administratif en présence de dénonciations de faits susceptibles de donner lieu à sanctions disciplinaires sont tellement complexes que le droit disciplinaire ne peut pas y répondre facilement. Pour prendre le cas des phénomènes de harcèlement, que nous avons certainement à l’esprit, que fait-on en présence d’un harcèlement ? La voie disciplinaire est l’ultime recours, mais il faut d’abord trouver des voies qui permettent aux personnes qui subissent ou souffrent de s’exprimer, d’avoir un interlocuteur, et la médiation est probablement l’une des voies les plus simples.
Pierre-Antoine Fabre : Avez-vous encore d’autres aspects que vous auriez aimé qu’on évoque ?
Antoine Lyon-Caen : On a parlé de Robert Badinter et des rapports que j’ai eus avec lui. En vérité, je ne suis pas sûr que l’École, en dehors des acquis du séminaire sur la prison, ait représenté dans sa réflexion quelque chose de facile d’accès. Il connaissait bien les systèmes universitaires étrangers, notamment l’américain, il y avait des amis et il y était invité assez souvent, mais il n’avait pas une habitude de la confrontation typique de l’organisation interne à l’École, et je pense qu’il appartenait à une génération pour laquelle on ne discutait pas vraiment des thèses, par exemple d’un chapitre de thèse, d’un argument. Les juristes, à vrai dire, avaient une vision totalement archaïque de la préparation et de la soutenance d’une thèse : on n’en parlait pas pendant les cinq, six ou sept ans de préparation et tout n’était soumis que lors de la soutenance. Donc le modèle du séminaire dans lequel un jeune chercheur présente l’état de ses réflexions sur tel ou tel sujet n’appartenait pas à son horizon. Il faut souligner l’originalité de l’École, ici, pour quelqu’un comme Badinter, dans ces années-là. C’est devenu tellement important, et plus diffus aussi, que vous, Pierre Antoine et Patrick, finissez par l’oublier, mais aujourd’hui encore cela reste original. Si l’on compare l’École à une université italienne, espagnole ou américaine, la pratique d’un séminaire très ouvert, fréquenté par plusieurs générations différentes et dans le cadre duquel s’exerce cette préparation à la thèse, n’est pas généralisée.
Pierre-Antoine Fabre : Eh bien, il fallait alors le rappeler, merci ! Merci infiniment de tout ce que vous avez apporté ici.
Notes
1
Voir jointes à l’entretien les pièces suivantes : Centre d’Analyse des Modes de Gouvernement (1986) ; Antoine Lyon-Caen et Georges Lavau, Proposition de création d’une formation de recherche mixte (CNRS, EHESS, FNSP) « Droit, pouvoir, légitimation » ; Proposition concernant la création à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales d’un Centre de Recherche sur le droit et la Justice (1986) ; André Grelon, Rapport sur le projet de Centre d’Etudes Juridiques présenté par MM. LYON-CAEN et THOMAS à la séance du Conseil du 2 mai 1990, Conseil scientifique EHESS, Séance du 8 juin 1990.
2
Antoine Lyon-Caen est élu à l’École en 1988 sur une chaire qu’il intitule « Droit, économie, entreprise ».
3
Robert Salais, économiste, chercheur à l’Insee puis à l’École normale supérieure de Cachan puis Paris-Saclay, est l’un des fondateurs de l’économie des conventions. Après avoir publié sur le chômage puis sur les mondes de production, il a étudié les questions posées par la construction de l’Europe dans le domaine social. Olivier Favereau, professeur de sciences économiques à l’Université Paris Nanterre, est un des autres fondateurs de l’économie des conventions. Il a contribué au renouveau des approches institutionnalistes en économie (économie des conventions, approches de la régulation, évolutionnisme et théorie des coûts de transaction).
4
Jean-Daniel Reynaud (1926-2019) a été professeur de sociologie du travail au Conservatoire national des arts et métiers, cofondateur de la revue Sociologie du travail puis directeur de la Revue française de sociologie. Principal ouvrage : Les Règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale, Paris, Armand Colin, 3e édition augmentée, 1997.
5
Loi votée le 13 juillet 1990 après l’attentat contre le cimetière juif de Carpentras.
6
Contrat de travail à durée indéterminée destiné aux moins de 26 ans prévu par un projet de loi élaboré par le gouvernement Villepin qui déclenche en 2006 un mouvement étudiant. La loi est votée, promulguée mais n’est pas appliquée. Un moment important dans l’histoire de l’EHESS.
7
L’un de ces « Débats de l’École » sur le sujet du « terrain » en sciences sociales avait donné lieu à un vif échange, qui nous ramène plus haut dans cette conversation, sur les conditions de l’accès au terrain en Turquie par rapport à la reconnaissance, ou non, du génocide arménien.
8
Un très beau numéro de la revue Enquêtes en est sorti peu après.
9
Yves Duroux, philosophe, ancien élève de Louis Althusser, figure méconnue et pourtant essentielle de la vie institutionnelle et scientifique de cette période, traverse cet Atelier à plusieurs reprises, en particulier dans notre entretien avec Joachim Nettelbeck. Il est dans la « liste des participants associés » à la 2e proposition de 1986 dans le « groupe EHESS », comme directeur de laboratoire CNRS, et parmi les « membres du Centre » du 3e projet. Il a été directeur adjoint du Programme interdisciplinaire de recherche sur les technologies, le travail, l’emploi et les modes de vie du ministère de la Recherche, puis chef du département SHS. Il a ensuite enseigné à l’École normale supérieure de Cachan de 1993 à 2006, année où il se retire de l’enseignement.
10
Pour plus de détails, voir les listes des participantes et participants cités dans le 2e et le 3e projets.
11
Richard Descoings, maître des requêtes puis conseiller d’État, dirige Sciences Po de 1996 à sa mort en 2012.
12
Il s’agit de Philippe Robert. En 1968 le ministère de la Justice crée sous son impulsion le Service d’Études Pénales et Criminologiques. En 1983, donc sous Badinter, afin d’assurer son assise scientifique et de garantir son indépendance, le SEPC passe sous la double tutelle du CNRS et du ministère de la Justice et devient le CESDIP.
13
Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen, Le Travail et la loi, Paris, Fayard, 2015.